Le climat et nous, comment dire? (1)
«Quatre livres pour toucher terre»: dans un «domaine aussi difficile, aussi contre-intuitif que le climat», compliqué de positionner sa propre parole. Premier volet du «dialogue» de Vincent Wahl avec des livres (fictions ou essais) qui l’ont «attiré, nourri, armé», ici Dans la lumière de Barbara Kingsolver, la trilogie climatique de Kim Stanley Robinson et L’événement Anthropocène de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz.
Texte publié sur Poezibao.
Quatre livres (deux romans dont une trilogie, un essai historique, un poème épique) sur le climat, presque anciens, déjà, au train où vont les choses, le premier étant paru en 2006, pour un exercice de partage et d’admiration. Beaucoup d’écrivains lisent pour écrire, pour poser leur propre voix. C’est aussi mon cas. Dans mes livres, je cite et paraphrase, et ma propre écriture est intimement mêlée à la parole des autres (1). À plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un domaine aussi difficile, aussi contre-intuitif que le climat. Mais cette fois-ci, cela ne s’est pas passé comme les précédentes: il m’a semblé plus urgent d’écrire sur ce que j’avais lu, et participer à le faire connaitre, que de rebondir sur un texte qui me soit personnel. Dans ce travail, je n’ai pas recherché l’exhaustivité, impossible d’ailleurs tant la climatic fiction ou CliFi est aujourd’hui foisonnante (2), ni même la représentativité dans le choix des livres, fruit du hasard des rencontres. Mes lectures sur le sujet ont été plus larges, mais je n’ai pas gardé de mémoire précise de mes évitements ni de mes déceptions, sinon que je ne recherchais pas de récits apocalyptiques en tant que tels, et que la plupart des poèmes que j’ai lus ou entendus sur le sujet m’ont paru limités, ne proposant rien de plus qu’un cri. Cet article est donc un dialogue avec des textes qui m’ont attiré, nourri, armé, et m’ont paru pouvoir procurer à beaucoup d’autres les mêmes bienfaits. Une promenade, invitant le lecteur à revenir aux livres eux-mêmes.
Dans la lumière
 Montée de l’anxiété climatique chez les jeunes urbains, remous autour de projets fiscaux prétendument écologiques, longues parenthèses négationnistes et manipulatrices de foules aux USA, ou au Brésil. En Europe et en France, risques de clivage entre urbains et ruraux, classes moyennes et populaires, riches manipulant les pauvres, tentation de repli, chacun sur sa culture de classe. Tout cela me renvoie à Dans la lumière, un roman de Barbara Kingsolver (3), rencontré par hasard il y a peut-être huit ans, et qui depuis, habite au fond de ma mémoire.
Montée de l’anxiété climatique chez les jeunes urbains, remous autour de projets fiscaux prétendument écologiques, longues parenthèses négationnistes et manipulatrices de foules aux USA, ou au Brésil. En Europe et en France, risques de clivage entre urbains et ruraux, classes moyennes et populaires, riches manipulant les pauvres, tentation de repli, chacun sur sa culture de classe. Tout cela me renvoie à Dans la lumière, un roman de Barbara Kingsolver (3), rencontré par hasard il y a peut-être huit ans, et qui depuis, habite au fond de ma mémoire.
Ce livre croise, d’une part, un accident écologique fictif mais vraisemblable: un énorme vol de papillons monarques délaisse ses quartiers d’hiver habituels au Mexique, se déroute vers les Appalaches sans autre issue qu’y mourir, et d’autre part, le trajet d’émancipation, voire de conversion, d’une femme. Della vit dans une petite ville sinistrée, vite et mal mariée, trop vite mère, prise au piège.
Emboitement des situations. Le macrocosme: changement climatique, crise économique, dérive des papillons. Le local: une société rurale close sur elle-même, quoique non sans réflexivité, y compris sur le plan environnemental, mais dont l’économie dépend largement de l’exploitation des ressources naturelles. Le versant forestier où les papillons ont trouvé refuge doit être exploité, il en va de la survie d’une famille. Le massacre annoncé interroge les gens du cru. Les gens venus d’ailleurs, scientifiques, militants, illuminés de toute écaille, se réfèrent à la grille de lecture plus abstraite du dérèglement climatique. Della est le moteur de rencontres improbables. Embauchée comme assistante des entomologistes, elle se déplace d’un compartiment à l’autre. C’est pour elle l’occasion de changer, libérant d’abord ses sentiments, avant d’élargir ses capacités d’appréhender le monde et de comprendre peu à peu ce qu’elle veut pour elle-même.
La petite ville montagnarde est une métonymie d’une rust belt/bible belt, devenue sans doute trumpiste aujourd’hui. Le livre propose une description fine des différences culturelles entre ces ruraux au fort sentiment de relégation et les écologistes, citadins, universitaires, pourvus d’une représentation globale du Monde. Toute une palette d’attitudes dans la relation à l’avenir, à la nature, à la vie affective et sexuelle, aux relations familiales, à la pauvreté, à la morale, est ainsi décrite. Pour les ruraux, la religion en est le véhicule, marquée par une sensibilité évangélique, mais beaucoup plus souple et réflexive, à sa manière, que ce qu’en disent les clichés. Ce n’est pas pour autant que Della pourra s’en contenter.
Le récit prend le temps nécessaire pour les détails, le déploiement des relations interpersonnelles, pour l’empathie avec des personnages jamais caricaturés, qu’ils soient red-necks ou citadins. Une pédagogie est mise en scène. Elle permettra à l’héroïne de comprendre les enjeux d’un changement climatique encore imperceptible, d’aborder de notions contre-intuitives comme les boucles de rétroaction, etc. Au-delà de cette dimension initiatique, didactique, le livre vaut pour son empathie, ainsi que pour la réflexion sur l’indispensable dialogue entre les deux cultures, celle d’un peuple dévalué, même à ses propres yeux, et celle des chercheurs. Della compatit avec les savants, dont elle ne sait pas comment ils parviennent à supporter un aussi redoutable savoir que celui qui porte sur le réchauffement climatique. Avant la lettre, voici l’éco-anxiété. Elle vit aussi dans sa chair la pauvreté, les espoirs anéantis de son milieu d’origine. Elle veut, désespérément, faire comprendre à ses nouveaux amis, si fins, mais si pénétrés d’un sentiment d’évidence, pourquoi ce même milieu résiste, sinon au souci écologique lui-même, du moins, à le poser à l’échelle planétaire: les gens ne voient que ce qu’ils reconnaissent, explique-t-elle. Qui peut se résigner à croire à la fin du monde? Le sentiment de classe est prégnant: le souci pour l’environnement a été attribué à l’autre équipe, il n’est pas pour les gens comme eux, assignés à des rôles qu’ils n’ont pas choisis. Vous avez déjà payé le prix, alors autant ne pas se priver et y aller franco. Si je suis un redneck dans son pick-up, eh bien, je vais griller de l’essence. À son contact, les universitaires abandonnent l’illusion de leur capacité à parler à tous les camps. Ils comprennent que le déni du changement climatique est en relation avec la fracture territoriale, est à leurs yeux, comme une condition de survie. Ce déni participe à une culture empruntée, fabriquée avec des motivations mercantiles, véhiculée par les médias conservateurs sans doute, mais devenue partie intégrante de leur identité. La condescendance des citadins ne fera que l’exacerber.
Bien sûr, la rencontre de classe à classe n’aura pas lieu, la femme passerelle devra choisir son camp. Mais la question est posée des conditions de réception du savoir et du plaidoyer écologique, de l’acceptation des changements à apporter aux modes de vie. À nous d’inventer un mode d’emploi dont on imagine qu’il associera le respect au souci des justices territoriale et sociale. Ce n’est pas gagné. Et ce n’est pas le moindre mérite de ce livre que de s’achever sur une note non de désespoir, mais d’indécidable.
Les entomologistes de Dans la Lumière portent la tragédie, mais aussi le bonheur, du savoir. Mais que pourrait-il arriver si les scientifiques prenaient le pouvoir? C’est l’éventualité qu’explore systématiquement Kim Stanley Robinson dans sa trilogie climatique dont le titre américain ne laisse pas d’équivoque: Science in the capital.
La trilogie climatique
 Les trois livres foisonnants formant la trilogie climatique de Kim Stanley Robinson font le récit utopique d’une prise de pouvoir par la science ou plutôt, du recours concerté et massif de financiers (les assureurs!) et des dirigeants politiques eux-mêmes, à des scientifiques agissants et coordonnés. Les 40 signes de la pluie, 50 degrés au-dessous de zéro, et 60 jours et après (4) dessinent une prise de conscience, transformée en programme à grande échelle de lutte contre le dérèglement climatique et ses dégâts. Publié aux États-Unis entre 2004 et 2006, la trilogie décrit, de façon prémonitoire, la légèreté et l’indifférence écologique d’un parti républicain au pouvoir, anti scientifique, au main des lobbies. Mais dans le livre, une succession de catastrophes climatiques (déluge et inondations, froid glacial sur la façade atlantique, fonte totale de la banquise) viendra bousculer cette classe politique enfermée dans ses jeux de pouvoir, jusqu’à l’élection comme président des États-Unis d’un sénateur démocrate plus conscient et conséquent que ses petits camarades.
Les trois livres foisonnants formant la trilogie climatique de Kim Stanley Robinson font le récit utopique d’une prise de pouvoir par la science ou plutôt, du recours concerté et massif de financiers (les assureurs!) et des dirigeants politiques eux-mêmes, à des scientifiques agissants et coordonnés. Les 40 signes de la pluie, 50 degrés au-dessous de zéro, et 60 jours et après (4) dessinent une prise de conscience, transformée en programme à grande échelle de lutte contre le dérèglement climatique et ses dégâts. Publié aux États-Unis entre 2004 et 2006, la trilogie décrit, de façon prémonitoire, la légèreté et l’indifférence écologique d’un parti républicain au pouvoir, anti scientifique, au main des lobbies. Mais dans le livre, une succession de catastrophes climatiques (déluge et inondations, froid glacial sur la façade atlantique, fonte totale de la banquise) viendra bousculer cette classe politique enfermée dans ses jeux de pouvoir, jusqu’à l’élection comme président des États-Unis d’un sénateur démocrate plus conscient et conséquent que ses petits camarades.
On aura vécu presque intimement ces événements à travers la vie quotidienne et le monologue intérieur de l’un des personnages, le chercheur en sociobiologie Frank Vanderwal, détaché à la National Science Foundation (NSF). Conscient de l’écart entre l’ampleur de l’enjeu et le dérisoire des actions de la NSF, et décidé à quitter Washington, il en démissionne avec pertes et fracas et donne congé de son logement. Mais de manière inattendue, il est confirmé comme coordinateur d’une action scientifique volontariste et coordonnée, et décide d’assumer la situation de sans domicile fixe, tirant toutes les ressources nécessaires à sa survie de campeur dans les forêts urbaines devenues polaires, de son sens de la débrouille digne d’un personnage de Jules Verne, appuyé sur un savoir encyclopédique et de nombreuses technologies de pointe et de poche. Plusieurs fils narratifs s’entrecroisent, l’idylle avec une espionne effrayée, les tribulations d’un attaché parlementaire et père au foyer, l’acclimatation d’un groupe de moines tibétains que la submersion a chassé de leur principauté insulaire, les rencontres du SDF 4.0 avec les marginaux qui campent comme lui dans la forêt, des intrigues politico-scientifiques. Tout cela alimente le monologue intérieur de Frank, et ses variations sur le dilemme du prisonnier: ai-je intérêt à dénoncer, ou à me taire, coopérer ou trahir lorsque les intentions de l’autre joueur me restent cachées? On peut s’y perdre un peu. J’en retiens une ouverture vers l’Utopie. Le récit s’appuie aussi sur l’ingéniosité des personnages, ainsi que sur une réflexion spirituelle d’inspiration bouddhiste. Mais le livre m’intéresse surtout par les tentatives de réponses détaillées, précises, crédibles qu’il propose aux questions suivantes:
– Comment une population – en l’occurrence celle de la capitale fédérale – vivrait-elle une succession de cataclysmes écologiques: inondation cataclysmique, vague de froid polaire – qu’ils soient insérés ou sans-logis?
– Pourquoi et comment un organisme de coordination et de financement de la recherche scientifique cherche-t-il à acquérir de l’influence au plus haut niveau de l’État, et, s’il réussit, qu’en fait-il?
– Quelles circonstances pourraient pousser à lancer d’énormes projets de géo-ingénierie (redémarrer le Gulf Stream; couvrir la Sibérie d’un lichen OGM aux performances surmultipliées de séquestration du carbone), et comment cela pourrait-il se passer?
Ma lecture me fait éprouver des sentiments ambigus. D’un côté, ce récit d’un ressaisissement collectif, d’un déploiement d’énergie et de créativité fait du bien, ancre l’espoir. De l’autre, la référence appuyée à la géo-ingénierie, sorte de paroxysme du solutionnisme technologique, alerte le lecteur de Jacques Ellul ou d’Evgueni Morozov. Le récit semble guidé par les codes du divertissement: les rebondissements de l’intrigue captent l’attention au détriment du fond, les personnages sont sommaires. L’auteur ne s’intéresse pas aux sentiments devant le bouleversement climatique, au contraire de Barbara Kingsolver. Enfin la narration ne laisse que peu de place à la réflexion sur les modes de production, d’extraction des ressources et de répartition des richesses, ni sur le modèle de croissance économique, voire sur l’american way of life.
Ayant fait ce constat d’ambigüité, d’un mélange de plaisir et de gêne, j’aurais pu laisser cette lecture à l’écart du cheminement ici retracé. Un ami à qui je faisais lire une version intermédiaire de cet article m’a encouragé, au contraire, à élucider ma perplexité dans ce cadre même, en interaction avec les autres lectures. Et d’abord, l’utopie de la Science aux commandes, du déploiement de moyens technologiques à la hauteur de l’enjeu qui anime la trilogie climatique, renvoie immédiatement à ce que Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz appelleront le récit officiel de l’Anthropocène.
L’Événement Anthropocène
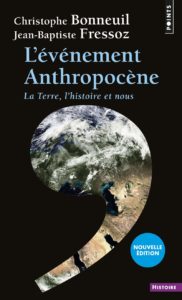 Cet ouvrage (5) est de bout en bout, un antidote contre l’amnésie, l’oubli des choix, des bifurcations qui nous ont mené là où nous en sommes, c’est à dire dans l’Anthropocène, au-delà du point de non- retour. Aussi un antidote contre les réécritures de cette même histoire. Le livre commence par le dévoilement, et la mise en perspective, d’un récit officiel de l’Anthropocène, selon lequel «nous», l’espèce humaine, aurions, par le passé, inconsciemment, détruit la nature jusqu’à altérer le système Terre. Vers la fin du 20e siècle, une poignée de scientifiques nous a enfin ouvert les yeux. Maintenant nous savons. Selon ce récit, les politiques traditionnels seraient défaillants et le public mal informé, ou encore piégé dans une dissonance cognitive, qui expliquerait sa résistance à l’évidence des faits. La tentative de rendre un tel récit hégémonique, sur fond d’oubli, ne serait pas innocente: il viendrait en effet légitimer, voire imposer comme la seule solution restante, le pouvoir de la Science, le recours massif à la géo-ingénierie, comme déjà le préfigure Kim Stanley Robinson (6).
Cet ouvrage (5) est de bout en bout, un antidote contre l’amnésie, l’oubli des choix, des bifurcations qui nous ont mené là où nous en sommes, c’est à dire dans l’Anthropocène, au-delà du point de non- retour. Aussi un antidote contre les réécritures de cette même histoire. Le livre commence par le dévoilement, et la mise en perspective, d’un récit officiel de l’Anthropocène, selon lequel «nous», l’espèce humaine, aurions, par le passé, inconsciemment, détruit la nature jusqu’à altérer le système Terre. Vers la fin du 20e siècle, une poignée de scientifiques nous a enfin ouvert les yeux. Maintenant nous savons. Selon ce récit, les politiques traditionnels seraient défaillants et le public mal informé, ou encore piégé dans une dissonance cognitive, qui expliquerait sa résistance à l’évidence des faits. La tentative de rendre un tel récit hégémonique, sur fond d’oubli, ne serait pas innocente: il viendrait en effet légitimer, voire imposer comme la seule solution restante, le pouvoir de la Science, le recours massif à la géo-ingénierie, comme déjà le préfigure Kim Stanley Robinson (6).
Nous sommes cette fois-ci non devant une fiction, mais devant une synthèse historique, saisissante par l’ampleur de son propos. Est mis en œuvre le conseil de Marc Bloch, de lire l’histoire à l’envers, à partir de nos questions actuelles, et disent les auteurs, pour donner sens à ce qui nous est arrivé et penser la nouvelle époque à partir des récits qu’on peut en faire: renouveler nos visions du monde et nos façons d’habiter ensemble la terre.
Le livre démontre que le récit officiel de l’Anthropocène, résumé plus haut, est historiquement faux, et de plus, dépolitisant, démobilisateur. Il n’est qu’une fable qu’il importe de déjouer. La période 1770-1830, des débuts de la révolution industrielle, se caractérise au contraire par une conscience très aiguë des effets et des risques sur la nature ou même, déjà, le climat, de l’exploitation intensive des forêts, ou de l’industrialisation naissante. Dès 1896, Svante Arrhenius prédisait l’influence de la consommation excessive de combustibles fossiles sur le climat. De même, la grande accélération de l’après 2e guerre mondiale s’est accompagnée de critiques nombreuses, de la bombe atomique, mais aussi de l’automobile, de l’étalement urbain, des pesticides, etc. Voués à donner l’alerte, plusieurs ouvrages, dont Printemps silencieux (7), se sont vendus entre 20 et 30 millions d’exemplaires. Était déjà
posée à cette époque la question de l’avenir de l’environnement au niveau mondial, l’action humaine étant pensée comme une force géologique. Plutôt que d’une cécité suivie d’un éveil, l’histoire serait plutôt celle de la marginalisation des savoirs et des alertes. Le Nous du récit officiel est fallacieusement globalisant: d’autres civilisations que l’occidentale ont construit des relations plus harmonieuses avec la nature et l’ensemble des espèces vivantes (8). Au sein de l’occident colonialiste et industrialisé, toutes les couches de la société ne sont pas, au même degré, responsables de cette destruction. Le récit officiel fabrique donc une humanité abstraite, et prétend qu’il serait possible de raconter l’histoire de l’Anthropocène sans parler de capitalisme, d’inégalités, de guerre, d’impérialisme, sans mentionner le nom d’une seule multinationale.
Même en Occident, disent les auteurs, le type de développement finalement advenu n’était pas écrit d’avance – plusieurs lignes historiques méritent à ce titre d’être explorées. Ainsi, une histoire politique du C02, montrerait que la prédominance du charbon n’était pas fatale, mais résulte de choix historiquement repérables, effectués par certains groupes économiques et sociaux conformément à leurs intérêts. Par la suite, le passage du charbon au pétrole résulterait moins d’une recherche d’optimisation, que de la volonté de s’affranchir du pouvoir des syndicats, etc. L’analyse de ces trajectoires permettrait d’établir des constats d’inefficacité, de repérer des bifurcations ou des alternatives négligées. Aussi contingents soient-ils, ces choix déterminent et durcissent des trajectoires technologiques sur la très longue durée. Une autre ligne historique serait l’influence des guerres et des développements militaro-industriels, brutalisant les relations entre l’homme et la nature, sur-dimensionnant les infrastructures de mobilisation des ressources, privilégiant la puissance par rapport à l’efficacité, favorisant par là le gaspillage. Aux technologies de guerre, on cherche ensuite de nouveaux débouchés, comme l’agriculture pour les tracteurs dérivant des chars, les engrais, des explosifs, les pesticides, des gaz de combat. La 2e Guerre mondiale a inauguré une accélération sans précédent du développement industriel et de la consommation. Les situations d’exception contribuent également à nous désinhiber progressivement, à anesthésier nos sensibilités devant les destructions massives.
Est proposée aussi une histoire de la consommation, et de sa critique, tout aussi ancienne, mais incapable d’en dévier le cours. Inversion des valeurs: réparation, économie, épargne, présentées comme désuètes et néfastes, tandis que la consommation ostentatoire, l’obsolescence des produits seraient respectables. Pacte faustien: la consommation en échange de la routinisation du travail, de la mise en dépendance par le crédit. Une sorte d’hédonisme disciplinaire. Mais cette évolution ne s’est pas faite sans oppositions : mouvements sociaux pour la réduction drastique du temps de travail à la fin du 19e siècle, définitivement éclipsés, cependant, à la faveur de la 2e Guerre mondiale et de la guerre froide, avec le ralliement des syndicats au consensus productiviste et keynésien, et l’endettement massif des ménages.
Réintégration, enfin, dans l’histoire de la pensée, des différentes représentations de l’enjeu écologique et des mouvements de protestation contre la révolution industrielle, de la défense de la forêt, à la lutte contre les pollutions, en passant par la contestation du progrès et les mouvements de retour à la nature. Face à la grande accélération de la deuxième moitié du 20e siècle, convergence de la critique de la technique et de la pensée environnementaliste, avec une apogée entre 1968 et 1978. Mais aujourd’hui, paradoxalement, malgré le GIEC, malgré la diffusion des préoccupations environnementales, et l’éclosion de nouvelles radicalités, est posé un constat de régression. Dans le contexte de la mondialisation néolibérale et de la financiarisation de l’économie, les normes environnementales des pays riches favorisent plus la délocalisation des activités polluantes vers les pays pauvres qu’une amélioration globale. Professionnalisation des ONG, marginalisation des critiques les plus incisives, du capitalisme, de l’impérialisme, de la croissance infinie dans un monde fini. Refus des limites, accompagné d’un regain de solutionnisme technophile chez les dirigeants mondiaux. Une histoire déprimante? ou au contraire, la condition d’un dialogue plus fructueux avec les porteurs d’alerte scientifiques, et d’une reprise en mains populaire contre les institutions répressives, les élites sociales, les appareils de domination, les imaginaires aliénants?
La question de la désinhibition revient souvent. Il s’agit de ce qui permet de s’accoutumer progressivement à normaliser ce qui auparavant, eût paru intolérable. Ses instruments: le lobbying, les coups de force technique, la récupération de la critique, les simulacres de prise en compte, etc. Il est proposé de les repérer dans le passé, afin de pouvoir en faire une lecture dynamique. D’éviter les récits grandioses et impuissants sur la modernité, l’accusation récurrente des monstres sacrés (intelligence humaine dévoyée, démographie, posture judéo-chrétienne de domination de la nature, modernité aveugle et dominatrice). La petitesse des process de désinhibition, estiment les auteurs, nous rappelle que la modernité n’est pas ce mouvement majestueux, inexorable et spirituel dont nous parlent les philosophes. On peut au contraire la penser comme une somme de petits coups de force, de situations imposées, d’exceptions normalisées. On retrouve l’appel au récit collectif, multiplié, à la mémoire partagée, à la réappropriation de l’histoire. Lesquels de ces récits nous permettront-ils de continuer à vivre, au-delà du point de non-retour? Le livre cite ici Jeanine Salesse: Quelles paroles faut-il semer, pour que les jardins du monde redeviennent fertiles ?
Les enjeux de mémoire et de la parole retrouvées sont donc à la base de L’Événement Anthropocène, qui cite aussi René Char et Henri Michaux. Logiquement donc, c’est un poème, une épopée, composée par Laurent Grisel, qui relèvera le défi.
(Lire la suite du texte de Vincent Wahl)
Illustration: nuée de papillons monarques préparant leur migration (photo Raina Kumra, CC BY 2.0).
(1) Vincent Wahl, Par où Or (ne) ment, préface d’Alain Damasio, Éditions Henry, avril 2021. Vincent Wahl, Tous les râteliers ! Un poème-parcours sur l’Or, la Dette, l’économie financière, Éditions Rhubarbe, 2010.
(2) Cf. Irène Langlet, Cli-fi & Sci-fi: Littératures de genre et crise climatique, La Vie des idées, 7 juillet 2020.
(3) Barbara Kingsolver, Dans la lumière, traduit de l’américain par Martine Aubert, Payot-Rivages 2013, 559 p.; paru depuis en édition de poche.
(4) Kim Stanley Robinson (traduit en français par Dominique Haas), Les quarante signes de la pluie, Presses de la Cité 2006 et Pocket 2011; Cinquante degrés au-dessous de zéro, Presses de la Cité 2007 et Pocket 2011; Soixante jours et après, Presses de la Cité 2008 et Pocket 2011.
(5) Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, Le Seuil, 2013.
(6) Cf. Younnes Bousenna, Réparer la planète pour mieux la détruire? Les technologies envisagées actuellement à grande échelle pour refroidir l’atmosphère posent la question des effets collatéraux qui font qualifier leurs promoteurs d’apprentis sorciers, Socialter, hors-série n°12, décembre 2021, pp.71-73. L’article décrit la manière dont la géo-ingénierie trouve progressivement de plus en plus de partisans, mais montre aussi comment ce courant de pensée, développé à l’origine par des chercheurs sur l’hiver nucléaire, est porté par des groupes d’intérêt qui veulent éviter que soit posée la question du changement de système économique.
(7) Rachel Carson, Silent spring, Houghton Mifflin, Boston, septembre 1962 et Printemps silencieux, Plon, Paris, 1963.
(8) Baptiste Morizot, Manières d’être vivant, Le Seuil, février 2020.





