L’unité dans la diversité réconciliée (2)
En découvrant les théologies féministes au cours de sa formation, Élisabeth Parmentier décide de s’en faire la porte-parole à travers la rédaction d’une thèse et se consacre dès lors à la diffusion de cette pensée. Revenant dans cette seconde partie d’entretien sur son propre rapport aux féminismes ainsi que sur le lien patriarcat-Église, elle insiste sur le pouvoir libérateur du texte biblique et sur la responsabilité des théologiens d’en livrer une compréhension éclairée, loin des stéréotypes.
Écouter ce podcast de la série Protestantes !
Lire la première partie sur notre site.
«Je ne suis que porte-parole»
Quand tu as travaillé ta thèse, tu t’es donc retrouvée devant cette évidence: quelque chose cloche, notamment pour les femmes. Sans forcément avoir eu de difficultés précises, ce constat t’a frappée et tu as rédigé cette thèse devenue plus tard Les Filles prodigues (qu’il est désormais très difficile de trouver, d’ailleurs) (1), un livre qui a vraiment fait autorité quand il est sorti. Pourrais-tu en parler un peu aux personnes qui, peut-être, n’en auraient jamais entendu parler? L’ouvrage parle aux lectrices (et lecteurs aussi, même si j’imagine qu’il s’agit majoritairement de lectrices) d’un exil destiné à prendre leurs distances face à un certain patriarcat dans l’Église afin d’entamer un voyage. Quel est ce voyage?

Quand j’ai regardé les textes féministes des années 1960 et 1970 du côté américain et du côté allemand (en Europe, l’Allemagne, les Pays-Bas et un peu l’Italie étaient concernés), j’ai vu que les auteures utilisaient beaucoup la question de l’Exode: est-ce qu’elles allaient quitter l’Église où elles n’étaient pas reconnues à leur pleine valeur? Même les protestantes, pourtant reconnues, n’étaient pas non plus exemptes de difficultés – je ne parle pas seulement de l’ordination des femmes qui n’est pas le thème majeur des théologies féministes car il ne concerne qu’une partie des femmes s’intéressant au ministère. La thématique de l’exode prédominait et cela explique le titre de l’ouvrage. J’ai pensé au fils prodigue (le fils qui a quitté la maison du père pour aller faire sa vie ailleurs et qui revient) ainsi qu’au terme de prodigalité: cette créativité, le fait de dilapider l’héritage, qui est devenu une créativité pour les théologiennes féministes puisqu’elles voulaient aussi quitter la théologie traditionnelle pour élaborer leur propre pensée. Cette prodigalité, je voulais la mettre en valeur. Dans ma thèse, j’ai donc montré quelques grandes orientations de la théologie féministe (notamment par rapport à la question du corps, comment considérer le corps) qui sont aujourd’hui des évidences mais qui à l’époque était encore considérées comme une sorte de révolte, de révolution des femmes.
Comment les femmes qui ont lu ton livre ont-elles réagi?
C’est-à-dire que je n’étais que la transmettrice. Je ne suis pas une conceptrice de théologie féministe et, dans ma thèse, je ne me faisais que porte-parole. Même par la suite, je ne suis jamais devenue une créatrice de théologie féministe comme certaines grandes auteures, Elisabeth Schüssler-Fiorenza ou Elizabeth Johnson (beaucoup d’Élisabeth, d’ailleurs !).
Tu étais destinée à ça!
Voilà. Il fallait que je fasse avec mon prénom mais je ne suis pas du tout une théologienne féministe au sens de conceptrice. Je ne suis que porte-parole.
«Je n’ai jamais cru qu’il y avait un côté de l’humanité meilleur que l’autre»
Malgré tout, des femmes ont grâce à toi eu accès à cette pensée-là et tu disais qu’à l’époque c’était une sorte de révolution. Comment cela a-t-il été reçu?
Avec une forme d’inquiétude. En France, à l’époque, c’était très mal vu de se dire féministe. J’ai d’ailleurs moi-même toujours eu des difficultés avec ce qualificatif. J’assume mieux aujourd’hui mais je ne suis pas une vraie féministe au sens du féminisme actuel. Mon premier but était de montrer qu’on ne peut pas mettre tous les féminismes dans le même panier, au niveau de la théologie non plus, puisqu’il y avait toute cette ligne de théologiennes qui voulaient tout simplement quitter le christianisme et qu’on a appelées les postchrétiennes. Elles considéraient que rien n’était possible avec le christianisme puisqu’il était intrinsèquement patriarcal et dominé par la pensée masculine. Et puis, de l’autre côté, il y avait une ligne que je ne voulais absolument pas suivre qui était la ligne hyper-féminisante, selon laquelle la femme est le meilleur pour l’homme, est l’avenir de l’homme tandis que l’homme doit découvrir le féminin et le faire sien parce que c’est la meilleure part de l’humanité. Moi je n’ai jamais cru qu’il y avait un côté de l’humanité qui pouvait être meilleur que l’autre. Cette hypersensibilité au féminin qui est encore développée aujourd’hui avec de nombreuses écoles et bénédictions du féminin est encore une hyper-essentialisation.
Dans quel féminisme t’es-tu retrouvée?
Ce qui m’intéressait, c’était les essais de théologiennes reprenant les textes bibliques dans une lecture qui revenait d’abord au texte, le texte tel qu’il était vraiment écrit en hébreu, en grec – j’étais aussi capable de le faire puisque c’était ce que j’avais appris en théologie. C’était aussi ces théologiennes qui essayaient de montrer le potentiel libérateur présent dans les textes bibliques mais qu’il faut aller examiner de près.
C’est-à-dire?
Elles montraient qu’il y a eu des erreurs dans les traductions ou que certaines ont abaissé la valorisation des femmes. Je prends toujours en exemple la fin de l’Épître aux Romains (Romain 16,1) lorsque l’apôtre Paul – qu’on qualifie tellement de misogyne – remercie dans une lettre apparemment authentique toutes les collaboratrices et les collaborateurs de son entreprise missionnaire: parmi tous les noms cités figurent de nombreux noms de femmes. Des couples sont également mentionnés et il les appelle collaborateurs et collaboratrices, ou apôtres, envoyé·e·s; il n’est donc pas le seul à se nommer ainsi, il y en a d’autres à qui il donne ce titre.
Et, toujours dans ce même verset, il salue Phoebé, «Phoebé notre sœur». Les traductions protestantes disaient «diaconesse» ou «sœur de l’Église de Cenchrées» (elle représentait certainement une communauté de maisons dans ce lieu, Cenchrées). Les théologiennes féminines se sont demandé pourquoi c’était diaconos (un masculin) en grec, alors qu’il s’agissait clairement d’un nom de femme. Et c’est tout simplement parce qu’il s’agit d’un ministère: elle n’est pas simplement une diaconesse, on parle du ministère de diacre. Donc à cette époque, dans les premières communautés chrétiennes, on lui avait déjà conféré un mandat de diacre avec le terme au masculin; elle avait un vrai mandat. On ignore si elle était au même niveau que les hommes car on se situe quand même dans les années 60-70 après Jésus-Christ mais elle était certainement responsable d’une communauté de maison. Tout cela a été occulté par la traduction, en disant «notre sœur» ou «diaconesse» comme si elle aidait simplement la communauté.
Et puis, il y a l’exemple fameux de l’occultation, le fait qu’on sélectionne des versets plutôt que d’autres. «Femmes, soyez soumises à vos maris» (Éphésiens 5,22) sans prendre en compte ce qui suit: «comme au Seigneur». Puis le parallèle «Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l’Église» (Éphésiens 5,25). C’est absolument révolutionnaire pour l’époque que les maris aiment les femmes, qu’on parle d’amour! On ne demande même pas aux femmes d’aimer les maris mais on demande aux maris d’aimer les femmes comme le Christ a aimé l’Église !… Et puis le texte dit plus loin de les traiter comme on traite son propre corps. Avec une telle déclaration, on ne peut plus avoir de violence ou d’abus en ce qui concerne le couple (en tout cas dans le texte biblique). Il faut vraiment regarder le texte dans son intégralité parce que l’apôtre n’a pas voulu valoriser uniquement la première moitié du premier verset.
«Nous les théologiens, sommes des garde-fous»
Le souci, c’est que j’ai l’impression qu’on a besoin d’avoir un doctorat en langues anciennes ou en théologie pour saisir ces nuances-là…
C’est vrai. De même, Genèse 1 dit que Dieu crée l’homme et la femme à son image, «homme et femme il les créa», les deux sont donc à l’image de Dieu. Genèse 2 valorise plutôt l’homme, mais ce n’est pas si vrai quand on regarde de près le texte en hébreu. Ce que tu dis est tout à fait juste: les textes bibliques sont dangereux (j’aime bien cette expression) quand on ne les lit pas de manière avertie et c’est pourquoi on travaille théologiquement. Quand les étudiants me demandent pourquoi eux, qui veulent être pasteurs, doivent faire 5 ans d’études de théologie alors qu’ils pourraient bien prêcher, inspirés par le Saint-Esprit, tous mes poils se hérissent ! Je leur réponds: précisément parce qu’il faut apprendre à lire les textes et que nous devons être avertis quand nous les lisons, nous les théologiens avons une certaine responsabilité. Que ce soit dans les Églises ou dans nos discussions, on ne peut pas laisser passer ces stéréotypes, même si les Églises ne sont pas toujours parvenues à le faire – c’est bien pour ça que nous sommes des garde-fous.
À ce propos, il y a deux autres stéréotypes dont tu parles dans ton livre: la femme définie par son corps et le fait que la femme soit l’aide de l’homme, complémente l’homme. Tu travailles donc aussi dans ce livre à nous dégager de ces stéréotypes hérités de l’histoire de l’Église.
Théoriquement, la complémentarité est une très belle chose quand elle s’accompagne d’une pleine reconnaissance mutuelle, mais elle peut devenir un piège lorsque la complémentarité est comprise au sens de «Je ne fais que compléter» ou «J’apporte de l’aide à quelqu’un qui fait vraiment son travail». C’est aussi quelque chose de très noble d’être aide de l’autre mais à partir du moment où on le comprend véritablement comme quelque chose qui a de la valeur, et l’enjeu est pour moi de savoir quelle valeur on attribue. Un chemin énorme a tout de même été parcouru, en tout cas dans un certain nombre de pays, pour montrer ces enjeux-là. Moi, je suis une féministe partenariale, c’est-à-dire que je n’ai jamais voulu attaquer de front les institutions. J’ai toujours été convaincue (et c’est peut-être une erreur aux yeux de la jeune génération qui trouvera cela beaucoup trop soft) que c’est par la qualité qu’on arrive à convaincre, par la transformation des esprits, par l’engagement, par le fait de vivre tout simplement ce qu’on a à vivre. Ce n’est pas une voie que j’ai prise par choix, c’était simplement celle de mon caractère: je pense qu’on peut modifier les choses, en les accompagnant évidemment de conscientisation.
J’y vois une sorte de parallèle avec ce retour à la maison du fils prodigue ou de la fille prodigue dont tu parlais, et qui m’a beaucoup touché aussi. Dans ton travail, il y a toujours la réconciliation en filigrane: à travers cet exil, tu invites en quelque sorte les femmes à devenir féministes (et cela vaut aussi pour les hommes, d’ailleurs) une fois établie la prise de conscience des stéréotypes et des conditionnements pour les femmes, et peut-être pour les hommes de leur part de responsabilité. C’est au cœur même des luttes et des débats actuels, sociétalement: comment se réintégrer, comment revenir dans la maison du père, comment se réinsérer dans une Église, une institution qui peut-être a bougé mais qui reste quand même très patriarcale et qui, tu le mentionnais tout à l’heure, est de plus en plus désorganisée. Avec toutes ces Églises libres qui apparaissent, il est difficile de travailler de manière commune pour faire avancer la cause des femmes. Comment, une fois qu’on a pris conscience des choses et qu’on a changé, se réintégrer – la grande tentation serait de partir et je sais que ce n’est pas le cœur de ta démarche.
Absolument. La tentation est grande effectivement, surtout en protestantisme, de dire que parce que telle Église ne me plaît pas, j’en change… voire je fonde ma propre Église. Pour moi, il faut savoir supporter, comme dans une famille où tout n’est pas toujours rose mais où on traverse les moments difficiles en attendant les beaux jours parce qu’on aime les personnes. J’ai voulu supporter mon Église, au sens de soutenir, et je ne l’ai jamais quittée bien qu’il y ait parfois des choses qui m’énervent prodigieusement. Je pense qu’aucune Église n’échappe au fait que ses membres sont quelquefois vraiment excédés par des décisions, des orientations, des insuffisances ou des détours. Je supporte donc mon Église d’origine, d’Alsace-Moselle, aujourd’hui unie avec les réformés, et je lui reste fidèle. Je la soutiens car je vois bien qu’aucune orientation ni aucune décision n’est simple, il y a toujours des ambivalences et des difficultés dans toutes les orientations qui sont prises.
«Il y a actuellement un déséquilibre; un grand poids repose sur les épaules des femmes»
Institutionnellement et historiquement, le patriarcat est quand même assez marqué au sein des Églises. Il y a ce qu’on supporte mais, quand on se rend compte que d’un point de vue systémique et historique, cette idéologie est quand même très présente alors même que les choses ont commencé à changer… le niveau de ce qu’on est prêt à accepter est peut-être réduit. Quand on se rend compte que l’institution est tellement plus grande que nous, il est dur au niveau personnel de se dire qu’on ne pourra pas changer les choses. Comment se réintégrer dans une Église locale ou à plus grande échelle quand on est conscient du travail qu’il reste à faire?
Je reçois très souvent des mails de femmes en train de quitter leur Église pour ces raisons-là, parce qu’elles ne supportent plus cette situation. Je le comprends parfaitement et je ne leur recommande pas de rester. Je pense qu’effectivement, il y a des situations ou des vécus qui sont tout simplement impossibles à endurer et ce qui est important, en tout cas dans les Églises où je suis, c’est de voir aussi les efforts qu’ont fait les institutions pour permettre une place valorisée aux femmes, un travail partenarial et puis des développements de plus grandes possibilités pour les femmes. C’est même parfois beaucoup puisqu’on donne de grandes responsabilités aux femmes: elles sont fréquemment chargées, même dans les Églises, de prendre des postes de grande envergure, des postes de direction. Ici, dans les Églises réformées suisses, de nombreuses femmes président des Églises ou des synodes, d’autres, en France, sont présidentes de région ou (dans mon Église) inspectrices, avec une responsabilité supra-locale. Ces avancées sont évidemment à valoriser, même s’il y a actuellement un déséquilibre et qu’un grand poids repose sur les épaules des femmes, mais c’est un passage nécessaire.
J’ai récemment reçu un mail du Canada: une femme m’expliquant qu’elle est aumônier dans un hôpital et qu’elle ne peut pas donner le sacrement ni même faire de prières avec les personnes en tant que célébrante. Je lui ai répondu que puisqu’elle est sûrement catholique, elle ne peut pas, de fait, accéder comme laïque à ces missions. Mais elle n’est pas du tout catholique !… Elle fait partie d’une communauté de type missionnel indépendante qui interdit aux femmes de prier publiquement, de mener la prière, de célébrer la Sainte-Cène… Elle qui accompagne quotidiennement des personnes se retrouve dans cette posture où elle n’a pas le droit… Elle n’a pas le droit non plus d’intervenir dans le culte de son Église, m’a-t-elle écrit, bien qu’elle soit la plus avertie théologiquement, étant la seule à avoir fait des études de théologie. Je lui ai conseillé de partir au plus vite parce qu’il n’y a vraiment aucun espoir. Je ne sais pas ce qu’elle va faire, mais quand elle me l’a demandé, je lui ai dit que ce n’était pas normal dans une communauté protestante. Elle n’a donc pas vraiment de connaissance au-delà de son Église et a peut-être été formée par son Église elle-même plutôt que par une Faculté de théologie. En tout cas, la formation qu’elle a reçue ne lui permettait pas de juger si son cas était commun à toutes les Églises protestantes, ce qui est ahurissant.
Et le travail de réconciliation, par la suite, sera difficile.
Absolument. J’ai aussi dans le passé rencontré une femme formidable à Strasbourg, qui est venue à la formation théologique que je dirigeais à la Faculté. Elle venait d’une communauté qu’elle avait choisie, une communauté de lecture biblique très-très littéraliste et ne comprenait pas – elle n’avait pas encore à l’époque les compétences théologiques pour analyser – qu’on puisse dire à partir de Jésus-Christ et des évangiles que les femmes n’ont pas le droit de faire ceci ou cela dans la communauté, ou même que les croyants ordinaires doivent obéir à telle ou telle consigne. Je lui ai répondu que ce n’était pas ça et qu’il fallait qu’elle vienne se former, ce qu’elle a fait. C’est une femme extraordinaire, elle a suivi des formations et elle est aujourd’hui en mesure d’expliquer toutes ces choses à énormément de personnes avec ses mots, avec son expérience.
Donc, si je devais résumer l’idée, c’est: Partez, transformez-vous, formez-vous si besoin, et, si possible, revenez œuvrer au sein même de l’Église ?
Oui, cela en vaut la peine parce que nous avons des sources chrétiennes dans nos traditions, quelles qu’elles soient, et je crois que toutes les Églises ont des dons à faire fructifier avec les personnes en recherche. Si une personne se sent mieux dans une communauté de type évangélique, à partir du moment où elle sent qu’elle y est bien, il faut rester. Mais il faut aussi quand même se former et de manière non idéologique. C’est difficile, je sais, mais il faudrait pour commencer qu’on nous apprenne à travailler dans les langues bibliques, qu’on nous apprenne à comprendre les contextes de l’époque, même si après on les relativise, qu’il y ait cette formation de base nécessaire.
Quand l’apôtre Paul écrit des lettres à des communautés, on ne peut pas dire qu’il a écrit une théologie pour l’éternité, il faut dire très objectivement qu’il a répondu à son époque à des questions de son temps. Pour lui, c’était la fin des temps et le Christ allait venir rapidement. Et comme cela dure, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que tout Paul, dans chacune de ses lignes, est une somme théologique pour l’éternité. Il faut apprendre à distinguer ce que lui-même dans le texte distingue: «Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le Seigneur»; ou au contraire: «Ce n’est pas le Seigneur qui le dit, c’est moi» (1 Corinthiens 7,10 et 12). Et on peut alors être un peu plus circonspect car cela reste un homme, même si c’est notre apôtre fondateur, qui écrit à une époque donnée.
«Un clin d’oeil à la Woman’s Bible de 1895»
De même, il faut prendre en compte les connaissances scientifiques du temps. Nous avons tenté cette expérience de valoriser les connaissances des femmes contemporaines, avec Lauriane Savoy, qui a été mon assistante, et avec une collègue québécoise catholique, Pierrette Daviau, et avons décidé d’écrire Une bible des femmes. (2). Nous avons tout simplement voulu, presque comme un coup de cœur et non comme un vaste projet grandement préparé, avec 21 femmes universitaires compétentes dans les Écritures, montrer que les textes bibliques ont bien plus de ressources que nos stéréotypes sur les femmes et sur les hommes et qu’on pouvait trouver même dans des textes bibliques considérés comme perdus à la cause des femmes des ressources pour aujourd’hui. Dans ce livre, nous avons abordé des questions existentielles, nous n’avons pas écrit une nouvelle Bible mais avons commenté des textes pour montrer les ressources. Il est vrai que ce ne sont que des échantillons et on pourra nous dire que c’est partiel, qu’on n’a pas choisi les textes les plus difficiles ni les plus horribles, ce qui est vrai: nous avons choisi des textes ayant des potentialités mais, surtout, nous avons voulu montrer comment ils peuvent être détournés, accommodés, dévalorisés.
(2). Nous avons tout simplement voulu, presque comme un coup de cœur et non comme un vaste projet grandement préparé, avec 21 femmes universitaires compétentes dans les Écritures, montrer que les textes bibliques ont bien plus de ressources que nos stéréotypes sur les femmes et sur les hommes et qu’on pouvait trouver même dans des textes bibliques considérés comme perdus à la cause des femmes des ressources pour aujourd’hui. Dans ce livre, nous avons abordé des questions existentielles, nous n’avons pas écrit une nouvelle Bible mais avons commenté des textes pour montrer les ressources. Il est vrai que ce ne sont que des échantillons et on pourra nous dire que c’est partiel, qu’on n’a pas choisi les textes les plus difficiles ni les plus horribles, ce qui est vrai: nous avons choisi des textes ayant des potentialités mais, surtout, nous avons voulu montrer comment ils peuvent être détournés, accommodés, dévalorisés.
Je crois que c’est un livre qui a été très bien accueilli.
Il a été publié pendant la période #MeToo, ce qu’on n’avait évidemment pas du tout prévu. Cela a suscité l’intérêt des médias, ce qui nous a aidé, et cet intérêt a permis de parler de la Bible, pour une fois. Beaucoup de journalistes nous ont dit que, finalement, ils ne connaissaient pas les textes bibliques à part quelques grands stéréotypes et certaines sélections de phrases. Nous avons notamment traité du stéréotype de Marie pour les catholiques – je veux dire par-là qu’il y a la figure de Marie dans les Écritures et la figure de Marie dans l’Église et ce que la doctrine de l’Église catholique en a fait, bien que derrière cette doctrine se trouvent de belles choses. Nous avons essayé de le faire de manière vivante dans des tandems de femmes qui ont travaillé sur diverses questions.
Une bible des femmes est un clin d’œil à la Woman’s Bible de 1895 dans laquelle Elizabeth Cady Stanton (encore une Élisabeth!) avait réuni un comité de 20 femmes qui voulaient retravailler de manière critique tous les textes bibliques parlant des femmes. En fait, ce sont un peu les ancêtres de l’historico-critique. Plutôt que de traduire la Woman’s Bible comme nous avions d’abord l’intention de le faire, Lauriane et moi, sur le conseil du directeur de Labor & Fides (d’abord Gabriel de Montmollin puis Matthieu Mégevand), avons décidé de faire quelque chose pour les femmes d’aujourd’hui. Nous avons ensuite voulu poursuivre avec Une Bible. Des hommes (3) – au sens d’une Bible écrite par des hommes (jusqu’à nouvel ordre, on n’a pas de preuve qu’il y aurait une rédactrice féminine) et où on trouve des hommes et non pas le masculin.
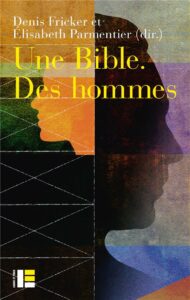
Il me semble que le livre a été moins bien reçu?
Oui, malheureusement nous sommes visiblement moins lues par les hommes qu’on ne l’a été par les femmes, même si les hommes ont aussi lu Une bible des femmes.
D’ailleurs, des hommes se sont plaints du fait qu’il n’y avait pas de livre leur étant consacré. Vous avez fait ce livre et pourtant le public n’était pas entièrement au rendez-vous!
Exact. Quelques hommes présents dans les conférences que nous faisions sur Une bible des femmes nous ont reproché d’avoir travaillé entre femmes, pour les femmes, et ont demandé ce qu’on avait à leur dire à eux, les hommes. Ils ne se reconnaissaient pas dans cette image très négative qu’on donne souvent d’eux, celle de prédateurs, etc. et se disaient maladroits mais acquis à la cause des femmes. Ils nous ont dit: «Mais, vous n’avez rien pour nous?». Un peu comme dans la bénédiction d’Isaac avec le pauvre Esaü qui demande à son père (après que Jacob se soit fait passer pour lui): «Mais, tu n’as plus de bénédiction pour moi?» (Genèse 27,36). Nous nous sommes donc dit qu’il fallait peut-être faire un livre différent, et c’est pour ça que nous avons créé des tandems homme-femme avec 20 auteurs. C’était des tandems qui, comme ceux du premier livre, étaient également de confessions et d’Églises différentes. Nous avons ainsi réuni des gens extraordinaires: Corina Combet-Galland, Simon Butticaz, mon collègue Jean-Daniel Macchi, et Denis Fricker, bien sûr, mon collègue de Strasbourg. Ces tandems de continents et de confessions différents ont traité des sujets très intéressants comme le Collège des douze, la masculinité de Samson dont il est livré une belle analyse, ou encore l’apôtre Paul à propos duquel on redécouvre, grâce au tandem Corina Combet-Galland-Simon Butticaz, que dans l’Épître aux Galates, il emploie un vocabulaire féminin (il dit qu’il doit «accoucher» des Galates; il est donc à la fois sage-femme et celle qui accouche).
Avec tout ce travail œcuménique et collectif, tu as dû gagner en perspective.
Tout à fait. Nous avons également débusqué quelques stéréotypes qui peuvent piéger. Par exemple, Denis Fricker et moi avons fait un chapitre sur l’idéal du ministre, de l’homme de Dieu. Pour le ministre catholique, c’est lui qui a fait la recherche tandis que j’ai parlé du pasteur protestant. L’idéal catholique, c’est l’homme qui est le médiateur entre Dieu et sa paroisse, le porteur des messages de Dieu, l’«homme du sacré», et puis celui qui a le pouvoir sacerdotal. Alors que de l’autre côté, on a en miroir inversé le père de famille nombreuse, le pasteur. On n’a jamais l’idéal du pasteur célibataire, il faut toujours le marier à quelqu’un !
Et qu’il ait quatre enfants minimum !…
Il doit avoir beaucoup d’enfants parce que, précisément, c’est l’image du berger de la paroisse ou du maître de la maisonnée.
C’est toujours aussi vrai aujourd’hui?
Oui, quand un pasteur arrive dans une paroisse, on se demande souvent s’il est célibataire ou non et, s’il est seul, on va l’inviter et lui trouver une femme. C’est un réflexe qu’on n’a absolument pas pour les pasteures femmes. Je n’ai jamais entendu: «On va lui trouver un homme» !… Parce que pour les pasteures femmes, il est normal de se consacrer exclusivement au travail de la paroisse.
Il s’est passé une sorte de retournement, non ? À une époque, on les imaginait comme femmes de pasteurs, elles ne pouvaient pas avoir accès à autre chose. Et aujourd’hui, on souhaite qu’elles se consacrent uniquement à leur travail…
C’est toujours un peu louche, on se demande si elles vont pouvoir s’occuper aussi de leur famille… En tout cas, nous avons simplement voulu montrer qu’il y a des stéréotypes inversés, mais qui relèvent de la même difficulté. À la source, il y a des extraits de passages bibliques: du côté catholique, la figure du prêtre représente le Christ et du côté protestant, c’est la figure du bon ministre idéal, tel qu’il doit être, homme, mari d’une seule femme, etc. Il représente dans sa vie cet idéal chrétien, il est le modèle de l’idéal chrétien. Le prêtre catholique aussi doit représenter un idéal chrétien, mais de manière inversée. C’est un peu ça, notre travail de théologien. Au fond nous ne sommes, comme je l’ai dit, que porte-paroles. C’est ainsi que je me perçois en premier lieu, dans ce domaine des relations hommes-femmes, bien que j’aie écrit des livres à mon nom et que j’aie aussi analysé des choses dans d’autres livres à titre personnel. Il faut continuer sur ce sujet à développer cette conscientisation et cet approfondissement.
La place des femmes dans les postures d’autorité a bien évolué, notamment en protestantisme, contrairement au catholicisme où ce n’est pas encore entièrement acquis. Mais il me semble qu’aujourd’hui, le vrai travail des théologiennes est de sortir d’une lecture biblique qui stéréotype les rôles des femmes.
C’est exactement ça. On reproche souvent aux femmes de vouloir le pouvoir, d’avoir l’autorité mais pour moi qui suis et ai été X fois en posture d’autorité institutionnelle – puisqu’on m’a toujours poussée dans ce sens – il est très difficile d’assumer cette posture de pouvoir en tant que femme.
Pourquoi?
Je ne sais pas trop comment l’expliquer. Personnellement, je travaille beaucoup plus spontanément en équipe. Il n’est pas évident de trancher, d’être critiquée (parce que, forcément, quand on tranche, il y a toujours le problème de la critique) et je pense que pour ma génération de femmes, ce n’est pas encore si évident. En ce qui me concerne, j’ai été particulièrement gâtée et je bénéficie d’un soutien extraordinaire. Ce n’est donc absolument pas un vécu, mais il y a quand même au fond de moi cette difficulté à prendre la posture de pouvoir et à trancher. Je le fais, mais cela me demande de me surmonter, ce qui veut dire qu’au moins pour ma génération, ce n’est pas une évidence, c’est intériorisé. Dire que les femmes veulent toujours des postures de pouvoir est en tout cas à mon sens totalement faux.
Je pense qu’il y a là aussi une question autour des rôles dont il faut savoir sortir. Pour moi, il est important de ne pas non plus me dire qu’il faut que je prenne telle posture parce que je suis une femme. Je voudrais aussi que les femmes aient le choix: si elles ne veulent ou ne peuvent pas assumer une fonction de pouvoir, qu’elles aient aussi la liberté de dire que ce n’est pas dans leur caractère, qu’elles sont faites pour autre chose, etc. Sortir des stéréotypes, donc, même quand on veut nous aider à avancer.
Je pense à cela parce qu’il y a aussi toute la discussion par rapport à la vie de famille. Est-ce qu’il faut aller travailler ou est-ce que on peut se prendre des années en tant que femme pour rester avec les enfants à la maison? Il y a maintenant une pression sociale, en tout cas en France, pour que les femmes travaillent et on est dévalorisées quand on prend la décision de rester. Moi je suis en faveur de ce choix, la difficulté étant qu’il faut l’assumer ensuite. Ma libération de femme, c’est d’avoir le choix, c’est ça qui est important.
Et sortir du conditionnement de l’injonction à la liberté du choix ?
Oui, parce que même l’injonction à aller travailler ou à faire carrière peut être une aliénation. Nous n’en sommes pas là mais je pense qu’il est important, pour le féminisme que je défends, de pouvoir dire qu’il n’y a pas de voie toute tracée parce qu’on est une femme et donc d’avoir le choix et d’assumer ce choix.
«C’est l’endurance et le simple fait de donner le meilleur de soi qui aide à avancer»
Pour terminer, qu’aimerais-tu dire aux femmes qui écouteront ton épisode ?
Peut-être, dans la continuité de ce que je viens de dire, d’oser être elles-mêmes, de bien se connaître, d’assumer leurs faiblesses et leurs forces, d’être autocritiques, de se demander ce qu’elles ont à apprendre des autres, comment pouvoir aussi apprendre avec les autres et des autres et, enfin, de tenir cette posture de vigilance et d’ouverture. Vigilance parce qu’il ne faut évidemment pas être naïve, mais à partir du moment où on en apprend davantage sur la vie, sur les autres et sur soi, on peut avoir une ouverture. Je crois qu’on se referme quand on a peur et je pense qu’il faut dépasser la peur. Et la peur peut être dépassée quand on a une meilleure connaissance. C’est un peu le leitmotiv de ma vie, au fond, dans le domaine où je suis de l’apprentissage permanent; j’apprends par les étudiants, par ce qu’ils vivent, par les autres générations et en même temps par mon expérience de vie. Apprendre en permanence, c’est ça le secret.
Et qu’aimerais-tu dire aux hommes qui t’écoutent?
Eh bien, peut-être la même chose! En tout cas, c’est difficile d’être un homme aujourd’hui, je pense en particulier aux jeunes générations. J’ai des fils et je vois aussi la difficulté d’être un homme jeune avec peu de modèles de ce que peut être un homme conscientisé par la volonté de partenariat. Mais je vois qu’ils ont une sincère volonté et un sincère engagement pour un vrai partenariat, ce qui est très bien. C’est la bonne voie et je pense qu’il faut résister, peut-être, à certaines formes de radicalité. La radicalité, c’est très difficile, parce que quand on est radical ou qu’on se heurte au radical, on se referme parce qu’on se protège. Je pense que c’est davantage l’endurance et le simple fait de donner le meilleur de soi qui aide à avancer, plus que de se radicaliser.
Qu’évoque pour toi le mot protestante ?
Je n’ai jamais tellement aimé le mot protestante. Je préfère dire issue de la Réforme ou venant de la Réformation. Protestant vient en fait, non pas de la protestation mais de la confession de foi. Alors si c’est rattaché à une confession, à la foi… je veux bien parler de protestante. Mais protester, tout dépend pourquoi et comment. Je veux bien protester au sens d’attester de, que ce soit constructif.
C’est d’ailleurs le sens premier, il me semble.
Exactement. Attester pour ou parler en faveur de ou pour. Je dirais que ça me rejoint plus que de protester sans qu’il y ait un autre terme derrière. Alors, protester… en faveur de quoi ?
Transcription: Pauline Dorémus
Illustration : portrait d’Élisabeth Parmentier par LaMèreVeille, 20 mai 2019 (Source Wikimedia Commons CC-BY-SA-4.0).
(1) Élisabeth Parmentier, Les filles prodigues, Défis des théologies féministes, Labor et Fides (Lieux théologiques 32), 1998.
(2) Élisabeth Parmentier, Pierrette Daviau et Lauriane Savoy (dir.), Une bible des femmes, Labor et Fides, 2018.
(3) Denis Fricker et Élisabeth Parmentier (dir.), Une Bible. Des hommes, Labor et Fides, 2021.







