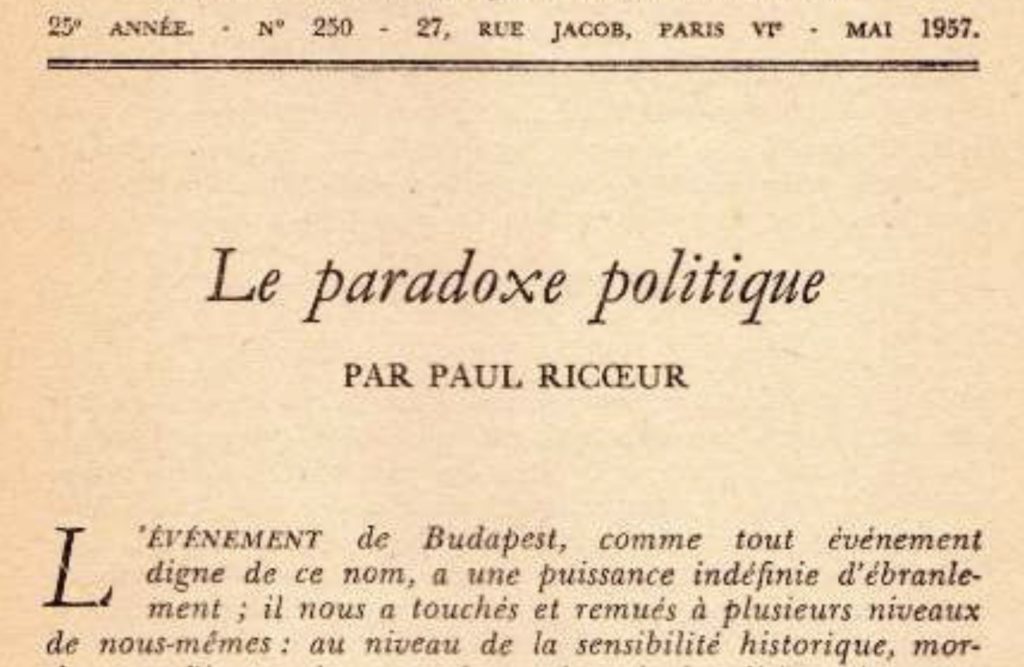Les paradoxes politiques de la laïcité: 3. Recommencer avec Ricœur
Après cette plongée pour trouver et reprendre appui dans le passé, nous voudrions maintenant revenir à notre époque, à partir de quelques citations et réflexions de Ricœur, sur la laïcité, mais aussi sur les paradoxes du politique et du théologico-politique (1).
Troisième et dernier volet de l’article ‘De Bayle à Ricœur, les paradoxes politiques de la laïcité’, dans le dossier Protestantisme et laïcité: une histoire à reprendre du numéro 2020/4 de Foi&Vie. Voir les premier et deuxième volets sur notre site.
Le protestantisme de Paul Ricœur
Il faut commencer par rappeler l’attachement de Ricœur à ce vieux protestantisme français qui fut longtemps militant de la liberté, des Lumières, de la République, de la laïcité, de la modernité. Ricœur a mis du temps à comprendre qu’il était, dans les mentalités de l’intelligentsia française des années 60 et 70, enfermé dans le même sac non seulement que le catholicisme de gauche, mais que le catholicisme pétainiste! Il a eu beau annoncer son rigoureux et méthodique agnosticisme de philosophe, militer pour une philosophie kantienne des limites, proposer une longue et profonde déconstruction des grands dogmes, celui du mythe de la peine (punition) à propos du mal, celui de l’impuissance et de l’incapacité humaines, celui du sacrifice expiatoire et du pardon, celui de la résurrection (et de l’espérance d’un au-delà) à propos de la vie, etc., bref aller bien plus loin que la plupart des philosophes français contemporains dans sa critique effective des constructions théologiques, il a longtemps été soupçonné (par ceux qui jamais n’ont soupçonné leur propre théologie implicite (2)) de présupposer une théologie clandestine.
À l’encontre des évolutions massives de sa génération, Ricœur est resté protestant, pour de nombreux motifs, dont il a explicité certains. L’un d’eux est proprement philosophique, c’est qu’en dépit de son ambition phénoménologique initiale, il découvre vite l’impossibilité d’accéder à un commencement absolu, pur, radical: on survient «au beau milieu d’une conversation» déjà engagée (3). Tout ce que l’on peut, à partir du hasard d’être né quelque part, c’est le porter au plan d’une affirmation qui a traversé le soupçon, ou pour le dire autrement d’une conviction élargie par la critique, au point de se savoir parmi d’autres. C’est ce que Ricœur appelle l’attestation. C’est aussi que, comme l’écrivait Ricœur à la fin des années 50, «pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi» (4). Dans un texte de 1946, il écrivait: «J’appartiens à ma civilisation comme je suis lié à mon corps. Je suis en-situation-de-civilisation et il ne dépend pas plus de moi d’avoir une autre histoire que d’avoir un autre corps» (5). Quel est ce soi capable de rencontrer d’autres soi? C’est bien le soi de l’attestation qui est ici convoqué: l’attestation qui dit «me voici, ici je me tiens, je ne puis autrement» répond au soupçon, mais «le soupçon est aussi le chemin vers et la traversée dans l’attestation. Il hante l’attestation comme le faux témoignage hante le témoignage vrai» (6). C’est pourquoi Ricœur tient autant à ce qu’il appelle «l’unité profonde de l’attestation de soi et de l’injonction venue de l’autre» (7).
Enfin le sujet de l’attestation est un sujet pluriel, un nous. Comme Ricœur l’écrivait pour cette conférence à Amiens en 1967, «Je ne crois pas que le sujet de la foi puisse être un individu, le sujet de la foi n’est pas ‘je’ mais ‘nous’ (…). C’est que l’interprétation ne peut être qu’un segment de la tradition, c’est-à-dire de la transmission du message dans l’histoire d’une communauté. La parole ne suscite l’homme que si elle continue d’être transmise. C’est pourquoi la prédication ne peut être entendue qu’à plusieurs» (8). Car le soi de l’attestation sera pour Ricœur un «soi au miroir des Écritures», un soi diffracté et rendu capable, instruit et constitué par un tissu de lectures hétérogènes. Ce sera aussi un «soi mandaté», répondant à un appel qui lui échappe toujours (9). C’est donc un sujet pluriel, un nous, et non le sujet individuel présupposé par un certain libéralisme, mais plus globalement par le conformisme contemporain.
La laïcité selon Ricœur
Ces quelques éléments de présentation ainsi disposés, nous pouvons en venir à la question laïque, qui était également une question disputée dans les années 50 pendant ce qu’on a appelé la guerre des écoles (entre l’école publique et l’école libre). Or c’est précisément pendant ce temps-là que, durant 10 ans, Ricœur a été président de la Fédération protestante de l’enseignement. Cette Fédération, traditionnellement ancrée dans l’Éducation publique, à laquelle les écoles protestantes s’étaient ralliées dès le début de l’enseignement laïque, ne voulait cependant pas s’interdire la liberté de lieux d’enseignement plus libres, plus exploratoires aussi d’un point de vue pédagogique, comme c’était alors le cas au Collège Cévenol où Ricœur avait enseigné la philosophie pendant trois ans. Elle était donc prise entre l’arbre et l’écorce dans ce conflit récurrent.
C’est sur le cas exemplaire de l’école que Ricœur réfléchit à la condition mixte qui l’intéresse dans la laïcité elle-même. L’école, dit-il, «se trouve dans une position mitoyenne, entre l’État, dont elle est une expression en tant que service public – à cet égard, elle doit comporter l’élément d’abstention qui lui est propre –, et la société civile, qui l’investit de l’une de ses fonctions les plus importantes : l’éducation». C’est cette intersection qui signifie pour Ricœur la condition laïque, à la croisée de deux logiques complémentaires.
D’un côté, on a la laïcité de l’État comprise comme neutralité, comme une laïcité d’abstention: «L’État ne reconnaît, ni ne subventionne aucun culte. Il s’agit là du négatif de la liberté religieuse dont le prix est que l’État, lui, n’a pas de religion. Cela va même plus loin, cela veut dire que l’État ne «pense» pas, qu’il n’est ni religieux ni athée; on est en présence d’un agnosticisme institutionnel» (10). En ce sens, un peu comme chez Bayle, non seulement l’État n’impose pas une religion officielle, mais il empêche quelque religion que ce soit, même majoritaire, d’imposer sa loi aux autres. L’État est garant du vide central, d’une neutralité protectrice de la pluralité des conceptions religieuses et morales en présence.
De l’autre côté, on a la laïcité de la société civile, comprise comme une laïcité de confrontation, et que Ricœur décrit comme une «laïcité dynamique, active, polémique, dont l’esprit est lié à celui de la discussion publique». Il poursuit: «La laïcité me paraît être définie par la qualité de la discussion publique, c’est-à-dire par la reconnaissance mutuelle du droit de s’exprimer; mais plus encore, par l’acceptabilité des arguments des autres». Ou encore: «Une société pluraliste repose non seulement sur le consensus par recoupement, qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais sur l’acceptation du fait qu’il y a des différends non solubles» (11). En ce sens, l’État n’est pas là pour faire taire cette conversation ou cette discussion, mais pour en favoriser l’intelligence et la bienveillance.
Mais aussi la conviction religieuse doit exercer de l’extérieur une fonction de résistance aux abus du pouvoir, et vient abattre les prétentions religieuses des États (comme des Églises jadis, et aujourd’hui du Marché compris comme une religion) lorsqu’ils prétendent atteindre à l’absolu, à la totalisation de l’espérance.
Pour bien comprendre la démarche de Ricœur dans ce qui va suivre, il faut noter que pour lui l’État et l’Église, en tant qu’«institutions de la totalisation», peuvent, alternativement ou ensemble, générer des formes totalitaires: «Le mal naît sur la voie de la totalisation, il n’apparaît que dans une pathologie de l’espérance, comme la perversion inhérente à la problématique de l’accomplissement et de la totalisation» (12). Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas que la théologie se mêle de politique: pour lui comme pour son ami André Philip (13), mais aussi pour toute cette génération où s’est constituée la Cimade, une certaine conviction religieuse peut animer de l’intérieur l’orientation du politique: «Je dirai même que l’incorporation tenace, pas à pas, d’un degré supplémentaire de compassion et de générosité dans tous nos codes – code pénal et code de justice sociale – constitue une tâche parfaitement raisonnable, bien que difficile et interminable» (14). Mais aussi la conviction religieuse doit exercer de l’extérieur une fonction de résistance aux abus du pouvoir, et vient abattre les prétentions religieuses des États (comme des Églises jadis, et aujourd’hui du Marché compris comme une religion) lorsqu’ils prétendent atteindre à l’absolu, à la totalisation de l’espérance (15). La théologie exerce alors une fonction politique de détotalisation, de désabsolutisation.
Ricœur et le paradoxe politique : institution et résistance
Le thème du «paradoxe politique» dévoile dans le politique une sorte de disproportion, ou un caractère constitutivement bancal, qui a pris dans les écrits de Ricœur plusieurs formes successives. Attardons-nous d’abord sur l’article paru dans la revue Esprit en mai 1957, après l’événement de Budapest, intitulé ‘Le paradoxe politique’ (16), et qui demande de penser ensemble la rationalité et l’irrationalité du politique.
«Rationalité spécifique, mal spécifique, telle est la double et paradoxale originalité du politique. La tâche de la philosophie politique est, à mon sens, d’expliciter cette originalité et d’en élucider le paradoxe; car le mal politique ne peut pousser que sur la rationalité spécifique du politique» (17).
Penser la rationalité et l’irrationalité spécifiques du politique suppose d’en penser l’autonomie:
«Cette autonomie du politique me paraît tenir en deux traits contrastés. D’un côté le politique réalise un rapport humain qui n’est pas réductible aux conflits des classes (…). D’autre part, la politique développe des maux spécifiques, qui sont précisément maux politiques, maux du pouvoir politique; ces maux ne sont pas réductibles à d’autres, en particulier à l’aliénation économique. Par conséquent l’exploitation économique peut disparaître et le mal politique persister» (18).
Ricœur discerne ainsi deux grandes traditions de la pensée politique: l’une qui fait crédit à la visée bonne du politique et qui cherche à en fonder de l’intérieur la rationalité, l’autre qui insiste sur les passions mauvaises du pouvoir et qui cherche à résister de l’extérieur à ses abus:
«Il faut résister à la tentation d’opposer deux styles de réflexion politique, l’un qui majorerait la rationalité du politique, avec Aristote, Rousseau, Hegel, l’autre qui mettrait l’accent sur la violence et le mensonge du pouvoir, selon la critique platonicienne du tyran, l’apologie machiavélienne du prince et la critique marxiste de l’aliénation politique (…). Il faut tenir ce paradoxe, que le plus grand mal adhère à la plus grande rationalité, qu’il y a une aliénation politique parce que le politique est relativement autonome» (19).
On a vu chez Bayle une tension analogue entre un certain optimisme politique des effets de la tolérance religieuse, comme on trouve diversement chez Bodin ou Milton, et un certain pessimisme politique qui nous rejette dans les bras d’un certain absolutisme, par crainte des guerres civiles, version Machiavel ou Hobbes. À lire Bayle, les deux côtés de la balance ne cessent de trouver des renforts sans que l’un puisse jamais l’emporter sur l’autre. On peut bien dire, pour revenir vers nous, que la première tradition est la tige d’une conception démocratique de la laïcité, et la seconde la tige d’une conception républicaine.
«Le problème central de la politique c’est la liberté; soit que l’État fonde la liberté par sa rationalité, soit que la liberté limite les passions du pouvoir par sa résistance.»
Les deux traditions se composent et se corrigent mutuellement. Pour Ricœur, il n’y a pleinement démocratie (dans un sens très général ici) que si l’on peut, «en même temps», soutenir de l’intérieur les principales orientations du gouvernement, et garder une capacité critique à l’égard des abus du pouvoir. D’où un éloge politique de la liberté, sous la double forme de l’institution du droit et d’une morale de la résistance, que Ricœur refuse de dissocier:
«Si le terme de ‘libéralisme politique’ pouvait être sauvé du discrédit où l’a plongé la proximité avec le libéralisme économique, il dirait assez bien ce qui doit être dit : que le problème central de la politique c’est la liberté; soit que l’État fonde la liberté par sa rationalité, soit que la liberté limite les passions du pouvoir par sa résistance» (20).
Le paradoxe théologico-politique de l’autorité
Ce premier paradoxe politique est enrichi d’un nouveau paradigme au travers de la lecture que Ricœur propose de Hannah Arendt. C’est d’abord l’idée positive que le pouvoir n’est pas la violence, mais un pouvoir ensemble qui exprime un vouloir-vivre ensemble: «Il est peut-être raisonnable d’accorder à ce vouloir vivre ensemble le statut de l’oublié. C’est pourquoi ce fondamental constitutif ne se laisse discerner que dans ses irruptions discontinues au plus vif de l’histoire sur la scène politique» (21). Dans le même temps, et c’est la face d’ombre et d’irrationnel du politique, «il nous suffit que l’État réputé le plus juste, le plus démocratique, le plus libéral, se révèle comme la synthèse de la légitimité et de la violence, c’est-à-dire comme pouvoir moral d’exiger et pouvoir physique de contraindre» (22).
Il y a ici une hauteur, une profondeur, et pour tout dire une verticalité, qui dit à la fois la violence qui s’impose par sa brutalité, négativement, et l’autorité qui ne saurait s’imposer et n’existe que dans la mesure où elle est reconnue, positivement. On doit donc tenir avec Hannah Arendt «la distinction ferme et constante entre pouvoir et violence» (23), mais aussi entre pouvoir et autorité, entre lien horizontal et lien vertical: seul un lien vertical reconnu pouvant contrebalancer, sans l’éliminer, un lien vertical imposé par la force (24). Cette dimension verticale est la première forme prise par le théologico-politique, dans la pensée politique classique. Mais Ricœur refuse de penser cette dimension sur un mode seulement autoritaire, comme s’il n’y avait de verticalité que descendante, imposée, et jamais montante, reconnue.
Ricœur écrit:
«L’une des difficultés du problème français – et peut-être des pays latins en général – tient au fait que l’Église catholique a été, et demeure, de structure monarchique, et qu’elle constitue ainsi un modèle de politique autoritaire. De plus, ce serait une illusion de croire que le politique est définitivement quitte de toute référence au théologique: à la racine du politique, à son fondement, il y a l’énigme de l’origine de l’autorité. D’où vient-elle? C’est une chose qui est toujours non réglée, et qui fait que l’ombre ou le fantôme du théologique continue de rôder autour du politique. Par conséquent, pour fabriquer la laïcité telle qu’elle existe en France, il a fallu composer ensemble, dans un dialogue constructif, un modèle qui a cessé d’être monarchique dans le politique et un modèle qui l’est resté dans l’ecclésiastique. Le débat autour de l’école publique et privée gagnerait en clarté si on lui restituait ses références historiques» (25).
Au-delà de cette remise en perspective historique, qui permet de déconstruire un certain concept d’autorité, Ricœur cherche à montrer que l’on peut penser autrement le politique:
«La démocratie, dans la mesure où elle reste sous le signe du paradoxe, continue de bénéficier de la réalité de la transmission du pouvoir, et de la tradition de l’autorité. L’originalité démocratique se situerait alors dans les mesures prises pour gérer le politique autrement qu’en rapportant l’autorité à une onction religieuse» (26).
Mais pour cela, il faut réaliser, comme il le montre dans une conférence donnée à Robinson en 1996, et reprise récemment dans la revue Esprit en septembre 2019, que
«le renversement de la théologie politique est resté pour l’essentiel une révolution à l’intérieur du rapport de domination. Le peuple est mis à la place de Dieu, mais comme source de souveraineté, sans que soit remis fondamentalement en question le rapport entre le lien vertical de domination et le lien horizontal de coopération» (27).
Cette forme du théologico-politique dans la pensée politique française s’est sécularisée mais, loin de rompre avec lui, elle est restée captive du modèle ancien. Or on peut penser tout autrement le théologico-politique lui-même:
«La thèse que je veux soutenir est que la conception théologique du pouvoir qui est en train de mourir est presque exclusivement axée sur la prééminence du rapport de domination sur le rapport de coopération. Si tel est le cas, la fin du théologico-politique ne serait pas la catastrophe que les esprits antimodernes déplorent et que les post-modernes après Nietzsche et d’autres célèbrent» (28).
On peut ici souligner l’apport d’une théologie biblique de l’alliance à une philosophie politique du pacte, qu’il est possible de rompre, et donc à un théologico-politique plus horizontal, libre et égalitaire que le vieux modèle paternel et hiérarchique.
Le problème, c’est que l’État-Nation moderne, qui défend les droits individuels à l’encontre des communautarismes, est davantage issu d’un théologico-politique vertical, avec son incapacité foncière au pluralisme et sa faible tolérance aux minorités.
Mais ce modèle horizontal à son tour n’est pas la panacée: quand ce pouvoir devient démagogique, appuyé sur des majorités crédules, et quand la violence se déchaîne ou l’oppression se fait écrasante, à quelle autorité légitime et reconnue les plus faibles peuvent-ils faire appel? Quelle place politique est laissée aux minorités écrasées par une majorité véhémente, ou simplement conformiste? C’est ici que ces questions, déjà cruciales pour Bayle et restées d’actualité pour la pensée politique aujourd’hui, rouvrent avec Arendt et Ricœur la question de l’autorité comme instance de non-pouvoir, mais qui accorde ou refuse au pouvoir en place, au magistrat en exercice, son approbation, son augmentation, sa légitimité – et cette autorité de ceux qui sont en dehors de la course au pouvoir, et dont l’existence tient au seul fait d’être reconnue, est ce à quoi il peut être fait appel face à la brutalité du rapport de force écrasant.
Pour conclure ici aussi sur le croisement de ces deux modèles, vertical et horizontal, il vaudrait mieux comprendre, déconstruire et faire dialoguer les traditions théologico-politiques implicites à nos cultures (ou incultures) politiques, plutôt que les ignorer superbement, et nous laisser conduire en sous-main par eux. Le problème, c’est que l’État-Nation moderne, qui défend les droits individuels à l’encontre des communautarismes, est davantage issu d’un théologico-politique vertical, avec son incapacité foncière au pluralisme et sa faible tolérance aux minorités. D’un autre côté, la reconnaissance démocratique des libres attachements peut prendre la forme de liens communautaristes, éventuellement sectaires ou mafieux, très puissants dans le monde d’aujourd’hui.
Le paradoxe de l’englobé et de l’englobant
Enfin, ces deux formes du paradoxe politique ainsi tressées sont encore enrichies d’un troisième et dernier paradigme (29) au travers de la lecture que Ricœur propose de Michaël Walzer – que Ricœur avait opposé à Rawls pour montrer la difficulté à avantager les plus désavantagés étant donnée la diversité des sphères, économique, culturelle, juridique, familiale, etc. Ce troisième paradoxe consiste en ce que «le politique paraît constituer à la fois une sphère de la justice parmi les autres, et l’enveloppe de toutes les sphères» (30).
Ce paradoxe, remarqué par Ricœur également dans sa discussion des travaux de Luc Boltanski et Laurent Thévenot (31), pointe un principe de souveraineté qui régulerait les frontières entre les souverainetés. Le politique est-il une sphère parmi d’autres, ou bien l’instance régulatrice entre les sphères, la sphère des sphères? C’est une question très embarrassante car les deux figures ont leur justesse et leurs limites. Si ce n’est qu’une sphère parmi les autres, le politique ne saurait réguler l’économie ni aucune des autres sphères où se distribuent les grandeurs ou les avantages. Si c’est la sphère des sphères, cette éminence en dernière instance ne risque-t-elle pas d’être sans appel?
Or cette troisième forme du paradoxe politique nous donne la structure d’un troisième paradoxe de la laïcité, dans la mesure où celle-ci représente à la fois un cadre juridique neutre et englobant pour la diversité des traditions placées autour d’un vide central, et un puissant mouvement historique de pensée constituant l’une de ces traditions, issue des Lumières – une tradition qui se doit d’être exemplaire, dans sa façon de plaider la pluralité des convictions. Ici aussi, la question est embarrassante: la laïcité est-elle seulement un cadre formel, pragmatique et minimal, ou bien est-elle un récit commun et un principe substantiel? Est-elle un principe neutre de régulation entre les sphères, ou bien est-elle cette sphère éminente qui intègre et dissout la religion dans la politique devenue le seul sacré? Est-elle une institution, le cadre juridique qui limite l’empiètement mutuel des sphères, ou-bien est-elle une tradition qui définit l’identité même de la Nation?
Les confessions ont été désacralisées en perdant leurs prétentions absolutistes et exclusives, mais la religiosité humaine ayant besoin d’absolu, la laïcité elle-même peut tendre à devenir la religion de l’État, la religion civile, l’appareil idéologique chargé de dire la vérité absolue.
Ce qui serait inacceptable, ce serait une tradition de pensée qui prétendrait avec véhémence être garante à elle seule du vide central, et qui aurait ainsi le beurre et l’argent du beurre. Mais c’est précisément ici sans doute le point délicat: les confessions ont été désacralisées en perdant leurs prétentions absolutistes et exclusives, mais la religiosité humaine ayant besoin d’absolu, la laïcité elle-même peut tendre à devenir la religion de l’État, la religion civile, l’appareil idéologique chargé de dire la vérité absolue. La religion laïque, ce que l’on appelle le laïcisme, entre ainsi en conflit avec la constitution laïque: la première voudrait que la souveraine laïcité ait une autorité sacrée au-dessus de tous les partis; la seconde voudrait que l’on n’ait pas besoin de sacraliser la neutralité juridique qu’elle défend.
Si c’est la seconde option qui l’emporte, l’autorité de la laïcité tient à la reconnaissance mutuelle qu’elle autorise entre les différentes traditions, partis et confessions qui composent la société, mais c’est un pacte fragile, à la merci de la déloyauté de l’un ou l’autre d’entre eux. Si c’est la première option qui l’emporte, cela voudrait dire que Rousseau avait raison contre Bayle de dire que jamais État ne fut fondé sans que la religion ne lui servît de base. On peut pourtant penser que la pensée vive et difficile de Bayle est sur ce point plus actuelle que celle de Rousseau, ou du moins que cette discussion mérite d’être reprise soigneusement et à nouveaux frais.
Conclusions
Il est temps de conclure. Que la laïcité soit fragile, on le mesure au fait que des penseurs de la gauche républicaine puissent affirmer que Marine Le Pen soit seule à défendre la laïcité. On le mesure aussi au fait que bien des tenants de la laïcité réduisent la liberté de conscience à une liberté privée, celle du for intérieur ou du culte familial. Et même, là aussi, on voudrait arracher les enfants aux parents sectaires! Les promoteurs de la Révocation de l’Édit de Nantes n’ont rien fait d’autre. Si c’est le point où nous sommes rendus, Rousseau et Kant doivent se retourner dans leurs tombes, et voilà trois siècles de combats pour la liberté rendus inutiles.
Comment recommencer, à partir d’où? Ricœur discutant Habermas et l’idée d’une crise de légitimation écrivait au début des années 1990:
il faut «prendre une mesure plus relative de la forme de société qui est aujourd’hui l’objet d’une confiance minée. Après tout, cette forme de société n’est advenue en Occident qu’à une date relativement récente. Cette relativisation doit aller plus loin, me semble-t-il, qu’un retour à l’héritage de l’Aufklärung, simplement délivré de ses perversions; non que je conteste le propos de Habermas lorsqu’il déclare que le projet de l’Aufklärung est inachevé (…). Mais un retour au pur idéal de l’Aufklärung ne paraît plus aujourd’hui suffisant. Pour libérer cet héritage de ses perversions, il faut le relativiser, c’est-à-dire le replacer sur la trajectoire d’une plus longue histoire, enracinée d’une part dans la Torah hébraïque et l’Évangile de l’Église primitive, d’autre part dans l’éthique grecque des Vertus et la philosophie politique qui lui est appropriée. Autrement dit, il faut savoir faire mémoire de toutes les traditions qui se sont sédimentées sur leur socle. C’est dans la réactualisation d’héritages plus anciens que celui de l’Aufklärung – et aussi peu épuisés que ce dernier – que l’identité moderne peut trouver les correctifs appropriés aux effets pervers qui aujourd’hui défigurent les acquis irrécusables de cette même modernité» (32).
Si la modernité tient à ce pacte laïque qui autorise et intériorise la pluralité effective des sociétés séculières, il faudra bien que ce pacte soit placé sous la commune sauvegarde, en tenant compte de ces nouveaux venus que sont autant les générations nouvelles que les immigrants. En effet, les questions ici recroisées ont été posées mille fois, et pourtant elles méritent d’être réitérées de temps en temps, car le paysage évolue. Contrairement à ce qu’on croit, d’ailleurs, les problèmes ne sont jamais résolus; mais en s’entassant, ils s’éboulent parfois et les éboulements de problèmes forment de nouveaux problèmes, qui font oublier les anciens. Du même coup, il arrive que ce qui jadis était apparu comme une impasse soit soudain un passage ouvert.
Illustration: première parge de l’article ‘Le paradoxe politique’ par Paul Ricœur dans Esprit en mai 1957.
(1) Sur la pensée politique de Paul Ricœur, j’ai développé les grandes lignes de mes propos dans Paul Ricœur, la promesse et la règle, Paris, Michalon, 1996.
(2) Les intellectuels français ne mesurent pas à quel point ils sont le plus souvent des athées du catholicisme, ayant épousé en creux la forme de leur vieil ennemi, et ayant du mal à comprendre la possibilité d’autres athéismes.
(3) Paul Ricœur, Du texte à l’action, Seuil, 1986, p.48. Dans La philosophie de la volonté également, on voit le choix traversé et enveloppé par du non choix, de l’épaisseur, de l’opacité.
(4) Paul Ricœur, Histoire et vérité, Seuil, 1964, p.337.
(5) Paul Ricœur, ‘Le christianisme et la civilisation occidentale’, La revue du Christianisme Social, n°54 (1946).
(6) Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p.351.
(8) Paul Ricœur, Plaidoyer pour l’utopie ecclésiale, Labor et Fides 2016 (section I, §c).
(9) Paul Ricœur, Amour et Justice, (initialement édité à Tübingen, Mohr, 1990), Seuil, 2008.
(10) Paul Ricœur, La critique et la conviction, Calmann-Levy 1995, p.194.
(11) Paul Ricœur, La critique et la conviction, p.195.
(12) ‘La liberté selon l’espérance’, in Paul Ricœur, Le conflit des interprétations, Seuil, 1969, p.414.
(13) Député du Rhône pour le Front populaire, il prépare les lois sociales, la semaine de 40 heures, etc.
(14) Paul Ricœur, Amour et Justice, p.66.
(15) Paul Ricœur, Le conflit des interprétations, p.414.
(16) Paul Ricœur, ‘Le paradoxe politique’, Histoire et vérité, Seuil, 1964.
(17) Paul Ricœur, Histoire et vérité, p.261.
(20) Ibid., p.285. Cette polarité inspire encore, près de 40 ans plus tard, l’idée du «juste entre le bon et le légal» (Le Juste 1, Editions Esprit, 1995), et se retrouve peut-être dans la tension ou la disproportion entre éthique (visée du bon) et morale (limite mise au mal), qui constitue un paradoxe éthique aussi radical que le paradoxe politique.
(21) Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p.230.
(22) Paul Ricœur, Histoire et vérité, p.247.
(23) Paul Ricœur, Lectures I, Seuil (1991), Points essais, 1999, p.20.
(24) C’est aussi l’opposition entre la force et la forme dans Du texte à l’action, Seuil, 1986, p.399.
(25) Paul Ricœur, La critique et la conviction, Calmann-Levy, 1995, p.195.
(27) Paul Ricœur, ‘Le pouvoir politique : fin du théologico-politique ?’, Esprit, septembre 2019.
(29) On trouve ces trois niveaux de signification articulés dans La critique et la conviction, Calmann-Levy, 1995, pp.148-153.
(30) Paul Ricœur, Le Juste 1, Éditions Esprit, 1995, p.127.
(31) Cf. De la justification, les économies de la grandeur, Gallimard, 1991.
(32) Paul Ricœur, Lectures I, pp.170-175, Seuil (1991), Points essais, 1999.