«Black Church» (3): l’Église musique
Troisième partie d’une série de quatre épisodes portant sur Black Church, de l’esclavage à Black Lives Matter, d’Henry Louis Gates Jr, publié aux éditions Labor & Fides. Dans ce chapitre, la dimension artistique de l’ouvrage sera explorée, une occasion d’évoquer les Spirituals, le Gospel, l’importance de la musique dans l’expression de l’Église africaine-américaine ainsi que son apport à la musique contemporaine.
Écouter l’émission Solaé Le rendez-vous protestant (12 février 2023, présentée par Jean-Luc Gadreau et réalisée par Delphine Lemer).
Lire le premier volet: Black Church (1): l’Église matrice.
Lire le deuxième volet: Black Church (2): l’Église autre.
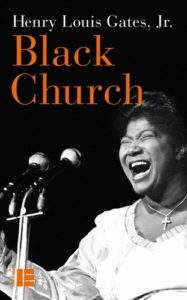 Jean-Luc Gadreau: Dans le cycle de nos quatre réflexions consacrées au livre Black Church, de l’esclavage à Black Lives Matter, nous abordons à présent la dimension artistique, qui est évidemment extrêmement présente dans le livre de Henry Louis Gates Jr. Philippe Gonzalez, maître d’enseignement et de recherche en sociologie à l’université de Lausanne, codirecteur avec Yannick Fer de la collection Enquêtes chez Labor et Fides dans laquelle est sortie Black Church, est à nouveau avec nous; il est en quelque sorte le fil rouge de ces quatre rendez-vous. Avec lui, trois artistes: un musicien, Samuel Colard, et deux chanteuses américaines, Theresa Thomason et Brenda Cline, tous les trois venant de finir une tournée de concerts en Suisse et en France, concerts en ligne directe avec Black Church car ils en reprenaient la playlist, c’est-à-dire quasiment toutes les chansons évoquées par Gates dans ses pages. Précisons que, Theresa et Brenda ne parlant pas français, c’est Samuel qui interviendra davantage, ainsi que Philippe Gonzalez. Samuel, pourriez-vous nous présenter ces deux merveilleuses artistes qui vous accompagnent?
Jean-Luc Gadreau: Dans le cycle de nos quatre réflexions consacrées au livre Black Church, de l’esclavage à Black Lives Matter, nous abordons à présent la dimension artistique, qui est évidemment extrêmement présente dans le livre de Henry Louis Gates Jr. Philippe Gonzalez, maître d’enseignement et de recherche en sociologie à l’université de Lausanne, codirecteur avec Yannick Fer de la collection Enquêtes chez Labor et Fides dans laquelle est sortie Black Church, est à nouveau avec nous; il est en quelque sorte le fil rouge de ces quatre rendez-vous. Avec lui, trois artistes: un musicien, Samuel Colard, et deux chanteuses américaines, Theresa Thomason et Brenda Cline, tous les trois venant de finir une tournée de concerts en Suisse et en France, concerts en ligne directe avec Black Church car ils en reprenaient la playlist, c’est-à-dire quasiment toutes les chansons évoquées par Gates dans ses pages. Précisons que, Theresa et Brenda ne parlant pas français, c’est Samuel qui interviendra davantage, ainsi que Philippe Gonzalez. Samuel, pourriez-vous nous présenter ces deux merveilleuses artistes qui vous accompagnent?
Samuel Colard: Theresa et Brenda sont deux sœurs qui ont grandi dans le New Jersey avec des parents originaires de Caroline et musiciens tous les deux, leur mère étant pianiste classique et leur père musicien de jazz. Ce dernier a également été pasteur pendant très longtemps dans le New Jersey. Aujourd’hui, Brenda habite une petite île magnifique dans les Îles Vierges britanniques et Theresa dans le Connecticut. Theresa a poursuivi une carrière de musicienne – elle est en tournée et en enregistrement depuis presque 30 ans – et Brenda est professeure de musique et d’art. J’ai eu la chance de connaître Theresa en 2009, la première fois où nous avons joué en France, et nous nous retrouvons désormais régulièrement pour une série de concerts.
Jean-Luc Gadreau: Et vous, vous êtes pianiste?
Samuel Colard: Je suis pianiste et j’ai longtemps été enseignant, en conservatoire. J’ai enseigné le jazz, la musique improvisée et les musiques actuelles.
Jean-Luc Gadreau: Comment s’est montée cette tournée et le programme qui a été proposé pendant ces concerts?
Samuel Colard: Cela s’est vraiment fait en lien avec la lecture de ce livre. En lisant les mots, on entend les musiques qui sont derrière et, forcément, il y a cette envie de matérialiser le livre pour les oreilles. J’ai trouvé super ce concept d’aborder la découverte d’un livre par un autre sens que celui de la vue et de la lecture! Et, ayant déjà travaillé avec Theresa et sachant que l’Église afro-américaine était son Église, sa culture, sachant aussi qu’elle et sa sœur Brenda portent magnifiquement toute la musique qui en est issue, il était naturel de leur demander de venir accompagner la bande-son du livre.
«Quelque chose de complètement novateur»
Jean-Luc Gadreau: Je voudrais, pour ouvrir notre discussion à propos de musique et de chanson, proposer plusieurs phrases extraites du livre Black Church:
«Le tambour et la danse sont les forces unificatrices des formes cultuelles noires exprimant l’adoration et l’exaltation, signifiant l’héritage et l’appartenance».
«Ces bardes noirs et inconnus (1), pour reprendre la magnifique expression de James Weldon Johnson, mettaient de leur propre chef la Bible en musique, et puis encore, dans les réunions de réveils, explique Murphy, il y avait des formats musicaux dans lesquels le leader chantait une première ligne que la congrégation reprenait en chœur, sans recueil d’hymnes, vous deviez suivre d’oreille. Les chants d’appels et de répons faisaient partie de leurs traditions africaines, il n’y avait là rien de nouveau pour les Noirs mais, en puisant dans cette tradition, ils créent leurs propres hymnes.»
Précisons que nous ne parlons là que de ce qui est décrit dans la toute première partie du livre Black Church, c’est-à-dire des spirituals et du début du gospel; nous verrons par la suite qu’avec le temps s’observe une évolution des styles, un renouveau artistique constant qui accompagne la société. Philipe Gonzalez, Samuel Colard, que peut-on dire de la place de la musique dans l’histoire de l’Église africaine-américaine?
Philippe Gonzalez: J’aimerais commencer par citer une phrase d’Antonín Dvořák. En visitant les États-Unis, le compositeur européen déclare que la musique afro-américaine est le seul véritable legs de la culture américaine à l’humanité. Il y a donc là quelque chose de complètement novateur, avec à la fois des formes rythmiques et des formes harmoniques – ce qu’on appelle la «gamme blues» et qui présente une modalité très particulière, en lien avec l’harmonie – qu’on va ensuite ressentir sur l’ensemble des formats musicaux inspirés par le gospel. Et puis, nous en parlions lors de l’épisode consacré à la spiritualité, il y a la place du corps qui est centrale ainsi que le rapport à un imaginaire biblique qui ne transite pas uniquement par du texte mais aussi par du chant, forme la plus pérenne de circulation d’idées théologiques, qui sont incorporées et qui vont même au-delà des prédications. Car la prédication, vous l‘entendez une fois, alors que le chant vous le chantez avec votre souffle et vous le chantez 1000 fois. En entendant Theresa et Brenda chanter, on voit combien leur chant impacte notre manière de respirer.
Jean-Luc Gadreau: Oui, il est évident que, physiquement, il se passe quelque chose. Samuel, vous qui êtes musicien – pianiste de jazz qui plus est – j’imagine que tout cela vous touche tout particulièrement?
Samuel Colard: Oui parce que je suis entré dans cette culture africaine-américaine par le jazz et que, nécessairement, j’ai creusé les racines de ces musiques-là, je me suis intéressé à l’origine de ces sons. Une chose très intéressante et propre à la culture africaine-américaine est que, durant la traite des esclaves, il y a eu sur le sol des États-Unis une attention particulière à séparer les groupes ethniques et les groupes sociaux qui venaient par bateau, afin de prévenir tout mouvement de révolte. Ce n’est pas ce qui s’est passé à Cuba ou au Brésil où, du coup, les traditions africaines ont pu être transmises, avec beaucoup de codes qui ont perduré assez naturellement et une transmission très consciente. Aux États-Unis, en revanche, on va se retrouver avec une diversité de langues, d’ethnies…
On assiste de ce fait, si on considère que la musique est un langage, à un vrai processus de créolisation: à partir de racines culturelles beaucoup moins conscientes mais très présentes, on va reconstruire des éléments de grammaire ou de vocabulaire nouveaux, souvent imposés par les personnes dominantes. Cela va être, par exemple, l’introduction progressive de l’harmonie, de la polyphonie harmonique ou d’autres aspects de ce genre, notamment la gamme, celle du piano, qui est bien rangée en 12 intervalles égaux. Philippe parlait tout à l’heure des blue notes; on les doit notamment au travail magnifique de l’ethnomusicologue Alan Lomax qui a pu dans les années 1930 enregistrer au sein de pénitenciers des chants qu’il pensait être préservés d’influences de la radio ou du disque naissants. On entend à ce moment-là qu’il existe une vraie originalité de la gamme. Et pour revenir sur ce processus de créolisation: à partir d’une grammaire, on va avoir une nouvelle grammaire, la construction d’un nouveau langage tout à fait particulier au sol américain. Et ce langage va avoir une portée universelle car il intègre des éléments fondamentaux des musiques européennes à cette culture profondément ancrée, mais beaucoup moins conscientisée que sur des territoires comme Cuba ou le Brésil. Du coup, cela touche forcément beaucoup d’entre nous.
Jean-Luc Gadreau: Et cette musique émanant de l’Église africaine-américaine, Theresa et Brenda, qu’auriez-vous envie de nous en dire?
Theresa Thomason: J’aimerais dire que cette musique me rappelle les Écritures. C’est un vrai fondement auquel je me nourris et dans lequel je trouve une force nouvelle. Quand on chante, c’est vraiment une manière de se libérer de toutes les pressions et aussi de se connecter avec la joie du monde.
Brenda Cline: Je crois que l’esprit, dans cette musique, et aussi la variété des mélodies, ont démarré quelque part dans le Sud profond des États-Unis. Ce qui est venu d’Afrique a ensuite été modelé dans les baraquements dans lesquels se rassemblaient les esclaves et où ils priaient. Ils utilisaient des planches pour créer des instruments de musique. Ça les a préservés, ça a été gardé dans les cœurs et transmis de génération en génération.
Du sacré au profane et retour
Jean-Luc Gadreau: Un extrait du livre Black Church:
«Avec l’essor de l’industrie du disque, les artistes de blues et de jazz élevés dans l’Église empruntèrent forcément à la musique religieuse noire, croisant les genres dans leur création d’un son séculier tout neuf. Et les Églises noires faisaient de même à l’inverse, les innovateurs du gospel créant leur propre style en insufflant du sacré dans la musique populaire et profane. Ainsi, cette opposition acharnée entre sacré et profane fut le moteur de l’évolution de la musique noire jusqu’à aujourd’hui».
Et un peu plus loin:
«Un nouveau style de ministère séculier commença à se faire entendre dans les rues lorsque de jeunes Noirs s’emparèrent du micro pour s’exprimer. Le hip-hop portait un jugement contre le silence et l’invisibilité et prenait le micro pour amplifier le drame de la dépossession des Noirs. Ces rappeurs étaient des prédicateurs laïcs».
Samuel Colard, est-ce qu’il est raisonnable, à vos yeux et à vos oreilles, en tant que musicien, de dire que la musique actuelle, le hip-hop et plus largement encore, puise ses racines dans les spirituals et le gospel, dans cette musique issue des Églises protestantes africaines-américaines?
Samuel Colard: Oui, je crois qu’il est tout à fait raisonnable de le dire! Et on peut aussi l’étendre à toute la pratique musicale du peuple africain-américain, c’est-à-dire également à la partie profane. Pour moi, il y a des apports vraiment majeurs dans la manière de vivre physiquement le rythme et la pulsation. C’est quelque chose de fondamental qui va façonner toute la musique actuelle, du rock au hip-hop. Une autre dimension, aussi, c’est cette frontière très floue voire inexistante entre le parlé et le chanté. Un discours peut très facilement glisser vers des rythmes, des intonations. On le trouve autant dans les chants de travaux, quand cette population était appelée à monter des rails ou à labourer des champs, que dans les Églises avec le sermon du pasteur qui, très souvent, va glisser d’une récitation non rythmée vers la pose d’un petit tempo puis, soudainement, vers une voix qui monte suivant des intervalles très précis, très significatifs, et qui va toucher directement sur le plan des émotions. Et, évidemment, ces expressions-là vont se retrouver ensuite dans le monde profane et vont rencontrer cette tradition de la poésie parlée et récitée, le slam, le hip-hop. Tous ces éléments font naître le hip-hop à la fin des années 1970, un mouvement majeur de la musique actuelle.
Jean-Luc Gadreau: Philippe Gonzalez, tant de grands noms de la musique noire américaine viennent directement des bancs de l’église… ils ont souvent commencé en chantant dans la chorale de la paroisse quand ils n’étaient pas, comme Aretha Franklin, les enfants du pasteur. Parmi ces noms on va avoir Whitney Houston, John Legend, Sam Cooke, Beyoncé…. On pourrait en citer énormément! En même temps, le rapport entre musique d’église et musique séculière a souvent été très compliqué, tendu même, avec de vrais conflits qui existaient au sein de l’Église africaine-américaine.
Philippe Gonzalez: Absolument. Gates montre bien comment ce qui se rejoue, c’est le conflit entre ce qui est séculier et ce qui est sacré, un conflit qui va passer par le choix des instruments, des rythmes ou encore des formats musicaux. Ce qui se joue, c’est une querelle entre d’anciennes générations qui ont des formats vus comme sanctifiés et les tentatives d’innovation, notamment les tentatives d’intégrer du rap. Le rap est quand même un style qui, à la fois puise ses racines dans l’art oratoire des prédicateurs, et simultanément se développe en dehors des Églises, dans la rue, dans le milieu des gangs. Il est donc fortement connoté, socialement dévalorisé: c’est de la musique de gangster! Quand des pasteurs ou des musiciens d’église tentent de se réapproprier cette tradition musicale, cela conduit à des clashs, on va parler de gardiens du temple, etc. Un exemple qui me paraît relativement frappant (pris complètement en dehors de l’Église, pour vous montrer à quel point ces formats musicaux ont un impact sur la culture américaine), c’est la comédie musicale Hamilton, une des comédies musicales qui aujourd’hui aux États-Unis – à New York, pour être plus exact – rencontre un très grand succès. Cette comédie musicale, qui revient sur l’histoire de la fondation des États-Unis, est complètement saturée de RnB et de rap. On sent donc des influences gospel: tout est là, tout est mêlé… C’est un véritable produit de la culture musicale de l’Église afro-américaine qui rencontre la ville et qui donne naissance à des formats dépassant très largement le cadre simplement ecclésial. Or on voit que ces formes de réappropriation posent problème quand elles font un retour dans l’Église.
Samuel Colard: Je voulais simplement ajouter, en lien avec cette histoire du hip-hop qui rentre dans les locaux de l’Église, qu’il y a eu dans les années 1950 certaines expressions musicales très réservées aux lieux sacrés de l’Église qui ont commencé à sortir de l’Église pour aller dans le monde profane et que les mêmes débats avaient eu lieu à l’époque mais dans l’autre sens. Il y avait, en particulier, certaines inflexions de voix, certaines recherches de sons gutturaux qui étaient l’expression du sacré dans l’Église et qui ont commencé à sortir sur des textes profanes. Pour tout le public qui n’avait jamais assisté à un culte de l’Église africaine-américaine, cela a été l’occasion de se rendre compte par des disques de l’intensité, de la ferveur, de l’implication qui y régnaient. Le nom soul pour cette musique-là est tout à fait adapté. C’est la musique qui vient de l’âme.
Jean-Luc Gadreau: Theresa et Brenda, quel serait votre spiritual ou votre gospel préféré?
Theresa Thomason: Pour moi c’est facile, ce serait The Golden Crown (La Couronne dorée). Je l’aime parce que ça nous parle de la manière dont on doit vivre, maintenant, mais aussi dans l’éternité.
Jean-Luc Gadreau: Et vous, Brenda?
Brenda Cline: De mon côté, j’aime tous les cantiques… c’est une question très difficile! Dans notre maison, quand nous étions enfants, on les entendait tous. Mais l’une de mes préférées est une chanson toute simple que j’ai apprise petite et que j’ai ressentie dans mon âme: One Day I Will Be Called Up To Meet Him (Un jour je serai attrapée pour rencontrer mon Seigneur). Et pour moi, cela voulait dire vivre maintenant, dans le présent, en m’engageant dans l’amour, mais aussi la promesse de pouvoir habiter avec Dieu, de vivre avec lui pour l’éternité.
Jean-Luc Gadreau: Merci à vous cinq, Samuel, Theresa, Brenda, Philippe et puis Jean-Raymond qui nous a fait le cadeau d’être là pour la traduction.
Lire le 4e et dernier volet: Black Church (4): l’Église politique.
Les propos de Brenda Cline et Theresa Thomason ont été traduits par Jean-Raymond Stauffacher
Transcription réalisée par Pauline Dorémus.
Photo: Aretha Franklin se produit lors de la cérémonie The Gospel Tradition: In Performance at the White House, le 14 avril 2015 (Photo officielle de la Maison Blanche par Pete Souza, Wikimedia Commons/domaine public).
(1) O Black and Unknown Bards est le titre d’un poème de l’auteur publié dans The Book of American Negro Poetry (1922)





