«Nous tenir intérieurement droit»
Face à «une alliance inédite entre un État sécuritaire et les grandes entreprises technologiques» générant «une entité hybride ni tout à fait étatique, ni tout à fait privée, mais omniprésente et algorithmique» (analysée par le dernier livre d’Asma Mhalla), «l’unique singularité qui nous reste», la figure de celui qui se tient «intérieurement droit» n’est-elle pas celle du «serviteur inutile» (rappelée par une prédication du pasteur Roland Poupin), «acte de fidélité intime à soi-même, à la conscience, à ce qui reste d’irréductiblement humain en nous» ?
«L’unique singularité qui nous reste est celle de nous tenir intérieurement droit» (Asma Mahlla (1)).
«Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a été ordonné, dites: “Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire”» (Luc 17,10)
D’inexplicables hasards nous invitent parfois à d’improbables lectures croisées, à de plus improbables rapprochements. La lecture du sermon du pasteur Roland Poupin, à propos du serviteur inutile (Luc 17, 5-10) (2) et celle des premières pages du livre de Asma Mhalla ainsi que son interview dans Usbek&Rica (3). offrent deux discours apparemment éloignés qui se sont pourtant imposés à moi, qu’une main invisible semble m’avoir offert à la confrontation. Comme une évidence cachée qu’il me faudrait découvrir. Quelle relation pourrait-il bien y avoir entre le «totalitarisme cognitif» tel que Asma Mhalla le conceptualise et la parabole biblique ? Entre une analyse socio-politique contemporaine et la théologie biblique ? Il nous semble pourtant, intuitivement, qu’une méditation sur la foi, le service et l’humilité dans un registre spirituel entre en résonance critique avec les enjeux contemporains d’une apparente émancipation humaine en nous invitant à considérer cette tension entre l’action efficace, l’humilité et la reconnaissance des limites du pouvoir humain. Que l’on ne nous en tienne pas rigueur: nous essaierons de nous engager, imprudemment peut-être, sur ce chemin fragile, presque sans certitude quant à notre destination, en sachant seulement que notre intuition première s’ancre dans cette formule profonde à la fois poétique, philosophique, spirituelle et existentielle: «L’unique singularité qui nous reste est celle de nous tenir intérieurement droit». Aurions-nous aujourd’hui déjà perdu irrémédiablement une partie de nos singularités ? N’est-on plus tout à fait nous-même ? Quelles ultimes ressources intimes pourrions-nous encore mobiliser pour préserver en ce monde notre dignité, pour encore nous tenir droit ? Nous nous engagerons pourtant sur ce chemin, parce que cet «intérieurement» implique l’intériorité, le retour sur soi, autant que les paroles de Jésus, «…dites « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire”». Mais soyons plus clairs.
«Un nouveau système totalitaire»
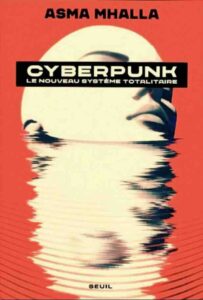 Asma Mhalla, dans son dernier essai décisif et qui fera date (1), dresse une analyse critique, urgente et lucide de la mutation du pouvoir politique aux États-Unis sous l’emprise combinée des Big Tech et des courants politiques autoritaires contemporains, le Big State. Selon elle – et il nous est difficile de ne pas la suivre – la dystopie cyberpunk (4) n’est plus un récit d’anticipation de science-fiction, mais notre réalité actuelle au sein de laquelle nous évoluons sans en avoir conscience (5). Ce que nous croyons être une projection littéraire est désormais une réalité politique, technologique et sociale (6). La dystopie n’est plus une fiction. Elle est déjà là, infiltrée dans nos usages numériques, dans nos gouvernements mais aussi dans nos imaginaires. On assiste outre-Atlantique à une transformation du pouvoir politique. Celui-ci ne s’incarne plus dans les formes traditionnelles de la souveraineté, mais dans une alliance inédite entre un État sécuritaire et les grandes entreprises technologiques, alliance qui donne naissance à une entité hybride (7) ni tout à fait étatique, ni tout à fait privée, mais omniprésente et algorithmique. L’association Elon Musk (8)-Donald Trump est de ce point de vue exemplaire. Étrange et inquiétante mutation de la démocratie où l’État se retire de ses missions (sécurité sociale, santé publique, universités, recherche, etc.) en même temps qu’il étend son contrôle à travers la manipulation d’algorithmes sous la responsabilité d’entreprises privées (9). Devenu quasi ininterprétable de par son opacité, il s’intègre silencieusement dans nos vies quotidiennes, y compris privées.
Asma Mhalla, dans son dernier essai décisif et qui fera date (1), dresse une analyse critique, urgente et lucide de la mutation du pouvoir politique aux États-Unis sous l’emprise combinée des Big Tech et des courants politiques autoritaires contemporains, le Big State. Selon elle – et il nous est difficile de ne pas la suivre – la dystopie cyberpunk (4) n’est plus un récit d’anticipation de science-fiction, mais notre réalité actuelle au sein de laquelle nous évoluons sans en avoir conscience (5). Ce que nous croyons être une projection littéraire est désormais une réalité politique, technologique et sociale (6). La dystopie n’est plus une fiction. Elle est déjà là, infiltrée dans nos usages numériques, dans nos gouvernements mais aussi dans nos imaginaires. On assiste outre-Atlantique à une transformation du pouvoir politique. Celui-ci ne s’incarne plus dans les formes traditionnelles de la souveraineté, mais dans une alliance inédite entre un État sécuritaire et les grandes entreprises technologiques, alliance qui donne naissance à une entité hybride (7) ni tout à fait étatique, ni tout à fait privée, mais omniprésente et algorithmique. L’association Elon Musk (8)-Donald Trump est de ce point de vue exemplaire. Étrange et inquiétante mutation de la démocratie où l’État se retire de ses missions (sécurité sociale, santé publique, universités, recherche, etc.) en même temps qu’il étend son contrôle à travers la manipulation d’algorithmes sous la responsabilité d’entreprises privées (9). Devenu quasi ininterprétable de par son opacité, il s’intègre silencieusement dans nos vies quotidiennes, y compris privées.
Une emprise douce sur les esprits
S’agit-il de fascisme ? À cette question, Asma Mhalla répond de manière nuancée. Contrairement aux régimes totalitaires du 20e siècle, on assiste, dit-elle, à «un simulacre de fascisme» (10). Jeu d’apparences, vidé à notre connaissance de tout référent historique, saturé de signes indéchiffrables, de symboles, de postures autoritaires, de déclarations contradictoires et de polarisation médiatique. La politique devient un spectacle (on pense à Guy Debord) où le vacarme, aux dépens des idées, capte l’attention. Saturation des informations – vraies et surtout fausses – et des narratifs qui s’accumulent et se télescopent, vacarme des indignations tonitruantes, excès des émotions spontanées en guise d’opinions: tout cela circule sans fin, faisant aussi de la démocratie un simulacre où la pensée est empêchée – mais pas interdite – prisonnière d’un flux incessant, à l’ère du scroll sans limites (11). «Lorsque vous douterez de vous-même, gardez cela en tête: ce siècle ne vous interdit pas de penser, il vous occupe jusqu’à ce que vous ne sachiez plus comment faire» (12). Séduire sans réprimer. Les Big Tech promettent une vie confortable, fluide, personnalisée (le fameux «Soyez vous-même !»), et intuitive (la transparence en informatique a la signification de son antonyme) tout en capturant nos données, en orientant nos désirs et en configurant nos routines. Ils veulent augmenter l’humain mais le façonnent en le reconfigurant (13). En étouffant la pensée critique. En transformant donc en profondeur les rapports entre sujets, pouvoir et vérité. Un totalitarisme post-moderne reposant sur une dangereuse mutation anthropologique grâce à une emprise diffuse, insaisissable, agissant comme un poison lent.
Qu’avons-nous à faire ?
«Pourtant, il va nous falloir apprendre à composer avec cette réalité. Ce que préparent aujourd’hui des figures comme Elon Musk, Peter Thiel ou Sam Altman, ce ne sont pas de simples innovations, mais des ruptures civilisationnelles», déclare Asma Mhalla, au cours de ce même interview (11). Sous prétexte d’innovations utiles au bien-être collectif et au bonheur des hommes, il s’agit de refaçonner l’humanité (14). Ce sont les fondements anthropologiques, sociaux, politiques de nos sociétés qui sont susceptibles d’être modifiés dans ce déséquilibre intentionnellement constitué (Diléviathan) entre le pouvoir technologique privé et la capacité restreinte de régulation des institutions publiques. En appelant à «composer avec cette réalité», la politologue ne prône certes pas la résignation, mais appelle à une prise de conscience urgente en réaction à cette logique utilitariste dévoyée (15) – l’utilitarisme de ceux qui détruisent tout ce qui ne les sert pas – qui vise à bouleverser notre rapport au savoir, à la vérité, à la gouvernance, au travail, au corps, à la vie privée… Apocalypse technologique (16) prêchée par des prophètes post-modernes, main droite sur la Bible qu’ils n’ont pas méditée, et convaincus qu’ils appartiennent au camp du bien… Performances spectaculaires autant que nuisibles.
Mais inviter à «composer avec cette réalité», c’est aussi avouer qu’on ne pourra y échapper totalement tout en en prenant conscience et en tentant de réagir.
Le «serviteur inutile»: la figure de celui qui se tient «intérieurement droit»
«…La foi est ce don miraculeux (plus que les déracinements d’arbres) qui permet de dire: nous sommes des serviteurs inutiles, pas à la mesure, et de faire quand même ce qui nous est demandé», affirme le pasteur Roland Poupin. Nulle suggestion de soumission ici, bien au contraire, mais appel à l’humilité et à la résistance intérieure, qui est la tentation de réagir de ceux qui ne sont délibérément pas à la mesure de ce monde d’aujourd’hui et qui est déjà celui de demain. Dans sa prédication, le pasteur touche un point théologique qui nous semble crucial: le lien entre foi, humilité et inutilité dans une logique évangélique inversée par rapport aux standards du monde. De ce monde moderne qui se construit sur une hypocrite contradiction: proclamer la valeur de l’homme en multipliant les mécanismes de sa dépersonnalisation. Les Big Tech font aussi de nos identités des simulacres. X (anciennement Twitter) d’Elon Musk, grâce à d’obscurs réglages des algorithmes, ne fait que mettre en conformité ses utilisateurs avec des formes attendues de subjectivité et de prises de position idéologiques. Et sous couvert de parole libérée (free speech), le réseau social efface toute singularité véritable, celle qui naît d’un rapport authentique à l’Autre et à soi-même. Échapper à cette cage de fer exigerait un effort de résistance, un décrochage par rapport à ce flux continu, alimenté de l’extérieur. Bref se tenir, non devant le monde en entretenant de manière irréfléchie le flux, mais «intérieurement droit». Rester fidèle à une ligne de conduite intérieure que personne ne voit, que personne n’applaudit ni n’approuve par un commentaire attendu, pré-formaté, ou par un like compulsif. Dès lors, le «serviteur inutile» nous apparaît comme la figure spirituelle de la droiture. Jésus enseigne: «Vous aussi, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire »». Parole qui invite à une attitude de désappropriation. Accomplir des actes justes sans retour. Le «serviteur inutile» est comme l’archétype d’une éthique du devoir intérieur. Figure de celui qui se tient «intérieurement droit». Par fidélité à sa conscience, à Dieu. Posture que nous devrions comprendre comme la seule profondément libératrice; c’est là que se joue la dignité humaine, dans l’action humblement assumée. Peut-être est-ce là l’ultime singularité de l’homme.
Ressources intimes et résistance intérieure
Ce «totalitarisme cognitif», cet «État total minimal», dont Asma Mhalla démonte rigoureusement et scrupuleusement les mécanismes, vise à dépouiller l’homme de sa conscience, de son intériorité et de son exigence de vérité. À détruire silencieusement les ressources que l’individu peut encore mobiliser pour préserver sa verticalité. Tout ce qu’illustre la parabole du serviteur inutile. La conscience est son premier refuge. Il est aussi le nôtre. Même dans ce monde, elle subsiste, fragile mais tenace. Elle est silencieuse. Elle est ce lieu intime où se discerne ce qui est juste, même lorsque tout autour de nous semble l’ignorer. Que ce soit par le silence, la lecture, l’écriture, la réflexion ou la prière, cette voix intérieure est déjà acte de résistance. L’intériorité quant à elle est cette capacité de se retirer en soi-même, de ne pas s’exposer. Non pour s’y enfermer ou s’y retrancher, mais pour y trouver la source d’une parole ou d’un geste authentique. Elle est tout le contraire de cette réactivité immédiate, tentation à laquelle nous sommes sciemment exposés. Dans la vacuité du monde futur déjà présent, elle permet de redonner du poids aux choses les plus simples, aux pensées les plus dépouillées, profondes. De choisir librement. De préserver et d’affirmer nos singularités. C’est une contre-culture dans ce monde de l’extériorité. Mais l’ultime ressource, celle qu’il faut détruire à tout prix pour asservir les âmes, c’est la fidélité au vrai, au juste, au bien. C’est aussi la fidélité du «serviteur inutile», qui agit sans calcul, pour qui le bien n’a pas besoin d’être utile pour être nécessaire. Peut-être est-ce ce qu’il y a de plus singulier en l’homme. Non son originalité visible, mais sa capacité à vouloir persévérer dans la justesse, dans la nuit, dans sa nuit, et le silence, sans rien attendre en retour.
La fidélité à l’essentiel: quand la foi du serviteur inutile est l’ultime refuge
Cette ultime singularité, n’est-elle pas surtout dans l’affirmation et la résistance de notre foi, bien menacée alors que nous vivons à la fois (et paradoxalement) dans la violence et la séduction de ce monde et risquons, malgré nous, d’en être les victimes ? Nous qui peinons tant à être les «serviteurs inutiles», qui souvent vivons douloureusement notre foi confrontée à l’incohérence du réel, à l’inertie du mal, aux tentatives de domination des esprits, à l’absence apparente de réponse ? C’est la condition spirituelle de beaucoup. «Quiconque croit au spectaculaire et à l’utile supposé ne voit pas qu’il y a là un danger pour la foi !», dit le pasteur. Dans un monde que le numérique absorbe, réglé au rythme de l’immédiateté, de la formule choc, de l’émotion facile, de la tentation permanente et du paraître, de l’emprise invisible sur les esprits, comment ne pas désapprendre de vivre entre promesse et attente ? (Habacuc 2, 2-4). Comment préserver cette foi, tenue dans l’intervalle (le seuil) entre notre capacité à porter en nous le sentiment d’un temps long, dans le silence de Dieu, et l’épreuve de continuer malgré tout à marcher ? Ce que Asma Mhalla nomme «l’unique singularité qui nous reste» – celle de se tenir intérieurement droit – désigne non une posture visible ou spectaculaire, mais un acte de fidélité intime à soi-même, à la conscience, à ce qui reste d’irréductiblement humain en nous. Cette verticalité intérieure, discrète et invisible, pourrait bien être notre dernier refuge de liberté et de dignité. Comme l’est la foi du serviteur inutile.
Finalement, la concomitance fortuite du discours du théologien et de celui de la politologue, qui «théorise en temps réel», m’avertissait d’une étonnante et insoupçonnée convergence.
Illustration: conférence du président Trump dans le bureau ovale de la Maison blanche le 15 octobre 2025 (photo Molly Riley, Maison Blanche).
(1) Asma Mhalla, Cyberpunk. Le nouveau système totalitaire, Seuil, septembre 2025, p.10. Désormais NST.
(2) Pasteur Roland Poupin, Ne servir à rien, culte de rentrée, Châtellerault, 5 octobre 2025.
(3) «Elon Musk, Peter Thiel et Sam Altman ne se contentent pas d’imaginer un futur: ils le programment», Asma Mhalla interrogée par Emilie Echaroux, Usbek&Rica, 22 septembre 2025.
(4) «Le cyberpunk (association des mots cybernétique et punk) est un genre de la science-fiction très apparenté à la dystopie et à la hard science-fiction. Il met souvent en scène un futur proche, avec une société technologiquement avancée, notamment dans les technologies de l’information et la cybernétique» (page Wikipédia).
(5) «Ce qui me sidère aujourd’hui, c’est de voir à quel point les médias, les citoyens et le public dans son ensemble n’en ont pas conscience» (entretien cité avec Asma Mhalla, Usbek&Rica).
(6) «Ce qui vous paraît impensable est peut-être déjà autour de vous», NST, p.20.
(7) Entité, créature bicéphale, à propos de laquelle la politologue forge le concept de Diléviathan, inspiré du Léviathan de Thomas Hobbes.
(8) Sans oublier Sam Altman ou Peter Thiel. Ni JD Vance.
(9) Ce que Asma Mhalla appelle un «État total minimal». Le pouvoir n’a plus de centre.
(10) La notion est empruntée à Jean Baudrillard.
(11) Nouvelle forme de pouvoir que Asma Mhalla appelle la fluxocratie. Un État-flux. «Le régime d’hypervitesse dans lequel nous évoluons est extrêmement dangereux. Nous sommes pris dans une saturation permanente du flux: tout arrive en même temps, tout est à commenter, à partager. Or, le commentaire permanent est l’ennemi de la pensée. Penser, c’est mettre à distance» (entretien cité avec Asma Mhalla, Usbek&Rica).
(13) Ce qui rend ce totalitarisme particulièrement redoutable, c’est qu’il implique activement les individus. En alimentant les plateformes, en produisant des données, en interagissant, nous coconstruisons les systèmes qui nous gouvernent. Nous ne sommes plus dominés de l’extérieur: nous participons à notre propre assujettissement.
(14) On pense à la techno-idéologie transhumaniste d’Elon Musk (interface cerveau-machine).
(15) C’est un utilitarisme justificatif: Musk justifie les technologies d’augmentation cognitive (ou de surveillance) parce qu’elles sont utiles au «bien de l’humanité.
(16) Rappelons-nous: «Nous sommes la tempête», celle qui, assurément, au nom d’une foi elle aussi dévoyée, s’imagine avoir à déraciner le mûrier !





