Sortir de l’obsession de l’efficience pour entrer dans un nouveau rapport avec la nature
Pour l’économiste américain Jeremy Rifkin, nous sommes en train de passer du temps de l’efficience au temps de l’adaptivité, une révolution qu’il explique dans son dernier livre L’âge de la résilience et qui nous force à «tout repenser: notre vision du monde, notre compréhension de l’économie, nos formes de gouvernement, nos conceptions de l’espace et du temps, nos pulsions les plus fondamentales et, bien sûr, notre relation à la planète».
Texte publié sur Vivre et Espérer.
L’âge de la résilience selon Jeremy Rifkin
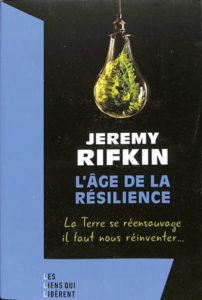 «Jeremy Rifkin est l’un des penseurs de la société les plus populaires de notre temps. Il est l’auteur d’une vingtaine de best-sellers.» On peut ajouter à cette présentation du livre de Jeremy Rifkin L’âge de la résilience (1) que l’auteur n’est pas seulement un chercheur qui ouvre des voies nouvelles, mais un conseiller influent qui intervient auprès de nombreuses instances de décision. Ses livres nous font entrer dans de nouvelles manières de voir et de penser. Ainsi, sur ce blog, nous avons présenté La troisième révolution industrielle (2) et le New Deal vert mondial (3). Jeremy Rifkin est également l’auteur de grandes synthèses qui éclairent notre marche. Ainsi, sur le site de Témoins, nous avons présenté son livre sur l’empathie (4), une fresque historique très engageante. En général, comme dans L’âge de la résilience, Jeremy Rifkin développe son regard prospectif à partir d’une analyse et d’un bilan du passé. Il nous a habitué à une démarche dynamique. C’est avec d’autant plus d’attention que nous entendons ici son cri d’alarme sur l’héritage du passé et la menace du présent. Tout est à repenser: «Il ne s’agit plus de courir après l’efficacité, mais de faire grandir notre capacité de résilience. Nous devons tout repenser: notre vision du monde, notre compréhension de l’économie, nos formes de gouvernement, nos conceptions de l’espace et du temps, nos pulsions les plus fondamentales et, bien sûr, notre relation à la planète» (page de couverture).
«Jeremy Rifkin est l’un des penseurs de la société les plus populaires de notre temps. Il est l’auteur d’une vingtaine de best-sellers.» On peut ajouter à cette présentation du livre de Jeremy Rifkin L’âge de la résilience (1) que l’auteur n’est pas seulement un chercheur qui ouvre des voies nouvelles, mais un conseiller influent qui intervient auprès de nombreuses instances de décision. Ses livres nous font entrer dans de nouvelles manières de voir et de penser. Ainsi, sur ce blog, nous avons présenté La troisième révolution industrielle (2) et le New Deal vert mondial (3). Jeremy Rifkin est également l’auteur de grandes synthèses qui éclairent notre marche. Ainsi, sur le site de Témoins, nous avons présenté son livre sur l’empathie (4), une fresque historique très engageante. En général, comme dans L’âge de la résilience, Jeremy Rifkin développe son regard prospectif à partir d’une analyse et d’un bilan du passé. Il nous a habitué à une démarche dynamique. C’est avec d’autant plus d’attention que nous entendons ici son cri d’alarme sur l’héritage du passé et la menace du présent. Tout est à repenser: «Il ne s’agit plus de courir après l’efficacité, mais de faire grandir notre capacité de résilience. Nous devons tout repenser: notre vision du monde, notre compréhension de l’économie, nos formes de gouvernement, nos conceptions de l’espace et du temps, nos pulsions les plus fondamentales et, bien sûr, notre relation à la planète» (page de couverture).
Un chemin pour changer de vision et de paradigme
Dans l’introduction du livre, Jeremy Rifkin esquisse un chemin pour dépasser l’héritage du passé et nous engager dans une nouvelle manière de vivre. Il nous invite donc à revisiter notre histoire en commençant par remettre en cause le mythe du progrès. Ainsi rappelle-t-il les propos du philosophe Condorcet guillotiné en 1794: «La perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie. Les progrès de cette perfectibilité, désormais indépendante de toutes puissances qui voudrait les arrêter, n’ont d’autres termes que la durée du globe où la nature nous a jeté (…) Aujourd’hui, sa conception du futur nous semble naïve. Pourtant le concept de progrès n’est que la dernière itération d’une vieille croyance: les humains seraient fondamentalement différents des autres êtres vivants avec qui ils se partagent la terre» (p.10). Aujourd’hui, l’humanité est assaillie de menaces et de peurs. En regard, un peu partout, le terme de résilience est évoqué: «L’âge du progrès cède la place à l’âge de la résilience» mais «ce grand basculement de l’âge du progrès à l’âge de la résilience requiert un vaste ajustement philosophique et psychologique dans la perception qu’a l’humanité du monde qui l’entoure. À la racine de la transition, il y a un changement total de notre rapport à l’espace et au temps» (p.11).
Jeremy Rifkin raconte comment la vie ordonnée des moines bénédictins au Moyen âge a suscité une nouvelle appréhension du temps ponctué par leurs activités. C’est la naissance de l’horloge mécanique qui s’est répandue ensuite dans la civilisation urbaine. Finalement, le temps va «être perçu comme une suite d’unités standard mesurables, fonctionnant dans un univers parallèle, qui ne doit plus rien aux rythmes de la terre» (p.84). Cette nouvelle temporalité va déboucher sur une recherche d’efficacité accrue dans le temps disponible. Cette temporalité a régi de bout en bout l’âge du progrès et sa conception de l’efficience. L’efficience a cherché à «optimiser l’expropriation, la consommation et la mise au rebut des ressources naturelles, et, ce faisant, à accroitre l’opulence matérielle de la société dans des temps toujours plus courts, mais au prix de l’épuisement de la nature. Notre temporalité personnelle et le pouls temporel de notre société obéissent à l’impératif de l’efficience» (p.12).
«Dans cet ouvrage, le terme ‘efficiency’ employé dans l’édition originale, ne signifie pas ‘efficacité’ (capacité d’atteindre un objectif), mais ‘efficience’ (capacité d’obtenir les résultats ou les profits maximaux avec le minimum de moyens et de frais dans le minimum de temps)» (p.12).
«L’âge du progrès marchait au pas de l’efficience.»
«Passer du temps de l’efficience à celui de l’adaptativité: tel est le visa de réadaptation qui permettra à l’espèce humaine de sortir d’un rapport de séparation et d’exploitation avec le monde naturel pour être rapatrié parmi la multitude des forces environnementales qui animent la Terre» (p.12)…
Remplacer l’efficience par l’adaptativité implique des changements radicaux dans l’économie et dans la société (…). Déjà expert de la «troisième révolution industrielle», Jeremy Rifkin voit là un mouvement en voie de «réinsérer l’humanité dans les infrastructures indigènes de la planète: l’hydrosphère, la lithosphére, l’atmosphère et la biosphère. La nouvelle infrastructure emporte l’humanité au delà de l’ère industrielle…» (p.13).
«Sans surprise, la nouvelle temporalité s’accompagne d’une réorientation fondamentale à l’égard de l’espace»: notre appréhension de l’espace varie dans le temps, comme l’auteur nous le fait remarquer en mettant en lumière l’avènement de la perspective dans la peinture de la Renaissance italienne et ses incidences révolutionnaires (pp.86-87). Bien sûr, dans l’âge qui vient, les ressources naturelles seront perçues et gérées autrement. Mais le changement de mentalité va plus loin encore. Nous prenons conscience d’appartenir à un ensemble vivant et nous ne nous regardons plus comme des êtres à part séparés de l’extérieur. L’auteur nous fait part de découvertes importantes qui nous situent en interaction avec le vivant:
«Nous commençons à comprendre que notre vie et celle des autres êtres vivants est faite de processus, de modèles et de flux… Tous les êtres vivants sont des extensions des sphères terrestres. Les minéraux et les nutriments de la lithosphère, l’eau de l’hydrosphère, l’air de l’atmosphère nous parcourent continuellement sous forme d’atomes et de molécules, s’installent dans nos cellules… et y sont remplacées régulièrement, à différents intervalles, au cours de notre vie. La majorité des tissus et organes qui constituent notre corps se renouvellent sans cesse au fil de nos existences…».
Et, par ailleurs, «notre corps n’est pas uniquement à nous. Nous le partageons avec de nombreuses autres formes de vie – des bactéries, des virus, des protéines, des archées et des champignons… Plus de la moitié des cellules de notre corps ne sont pas humaines… elles appartiennent aux autres êtres qui vivent dans chaque coin de notre anatomie» (pp.179-190)…
«Ainsi, nous sommes tous des écosytèmes… Et, de plus, nous sommes faits de multiples horloges biologiques qui adaptent continuellement nos rythmes corporels internes à ceux que marquent les rotations de la terre… rythmes circadien et lunaire, rythme des saisons, rythmes annuels…» (pp.13-14).
Ainsi, «nous faisons partie de la terre, au plus profond de notre être…». L’auteur en déduit que «cela nous inspire des idées neuves sur la nature de la gouvernance et sur notre fonctionnement en tant qu’organisme social. À l’âge de la résilience, gouverner, c’est assurer l’intendance de écosystèmes régionaux. Et cette gouvernance biorégionale est beaucoup plus partagée, distribuée…» (p.15).
Cependant, on ne peut manquer de se poser une question fondamentale: quel est le sens de ce parcours?
«Que cherche l’humanité? Pas seulement sa simple subsistance. Quelque chose de plus profond, de plus tourmenté bouillonne en nous – un sentiment qu’aucun autre être vivant ne possède… Nous sommes en quête continuelle du sens de nos existences» (p.16).
C’est là que Jeremy Rifkin en revient à mettre en évidence la vertu qu’il a déjà appréciée dans l’humanité: son potentiel d’empathie (4): «Cet atout rare et précieux croît, décroît et ne cesse de réapparaitre».
«Ces dernières années, la nouvelle génération a commencé à étendre son empathie au delà de notre espèce pour y inclure les autres vivants qui font tous partie de notre famille évolutionnaire. C’est ce que les biologistes appellent la ‘conscience biophile’. Voilà un signe encourageant.»
L’approche de la résilience
Dans son livre, Jeremy Rifkin nous introduit dans une histoire, celle qui analyse le pesant héritage du passé pour baliser ensuite les voies d’un avenir viable, plus précisément d’un âge de la résilience. Ce parcours s’opère en quatre parties:
«Efficience contre entropie. La dialectique de la modernité; L’appropriation de la Terre et la paupérisation des travailleurs; Comment nous en sommes arrivés là. Repenser l’évolution sur Terre; L’âge de la résilience: la fin de l’ère industrielle».
Aujourd’hui, le regard scientifique est en train de changer, une nouvelle manière d’approcher les réalités en terme de «socio-écosystèmes adaptatifs complexes» (p.217).
Après avoir rappelé les principes de la science classique dans la foulée de Francis Bacon, l’auteur met en lumière une nouvelle approche, l’apport d’un écologue canadien: Crawford Stanley Holling. En 1973, dans un article intitulé Résilience et stabilité des systèmes écologiques, il a exposé une nouvelle théorie sur l’émergence et les modes de fonctionnement de l’environnement naturel. Holling a introduit les concepts de gestion «adaptative» et de «résilience» dans la théorie des systèmes écologiques; avec d’autres pionniers, il a posé les bases d’une méthode scientifique radicalement neuve qui, en fusionnant l’écologique et le social, allait défier les principes directeurs, tant théoriques que pratiques de l’économie admise. Il s’agit de la théorie des «socio- écosystèmes adaptatifs complexes» (p.217).
Pour Holling, «le comportement des systèmes écologiques pourrait être défini par deux propriétés distinctes: la résilience et la stabilité»… La théorie de la résilience de Holling a ensuite été importée dans la quasi-totalité des disciplines: la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, l’anthropologie, la physique, la chimie, la biologie et les sciences de l’ingénieur. Différents secteurs économiques ont commencé à s’y intéresser… Mais le plus important est que l’épicentre de la nouvelle Grande Disruption se trouve à l’intersection de l’économie et de l’écologie. Holling précise: la résilience est la propriété du système et la persistance ou la probabilité d’extinction est le résultat.
«Une des principales stratégies retenues par la sélection n’a donc pas pour but de maximiser l’efficience ou un avantage particulier, mais de permettre la persistance en maintenant d’abord et avant tout la flexibilité» (pp.217-218).
En ce sens, la diversité est un atout: «Une méthode de gestion fondée sur la résilience… insistera sur la nécessité de garder une multiplicité d’options ouvertes, d’observer les évènements dans le contexte régional et non local et de privilégier l’hétérogénéité» (p.218). Et, dans la même perspective, il nous faut reconnaître notre ignorance et accepter l’imprévisibilité: «Dans les trente ans qui ont suivi, Holling a vu sa première esquisse de théorie de la résilience et de l’adaptation modifiée, améliorée et nuancée par d’autres et ces apports n’ont cessé d’affiner et d’enrichir sa thèse. En 2004, il a coécrit un nouvelle version de la résilience et des cycles adaptatifs». Ici, on y exprime que «le système peut être incapable de se maintenir, ce qui l’oblige de se transformer en un nouveau système auto-organisé» (pp.218-219).
L’auteur met l’accent sur les transformations qui adviennent ainsi: «Quand des forces interagissent dans la nature, la société et l’univers, elles ne reviennent jamais à leur point de départ, car leurs interactions, si minimes soient–elles, changent la dynamique» (p.220). Et donc, «résilience n’a jamais voulu dire des restaurations parfaites du statu quo ante… On ne doit jamais considérer la résilience comme un état, une manière d’être dans le monde, mais comme une manière d’agir sur le monde» (p.221).
Et, si on envisage la résilience en terme de démarche thérapeutique, «elle n’est jamais un retour. On ne peut jamais revenir en arrière, mais seulement aller de l’avant vers un sens nouveau de sa capacité d’action» (p.221).
La science économique actuelle est remise en cause par la mutation en cours:
«La rénovation imposera une réévaluation partielle de certains de ses fondements: la théorie de l’équilibre général, les analyses coûts-avantages, la définition étroite des externalités et les concepts trompeurs de productivité et de PIB. Et d’abord, il faudra modérer et même remettre en cause l’obsession de l’efficience. Par dessus tout, les milieux d’affaires vont devoir renoncer complètement à leur conception du monde naturel et à leur rapport avec lui» (p.222).
«Pour commencer à remodeler la théorie économique, le mieux n’est-il pas de suivre la démarche de l’âge de la résilience? Celle qui est en train de sortir les autres disciplines académiques du marasme de la recherche scientifique traditionnelle essentielle à l’âge du progrès?»
L’auteur préconise donc l’approche des éco-systèmes adaptatifs complexes qui «conçoit la recherche de façon fondamentalement différente de la méthode scientifique traditionnelle.
Premièrement, parce que cette dernière procède souvent en isolant un seul et unique phénomène…
Deuxièmement, parce que la conception admise de la recherche scientifique est… en fait complètement biaisée… Le préjugé implicite, c’est d’examiner le monde comme s’il était fait d’un assortiment d’objets passifs et même inertes par nature, dont la capacité d’action est faible ou nulle.
Troisièmement, la nature est souvent perçue comme un ensemble de ‘ressources’ à exploiter au profit de la société» (pp.223-224).
A la différence de la recherche classique, on passe dans la recherche sur les socio-systèmes adaptatifs
«des caractéristiques des parties aux propriétés systémiques;
de systèmes fermés aux systèmes ouverts;
de la mesure à la détection et à l’évaluation de la complexité;
de l’observation à l’intervention» (p.225).
«Pour avancer, il faut que la visée de la recherche scientifique passe, du moins en partie, de la prédiction à l’adaptation» (p.227).
L’auteur évoque la pensée du philosophe américain John Dewey, fondateur du pragmatisme. Il fut «l’un des premiers penseurs à attirer l’attention sur les mérites de l’adaptativité en tant que méthode de recherche scientifique et de résolution de problèmes… Pour Dewey, celui ou celle qui veut comprendre une situation commence toujours son enquête en y participant activement, en faisant expérience directe du problème qu’elle pose et en subissant personnellement ses effets» (p.227).
«L’adaptativité acquit un certaine influence au début du 20e siècle, mais elle a ensuite été submergée par la croisade pour l’efficience» (p.228).
Mais aujourd’hui, cette obsession de l’efficience est remise en cause. «Sur cette terre qui se réensauvage, il n’est plus question de profiter (opportunités infinies) mais de limiter les risques, et l’efficience commence à céder sa place à l’adaptativité» (p.228). L’auteur examine ensuite les manifestations de ce courant visant à l’adaptativité. C’est un nouvel état d’esprit:
«La science économique traditionnelle et les mécanismes du capitalisme, en théorie comme en pratique, ne survivront pas sous leur forme actuelle à la transformation induite par le passage à la pensée des systèmes adaptatifs complexes… La pensée des systèmes adaptatifs complexes va également nécessiter une réforme du monde universitaire… Il n’existe qu’une seule façon de comprendre ce qui se passe: adopter une approche interdisciplinaire du savoir…» (pp.231-232).
L’esprit humain se prête à ce changement. C’est ici que l’auteur met en évidence une découverte récente des anthropologues: «De nouvelles séries de données environnementales indiquent qu’homo a évolué sur fond de longues périodes d’imprévisibilité de son habitat…». Et ils précisent: «Les facteurs essentiels au succès et à l’expansion du genre homo ont eu pour fondement la flexibilité de son système alimentaire dans des environnements imprévisibles, car c’est elle, avec la reproduction alimentaire et la flexibilité du développement, qui a permis l’élargissement géographique et réduit les risques de mortalité». Ainsi, un de ces chercheurs a pu écrire: «L’origine du genre humain se caractérise par des formes d’adaptabilité» (pp.253-254). On peut parler «d’ingéniosité de l’espèce humaine». Jeremy Rifkin voit là un encouragement. Comment faire face au réchauffement climatique?
«C’est la question fondamentale de notre époque. L’adaptabilité humaine aux changements brutaux du régime climatique est notre point fort. C’est ce qui a fait de nous une des espèces les plus résilientes de la planète. Au seuil de l’âge de la résilience, voilà peut-être la nouvelle la plus encourageante du moment» (p.235).
L’âge de la résilience: la fin de l’ère industrielle
Jeremy Rifkin consacre la quatrième partie du livre aux grands axes de changement qui forment la trame du nouvel âge:
l’infrastructure de la révolution résiliente;
la montée en puissance de la gouvernance biorégionale;
une place croissante de la pairocratie distribuée dans la démocratie représentative;
l’essor de la conscience biophile.
Ces chapitres, à nouveau, sont riches et denses en informations et idées. Chacun de nous a conscience de ces grands mouvements. C’est pourquoi nous nous bornerons ici à un bref aperçu en renvoyant à une lecture approfondie du livre.
Une nouvelle infrastructure, un nouveau paradigme économique
Jeremy Rifkin nous a déjà entretenu dans un livre précédent (Le New Deal vert mondial) des transformations structurelles en train de se préparer (3). Il met ici l’accent sur l’importance des infrastructures. Elles sont «bien plus qu’un simple échafaudage qui sert à réunir un grand nombre d’êtres humains au sein d’une vie collective». Elles associent en effet trois facteurs majeurs:
«de nouvelles formes de communication,
de nouvelles sources d’énergie
et de nouveaux moyens de transport et de logistique».
«Quand ces trois avancées techniques apparaissent et fusionnent en une seule et même dynamique, elles changent radicalement la façon dont on communique» (p.239).
Et l’auteur ajoute qu’elles ont elles-mêmes une influence sur l’ensemble de la vie collective: «On assimile très justement ces structures à de vastes ‘organismes sociaux’. Ce sont des systèmes auto-organisés qui agissent comme une totalité unique».
«Les grandes révolutions infrastructurelles changent la nature de l’activité économique, la vie sociale, et les formes de gouvernement…» (p.240).
Ainsi après les infrastructure du 19e siècle (charbon, machine à vapeur, réseau ferré, télégraphe), puis du 20e siècle (réseau électrique centralisé, téléphone, radio et télévision, voitures, avions, réseaux routiers, aérodromes), «aujourd’hui, nous sommes au cœur d’une troisième révolution industrielle. L’Internet numérisé de communication haut débit converge avec un Internet numérisé continental de l’électricité, alimenté par les énergies solaire et éolienne». Une énergie verte est revendue à l’internet continental.
«Actuellement, ces deux internets numérisés convergent avec un troisième: l’Internet numérisé de la mobilité et de la logistique.»
C’est la part des véhicules électriques. «Ces trois Internets vont progressivement partager un flux continu de données et d’analyses de ces données… À l’ère qui vient, on va rénover les immeubles à des fins d’énergie et de résilience climatique…» Ce seront des «immeubles intelligents» (pp.241-242).
«Les infrastructures des deux premières révolutions industrielles ont été conçues pour opérer en pyramide, de haut en bas, et pour fonctionner au mieux lorsqu’elles étaient enveloppées par plusieurs couches de droits de propriété matérielle et intellectuelle.»
«Les infrastructures des deux premières révolutions industrielles ont été propulsées, pour l’essentiel, par des énergies fossiles. Elles ont donné lieu à des engagements militaires. Au contraire, l’infrastructure de la nouvelle révolution industrielle est conçue pour être distribuée et non centralisée. Elle fonctionne mieux quand elle reste ouverte et transparente…»
«Elle est conçue pour s’étendre latéralement et non verticalement» (p.244).
L’auteur reconnait la présence actuelle d’oligopoles mondiaux dans ce champ. Cependant il estime que l’évolution à venir ne va pas dans le sens de la centralisation (p.245).
Des transformations majeures adviennent:
«Bien qu’elle soit encore dans sa petite enfance, l’économie du partage distribuée et interconnectée par le numérique constitue un nouveau système économique. C’est le premier à entrer en scène depuis le capitalisme au 18e siècle et le socialisme au 19e siècle – encore un signe qui montre à quel point le nouvel ordre économique émergent se distingue de ce que nous avons connu sous le capitalisme industriel» (p.250).
Le PIB, par exemple, perd de plus en plus son rôle d’indicateur de la performance économique. Le monde entier est concerné:
«En 2020, des milliards d’êtres humains avaient un smartphone, et chacun de ces appareils possédait une puissance de calcul supérieure à celle qui avait envoyé des astronomes sur la Lune… L’humanité se connecte à un multitude de plateformes pour jouer, travailler, entretenir des relations» (p.251).
Dans ce chapitre, Jeremy Rifkin nous ouvre sans cesse de nouveaux horizons. Nous entrons dans un nouvel univers économique et social: «Quand nous dressons la liste de tous les changements induits par le passage à une infrastructure numérique intelligente de troisième révolution industrielle, l’énormité de ce qui se profile suggère une transformation radicale de notre idée de la vie économique. Elle va passer
de la propriété à l’accès,
des marchés ‘acheteurs-vendeurs’ aux réseaux ‘fournisseurs-utilisateurs’;
des bureaucraties analogiques aux plateformes numériques ;
du capital financier au capital naturel;
de la productivité à la régénérativité;
de processus linéaires aux processus cybernétiques;
des externalités négatives à la circularité;
des économies d’échelle de l’intégration verticale à celles de l’intégration latérale;
des chaines de valeur centralisées aux chaines de valeurs distribuées;
du produit intérieur brut aux indicateurs de qualité de vie;
de la globalisation à la glocalisation;
des conglomérats de sociétés transnationales aux agiles PME opérant sur de simples réseaux blockchains glocaux
et de la géopolitique à la politique de la biosphère».
Ces réalités nouvelles s’expriment souvent dans des termes techniques, un nouveau langage et une nouvelle réalité à découvrir dans ce chapitre.
Dans une conjoncture qui nous paraît si menaçante, Jérémy Rifkin introduit un nouveau regard:
«Nous assistons à un saut extraordinaire dans un nouveau paradigme économique. Au début de la décennie 2040, il ne sera probablement plus perçu comme une troisième révolution industrielle fonctionnant sur un modèle économique strictement capitaliste. Notre société mondiale commence à sortir des 250 années de révolution industrielle et à se tourner vers une ère nouvelle. Le mieux est de la nommer: ‘révolution résiliente’» (p.255).
Nouvelles formes de gouvernance
Les transformations nécessitées par la politique écologique requièrent également de nouvelles formes de gouvernance. L’auteur envisage ainsi la montée en puissance d’une gouvernance biorégionale. Les accidents climatiques appellent des «mobilisations en terme de ‘gouvernance des communs’ où l’investissement personnel est bien plus fort» (p.267). Certes des fractures apparaissent actuellement dans les sociétés. Mais l’auteur développe une approche prospective.
Les régions rurales longtemps dévalorisées vont ré-émerger. Elles ont souvent des atouts en termes de potentiel solaire et éolien. Mais surtout, elles sont à même d’accueillir la nouvelle économie de partage distribuée et interconnectée par le numérique:
«Les start up technologiques intelligentes peuvent opérer dans les bourgs et petites villes des zones rurales où les prix de l’immobilier et les frais généraux sont moins élevés, tout en restant compétitives sur les marchés ‘glocaux’» (p.270).
«On observe par ailleurs une migration dans laquelle certains quittent les grandes villes pour s’installer dans les campagnes dans un mode de vie plus naturel.»
Récemment, «la communauté scientifique a posé le cadre d’une gouvernance biorégionale en appelant à ‘réensauvager’ ou ‘reruraliser’ la moitié de la terre» (p.276) en vue notamment de lutter contre la disparition des espèces et des écosytèmes. L’accent est mis sur l’importance des forêts naturelles dans le maintien de la biodiversité et la rétention et le stockage du carbone. L’auteur identifie des «bio régions» qu’on peut envisager «en termes sociaux, psychologiques et biologiques», avec l’idée de «vivre en un lieu» et en entendant par là: «une société vivant en équilibre avec la région qui la soutient à travers les liens entre les vies humaines, les autres êtres vivants et les processus de la planète – les saisons, le climat, les cycles de l’eau» (p.280). L’auteur en donne des exemples aux États-Unis et il met en lumière l’avènement d’une «gouvernance biorégionale» (p.176).
Participation et association
Nous observons aujourd’hui un «délitement de la cohésion sociale» (p.295). Le mécontentement monte et la méfiance s’accroît. Une enquête menée en 2020 dans 28 pays constate que 66% de citoyens n’ont pas confiance dans leur gouvernement actuel (p.295). Des remous, de grands changements mal interprétés suscitent l’inquiétude. La violence monte. Ces menaces appellent un renouvellement de la gouvernance à travers une participation accrue des citoyens. Ainsi un chapitre est intitulé: «La démocratie représentative fait une place à la pairocratie (le rôle des pairs) dans la démocratie représentative» (p.289).
«Une jeune génération commence à tempérer la démocratie représentative avec ses succès, ses espoirs déçus et ses insuffisances en y mêlant une forme d’action politique horizontale, latérale, plus large, plus inclusive, qui insère les communautés locales au sein des écosystèmes…»
«Cette nouvelle identité politique émergente s’accompagne d’un engagement militant direct dans la gouvernance… Chaque citoyen devient partie intégrante du processus de gouvernement… Des assemblées citoyennes apparaissent. Leurs membres se réunissent entre égaux, entre pairs, travaillant parallèlement aux autorités en donnant des avis, conseils et recommandations… Ces assemblées de pairs horizontalisent la prise de décision en assurant l’engagement actif des citoyens dans la gouvernance. La démocratie représentative fait une place à une ‘pairocratie’ distribuée comme la gouvernance locale fait une place à une gouvernance biorégionale en ces temps où les citoyens se regroupent pour réagir aux défis comme aux opportunités de sauvegarde de leur biorégion» (pp.289-290).
«De nombreuses expériences apparaissent: budget participatif, contrôle local sur les écoles ou sur la police.»
Jeremy Rifkin inscrit son étude dans une réflexion historique sur la conception et la pratique de la liberté dans la période moderne en Occident et la vision de nouvelles générations pour lesquelles «la liberté est affaire d’accès et d’inclusivité et non d’autonomie et d’exclusivité. Ils mesurent leur liberté au degré auquel ils peuvent accéder et participer aux plateformes qui prolifèrent sur toute la planète. L’inclusivité qu’ils ont à l’esprit est latérale et très étendue: elle englobe souvent le genre, l’ethnie, l’orientation sexuelle et même le lien avec les autres êtres vivants sur une planète en vie» (p.292).
L’auteur note «l’arrivée à maturité des organisations de la société civile… Ces organisations sont des mouvements sociaux, des entreprise économiques et aussi de nouvelles formes de proto-gouvernance qui font entrer les citoyens sur la scène politique» (pp.300-301).
Conscience biophile
Selon Jeremy Rifkin, la grande dynamique à l’œuvre pour promouvoir l’âge de la résilience s’inscrit dans le développement d’une «conscience biophile». Ce chapitre mériterait une analyse spécifique qui ne peut être engagée dans le cadre de cette présentation.
L’auteur commence par exposer les recherches de John Bowlby sur l’attachement. Privés de tendresse, de jeunes enfants dépérissent. Depuis l’intuition initiale de Bowlby sur le rôle que joue le comportement d’attachement, des chercheurs ont examiné de plus près notre constitution biologique en cherchant à comprendre les mécanismes de la pulsion empathique profondément intégrés à nos circuits neuronaux. Ils ont ainsi découvert qu’au cœur même de notre être – et c’est ce qui rend notre espèce si spéciale – un élan biologique inné nous pousse à avoir de l’empathie pour «l’autre» (p.322). Comme il l’a déjà étudié dans un livre précédent sur l’empathie (4), l’auteur revient ici sur ce thème. Dans une rétrospective historique, il inscrit l’empathie dans une dimension sociale: «L’élan empathique n’est pas seulement lié aux pratiques éducatives vécues par l’enfant,… l’empathie change aussi au cours de l’histoire, elle est étroitement mêlée à l’évolution de la société».
«L’infrastructure de chaque civilisation apporte un paradigme économique qui lui est propre, un nouvel ordre social. Elle s’accompagne aussi d’une vision du monde, d’un grand récit auquel la population peut prêter allégeance. Elle permet, à chaque fois, d’élargir la solidarité empathique, qui peut englober et unir émotionnellement les diverses populations…» (p.326).
L’auteur évoque ainsi des civilisations successives. Il y voit des «expansions de l’empathie» sans méconnaitre «les reculs et les retours au passé, ce grand fléau de l’histoire de l’humanité» (p.331).
Il perçoit aujourd’hui l’apparition dans la jeune génération d’«une nouvelle famille biologique plus inclusive. La conscience biophile émerge à peine. Elle sera probablement le grand récit qui va définir l’Âge de la résilience en un temps où débute l’entrée de l’humanité en empathie avec les autres vivants» (p 332). Aujourd’hui, l’humanité a besoin de se «réaffilier à la nature» (p.332). Les urbains ont besoin de se reconnecter avec le vivant comme Anne-Sophie Novel nous en indique le chemin (5). Et l’auteur décrit les initiatives pour permettre aux enfants de se familiariser avec le monde naturel, comme, par exemple, les classes de nature. Au total, nous sommes appelés à un changement de perspective:
«L’universalisation de la biophilie fait passer le récit humain d’une obsession de l’autonomie à un attachement au relationnel. La formule classique de René Descartes, ‘Je pense, donc je suis’, est déjà du passé, car la jeune génération qui grandit dans des mondes virtuels, structurés par des couches d’interconnexion horizontale, lui préfère une autre maxime: ‘Je participe, donc j’existe’» (p.352).
«L’interprétation interactive de la nature, comme de celle de la nature humaine, impose de repenser radicalement le discours philosophique et politique qui a fondé l’âge du progrès» (p.353).
«Deux siècles avant que le concept de conscience biophile soit introduit par E O Wilson, le grand philosophe et savant allemand Johann Wolfgang von Goethe propose de faire de la conscience biophile un contre-récit opposable à l’univers mort, rationnel, mécanique que décrit la vision stérile de Newton. Goethe est persuadé que la personnalité de chacun, de chacune – et sa résilience – est un matériau composite, fait des relations qui la tissent ou le tissent à l’intérieur même de l’étoffe de la vie.»
Il envisage la nature comme «toujours changeante, en flux continuel» (p.355).
«Goethe ressent et vit l’expérience empathique avant que ce sentiment reçoive un nom. ‘Me mettre dans la situation des autres, comprendre toute espèce d’individualité humaine et m’y intéresser, écrit-il, c’est affirmer l’unité de la vie’. Être ‘dans l’ensemble’: pour Goethe, cet élan ne s’arrêtait pas aux limites de notre espèce, mais s’étendait à la totalité de la nature» (p.356).
Face aux menaces qui nous inquiètent et nous embrouillent, dans une réalité complexe qui rend difficile notre discernement, nous recherchons éclairages et chemins. La vision de Jeremy Rifkin nous apporte un éclairage auquel nous ajouterons pour notre part une dimension spirituelle telle que nous la découvrons dans le livre de Michel Maxime Egger Écospiritualité (6). Jeremy Rifkin nous propose aussi un chemin. La prise de conscience des méfaits de l’héritage de l’âge du progrès débouche sur la mise en œuvre de nouveaux atouts en terme de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques et de nouvelles valeurs. Dans ce livre comme dans ses précédents, Jeremy Rifkin nous ouvre une nouvelle manière de voir.
Illustration: Jeremy Rifkin lors d’une conférence à la BCE en 2017.
(1) Jeremy Rifkin, L’âge de la résilience. La terre se réensauvage, Il faut nous réinventer, Les liens qui libèrent, 2022 (édition originale: The Age of Resilience: Reimagining Existence on a Rewilding Earth, St. Martin’s Press, 2022).
(2) Face à la crise, un avenir pour l’économie, Vivre et Espérer, 15 février 2012. À propos de Jeremy Rifkin, La Troisième Révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde, Les liens qui libèrent, 2012 (édition originale: The third Industrial Revolution, 2011).
(3) Le New Deal Vert, Vivre et Espérer, 2 novembre 2019. À propos de Jeremy Rifkin. Le New Deal Vert Mondial. Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028, Le plan économique pour sauver la vie sur terre. Les liens qui libèrent, 2019.
(4) Vers une civilisation de l’empathie, Témoins, 3 octobre 2011, À propos de Jeremy Rifkin, Une nouvelle conscience pour un monde en crise, Vers une civilisation de l’empathie, Les liens qui libèrent, 2011.
(5) Comment nous reconnecter au vivant, à la nature?, Vivre et Espérer, 5 mai 2022. À propos d’Anne-Sophie Novel, L’enquête sauvage, Pourquoi et comment renouer avec le vivant, Salamandre/Colibris, 2022. Également sur notre site.
(6) Écospiritualité, Vivre et Espérer, 1er février 2022. À propos de Michel Maxime Egger, Écospiritualité, Réenchanter notre relation avec la nature, Jouvence, 2018. Également sur notre site.





