La catastrophe comme fondement du progrès ?
«Faut-il prendre le pire au sérieux ?» Face aux «événements accablants dont nous sommes les victimes apparemment désarmées, voire soumises ou consentantes», ne faut-il pas «apprendre à concevoir l’inconcevable, à nommer l’inhumanité qui habite notre humanité» ? En s’aidant des pensées de Benjamin, Jonas, Anders, Ellul ou Dupuy, Jean-Paul Sanfourche propose de «se projeter dans un futur où la catastrophe aurait déjà eu lieu, puis revenir en arrière pour en déduire ce qu’il faut faire»: c’est à dire un «changement radical de paradigme» comparable à celui mis au jour en 1922 par la victoire d’Einstein sur Bergson, du temps mesurable et technicien sur le temps subjectif et humain.
«Le progrès et la catastrophe sont l’avers et le revers d’une même médaille» (Hanna Arendt (1)).
«Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe»
(Walter Benjamin (2)).
Donner du sens à ce qui n’en a peut-être pas
La lecture de la presse quotidienne devient une véritable épreuve, tant notre époque est confrontée à ce que les commentateurs appellent communément et indistinctement des «crises» ou des «catastrophes». Nos capacités morales ou psychologiques ne nous permettent plus d’en comprendre et d’en mesurer les effets. Les unes et les autres relèvent des dérèglements climatiques, de conflits meurtriers ou de bouleversements économiques qualifiés de systémiques (le recours à cet adjectif devient systématique, parfois en lieu et place de structurel) aujourd’hui provoqués par des ingénieurs du chaos dont les palinodies menacent autant l’avenir de leur pays que celui de l’Europe et du monde. Notre avenir. Ils provoquent avec un stupéfiant manque d’empathie (mais ce mot est-il bien convenable aujourd’hui ?) et de responsabilité la lente dégradation de nos vies. Ils se révèlent incapables de cette «pitié anticipatrice», belle formule d’Hans Jonas (3), de cette compassion pour les générations futures. Certes, ils ne se font aucun souci quant à la préservation de la dignité humaine au présent comme dans le temps long de l’avenir ! Dignité mise à mal par des leaders prédateurs imprévisibles dont les décisions erratiques sont sidérantes et semblent paralyser toute riposte rationnelle face à l’imprévisible. Faudra-t-il définitivement inscrire nos vies dans la tension permanente de l’incertitude entretenue et dans l’attente de jours meilleurs ? Il est vrai que l’incertitude a toujours fait partie de nos vies, et que la modernité l’a toujours plus ou moins bien intégrée. Mais à ce point… ! Il semble qu’on soit en droit, plus que jamais, de s’étonner de ce qui ressemble à un dangereux manque de conscience collective ou, plus exactement, à une cruelle absence d’émotion face aux événements accablants dont nous sommes les victimes apparemment désarmées, voire soumises ou consentantes. Apathie qui relève d’une incompréhension, d’une incapacité à donner du sens à ce qui n’en a peut-être pas. Comme si le pire, toujours possible, n’était cependant pas encore envisageable ou relevait de la fatalité paralysante. Cette apparente indifférence est-elle due à l’accumulation des catastrophes auxquelles nous nous habituerions ou témoigne-t-elle de notre incapacité à penser l’avenir ?
Deux temporalités en crise
Un philosophe et un sociologue contemporains, Jean-Pierre Dupuy et Ulrich Beck, inscrivent leurs réflexions, certes malgré de notables différences, dans la perspective d’une problématique qui leur est commune: celle qu’ont nos sociétés à générer, à subir, voire à tenter de résoudre les risques accrus inhérents à leurs évolutions techniques. Leurs écrits se rejoignent sur l’analyse d’une modernité qui voit dans ses progrès les germes de ses risques, de ses crises (4), de ses éventuelles catastrophes. Loin de vouloir ici faire un rappel de pensées ou de penseurs critiques du progrès technique comme certaines marques font un rappel publicitaire de produits avariés, nous voudrions à nouveau insister sur des liens, qui nous semblent évidents, de forte parenté intellectuelle entre Bergson, Ellul et Anders. Et tenter de cerner les origines philosophiques de ce basculement de paradigme d’une société moderne – qui a cru au mythe de la fin de l’histoire (!) – à une société post-moderne désormais profondément inscrite dans le vertige de l’incertitude inhérente au risque et à la catastrophe. Basculement dû, selon nous, à l’effacement progressif d’un temps essentiellement subjectif, existentiel, au profit d’un temps objectif, non vécu, reconfiguration temporelle où la technique joue un rôle non négligeable. Certains penseurs de la post-modernité, conscients de ce clivage de notre rapport au temps, semblent estimer indispensable de ré-articuler ces deux temporalités en crise. C’est ainsi que nous interprétons le concept de «catastrophisme éclairé» développé par Jean-Pierre Dupuy (5).
Un différend philosophique: l’histoire d’un revers
Il nous semble nécessaire, pour comprendre cette crise du temps, d’évoquer la rencontre entre Einstein et Bergson. C’est à nos yeux un événement essentiel, fondateur en quelque sorte de ce basculement paradigmatique qui inaugure nos démocraties techniques. En 1922, lors d’une séance de la Société française de philosophie, à laquelle Bergson assiste, Einstein vient présenter les implications philosophiques de la théorie de la relativité (6). Bien que peu connu, ce fut assurément un moment intellectuel historique. Un échec aussi pour le philosophe (7). Le temps fut l’objet de leur débat. Les deux savants en ont deux conceptions radicalement différentes, source d’un désaccord fondamental. Selon le philosophe, le temps n’était pas une simple quantité mesurable, comme une «horloge» qui avance, mais une expérience vécue, subjective et qualitative. Un temps subjectif, un temps humain, que Bergson, on le sait, nomme durée. Une heure d’attente peut sembler une éternité comme une heure de lecture peut sembler un instant. Le physicien y oppose un temps conçu comme une dimension objectivement mesurable, liée à l’espace. Sa théorie de la relativité, puisque c’est ce dont il s’agit, montre que le temps peut être affecté par la vitesse ou la gravité. Entre durée et dilatation du temps, conceptions incompatibles du temps, entre l’expérience personnelle, propre à chacun de nous, et l’objet mesurable des lois de la physique s’inscrit l’écart entre philosophie et science. Cet écart préfigure celui qui se creuse dangereusement, inéluctablement, entre monde objectif et froid de la technique ou de la technologie et monde vivant, foisonnant et humble de la pensée humaine. C’est dans cet écart que Günther Anders et Jacques Ellul, entre autres, peuvent être lus. Dans l’écart, au sens de ce qui sépare, de ce qui délie et oppose, entre un temps scientifique, une grandeur physique, un temps calculable et mesurable et un temps anti-technique, non quantifiable. Spirituel. Le temps d’Einstein est celui de la technologisation de nos sociétés.
Des penseurs prophétiques: Bergson, Anders, Ellul, Benjamin…
Dans le sillage de cette critique résolue d’une vision mécaniste du temps, s’inscrit l’analyse ellulienne de la technique en tant que système autonome engendrant une temporalité propre, quantifiable car dominée par l’urgence et l’efficacité. Le temps devient alors fonctionnel, fragmenté, dominé par l’instant présent. Le temps de la technique, au sens large du terme, se substitue au temps humain ou le déforme et l’infléchit vers un temps accéléré, sans mémoire, et, tragiquement, sans apparente finalité. Un temps de l’immédiat. Notre obstination à trouver encore du sens au monde que nous habitons s’explique peut-être moins par l’irrationalité des événements que par ce sentiment croissant que notre temps humain s’absorbe, se délite pour ne pas dire s’altère ou se décompose dans ce temps de l’immédiat, dans un présent sans mémoire et sans finalité. Comme si nous voulions raisonnablement (!) «rattraper l’état atteint aujourd’hui par la technique parce que cet état [nous] précède» (8), écrit Günther Anders. Ce décalage temporel entre l’homme et la production technique provoque un sentiment d’impuissance. Mais cela va beaucoup plus loin, selon lui. De sujets historiques – qui participent à l’Histoire – nous ne sommes plus «co-historiques» (9) à l’Histoire, mais à «l’Histoire de la technique». Déshumanisés et déshistoricisés en quelque sorte, dans cette crise du temps qui modifie conséquemment notre rapport aux autres. Et peut-être bientôt à nos institutions et à l’État… Il semble que nous ne réalisions pas la nature de la catastrophe à venir, que nous ne mesurions pas toutes les conséquences humaines, sociales et politiques envisageables de cette asymétrie temporelle. Ce que nous appelons crise du temps, qui peut être interprétée comme un effondrement de la maîtrise temporelle (10) nous semble au cœur du malaise post-moderne. Peut-on parler d’une nouvelle anthropologie du temps ?
Pour paraphraser Walter Benjamin (11), nous pourrions nous exclamer: «S’effarer que les événements que nous vivons soient encore possibles au 21e siècle, c’est marquer un étonnement qui n’a rien de philosophique !».
Ré-articuler deux temporalités en crise ?
Constance von Briskorn, dans un article (12) inspiré par les travaux de Jean-Pierre Dupuy, développe le concept hardi et ambitieux d’une «rationalité du catastrophisme». En effet, Jean-Pierre Dupuy, ingénieur et philosophe français, s’appuyant implicitement sur l’héritage des Lumières (13), tente d’intégrer la catastrophe dans le champ de la rationalité (14). Dans sa pensée, éclairée, engagée (et chrétienne), la catastrophe pourrait se détacher du champ sémantique de l’inéluctable Elle doit devenir objet de réflexion. En cela l’entreprise est éthique, au sens kantien, non parce qu’elle est efficace mais parce qu’elle répond d’abord à un «impératif moral» universel. La responsabilité envers les générations futures est «un impératif moral»: celui de penser l’avenir même face à ce qui apparaît comme l’inévitable. Il s’agit en somme de rendre la catastrophe pensable philosophiquement sans la mythifier ou la minimiser. N’est-ce pas au fond ce que suggérait déjà Camus dans L’Homme révolté: accepter l’absurde sans s’y résigner ? C’est une éthique de la responsabilité, fondée sur une ontologie du temps, sur ce que la technique a aussi fait du temps, le temps de la catastrophe. Ainsi Hans Jonas mais aussi Jacques Ellul et Günther Anders, qui traitent avec une étonnante lucidité de cet aspect, ne sont pas étrangers à la pensée de Jean-Pierre Dupuy qui les cite souvent. Quand l’insensé devient envisageable donc possible, quand l’éventuel fracasse le réel, il y a quelque chose de rassurant (si l’on peut dire !) à l’idée que la catastrophe puisse être, sur un plan philosophique (et non politique), être pensée dans le champ de la rationalité.
L’apprentissage du danger
Sans entrer dans de trop longs détails, ce qui excéderait les limites raisonnables de cette contribution, avec le concept de «catastrophisme éclairé» Jean-Pierre Dupuy propose une approche plus dynamique et prospective. Au lieu d’être fatale, la catastrophe (ou la crise) peut devenir le levier d’une transformation de l’approche éclairée et adaptative du temps. Selon Ulrich Beck, la modernité se caractérise par la diffusion et la mondialisation de risques «fabriqués par l’homme». Tout comme Jean-Pierre Dupuy souligne que cette modernité crée et accumule les dangers potentiellement catastrophiques. Si les deux penseurs admettent qu’il convient d’éveiller nos consciences à ces risques, Ulrich Beck insiste sur la nécessité de repenser les institutions et les mécanismes de gouvernance alors que Jean-Pierre Dupuy privilégie une «réflexion anticipatrice». Il ne nie pas la survenue de crises majeures mais insiste sur leur compréhension sans en prévenir leur caractère inéluctable. Ce sont les points de rupture qui doivent permettre de repenser et réorienter les actions humaines. Loin de l’acceptation fataliste, étrangère à la tentation de la résignation, Jean-Pierre Dupuy envisage la crise comme l’opportunité d’une sorte «d’apprentissage du danger» où la catastrophe jouerait le rôle de catalyseur en vue de transformations structurelles positives. Le philosophe met un accent particulier sur la simulation, l’anticipation et la scénarisation (scénario) comme outils pour comprendre et préparer le bouleversement toujours possible, fût-il inhumain. Dans ce sens, sa démarche se veut opérationnelle et orientée vers l’identification des conditions de passage d’un système «risqué» à un système «résilient». Tandis qu’Ulrich Beck propose une analyse sociologique globalisante qui souligne l’érosion des institutions traditionnelles, Jean-Pierre Dupuy insiste sur la capacité à «maîtriser» en partie ces risques par une gestion éclairée et une compréhension systémique des phénomènes de rupture.
Concevoir et anticiper l’inéluctable pour mieux le maîtriser
Sans les citer, Jean-Pierre Dupuy dans son concept de «catastrophisme éclairé» fait étrangement écho à Hannah Arendt et à Walter Benjamin. Sa pensée anticipatrice s’élabore selon un système tendant à maîtriser ce décalage temporel décrit par Günther Anders. L’événement de la catastrophe est prévisible, car il est déjà inscrit dans notre présent, comme l’avers et le revers d’une même pièce. Il ne s’agit plus d’un avenir hypothétique, possible, auquel on croirait plus ou moins et que l’on occulterait prudemment ou inconsciemment, mais d’une composante déjà inscrite dans notre actualité et qui la constitue. Il faut accepter de penser que l’impensable peut se réaliser et se réalisera, il faut accepter l’inéluctable comme une réalité pour mieux agir en conséquence. Croire en l’inéluctabilité de la catastrophe, surtout ne pas la nier ou la déclarer impensable, irréalisable. Contrairement à des approches basées sur le «principe de précaution» ou sur l’idée que les catastrophes peuvent être évitées par des ajustements progressifs, Jean-Pierre Dupuy propose une posture où l’on croit à la catastrophe comme si elle était déjà inscrite dans le futur immédiat. Cette croyance permet de mobiliser les individus pour éviter qu’elle ne se réalise pleinement.
Une rationalité éthique
«L’intelligence des catastrophes doit nous conduire au ‘catastrophisme’» (15). Position qui peut apparaître éminemment éthique: penser le malheur comme catastrophe si l’on veut l’éviter pour soi-même et les générations futures. Nous retrouvons ici l’influence philosophique de Bergson, du moins une épistémologie inspirée par le philosophe. Jean-Pierre Dupuy remet en question la rationalité instrumentale moderne, qui tend à réduire les risques à des calculs probabilistes. Il propose une forme de rationalité éthique qui dépasse cette logique en intégrant les dimensions morales et existentielles des décisions liées aux catastrophes à «l’idée de catastrophe». Cela implique une révision profonde de notre rapport au temps et à l’incertitude (16). C’est donc aussi rendre hommage à Walter Benjamin qui est selon nous le véritable initiateur (méconnu ?) de cette philosophie émergeante: «Il faut fonder le concept de progrès sur l’idée de catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe».
La logique du tragique
«La prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle ne se réalise», écrit Hans Jonas, dans Le Principe Responsabilité. Les critiques parfois violentes et partisanes adressées à Jean-Pierre Dupuy sont cependant compréhensibles de la part de ceux qui refusent obstinément l’idée que les sombres crépuscules annoncent (parfois) des aurores éblouissantes. Il faut apprendre à concevoir l’inconcevable, il faut apprendre à nommer l’inhumanité qui habite notre humanité. En avoir le courage. Il faut accepter que la philosophie aussi puisse contribuer au franchissement de ces seuils, au sens éthique que Josepha Faber Boitel, par exemple, leur donne ici même (17). L’impensable habite notre hic et nunc. On peut le combattre en sachant l’anticiper, l’identifier, le désigner, le nommer. Pour mieux l’affronter et réparer. Certes, cette crise du temps ne sera pas résolue uniquement en conjuguant le présent au futur antérieur (18), mais il est essentiel qu’une philosophie morale nous aide à en prendre conscience pour mieux cerner la vérité de la catastrophe et peut-être la conjurer. Pour mieux avoir le sens du tragique, intimement lié à l’accélération du temps de la technique effaçant le temps humain. La conscience du tragique est celle qui analyse le présent non comme une étape vers un futur meilleur, mais comme le temps même où se joue la catastrophe (19). Cette logique du tragique rompt avec l’optimisme progressiste post-moderne. Walter Benjamin est à l’origine de cette réflexion contemporaine sur la catastrophe, puisqu’il la conceptualise plus comme un processus continu que comme un événement. Sous les couleurs d’un «marxisme nostalgique», il retrouve les accents d’une épistémologie bergsonienne. Le philosophe Paul Virilio parle, lui, d’«événement intégral», «conséquence inéluctable du progrès technique» (20).
La dimension du sacré
Un autre titre aurait pu s’imposer à notre contribution: faut-il prendre le pire au sérieux ? Nous en faisons chaque jour l’expérience inquiète: nos sociétés démocratiques apparaissent faibles et fragiles parce qu’elles se montrent incapables de réagir à temps. Une analyse personnelle me conduit à penser que cela tient en partie à une incapacité cognitive et morale. D’où cette apparente inconscience soulignée en introduction. Nous ne voulons pas imaginer ce que nous savons intellectuellement. Nous donnons à la catastrophe un caractère de probabilité alors qu’elle est une certitude pour l’avenir. Au lieu de se mobiliser en aval, nos esprits doivent le faire en amont, car, selon Jean-Pierre Dupuy, pour résumer trop rapidement sa pensée, et selon la logique du futur antérieur, il convient de se projeter dans un futur où la catastrophe aurait déjà eu lieu, puis revenir en arrière pour en déduire ce qu’il faut faire. Changement radical de paradigme et tentative de résoudre – partiellement peut-être – la crise des deux temporalités, celle du temps technicien et celle, trop oubliée, de l’existence et de la finitude de l’être.
Nous voudrions conclure par ce qui, à nos yeux, nous semble essentiel. Jean-Pierre Dupuy appelle au retour à une forme de «sacré laïque», comme limite symbolique et morale à la toute-puissance technicienne. Il ne s’agit donc pas seulement de rationaliser le risque, mais de retrouver une dimension sacrée, une pensée du mal et de la limite. La catastrophe, en tant que mal radical (Kant, Hannah Arendt), nous oblige à repenser notre rapport au mal, à la responsabilité et à la temporalité.
PS: nous avons choisi de ne faire aucune référence aux événements de toutes les natures qui troublent et menacent aujourd’hui notre monde. Sans nul doute, les lecteurs et lectrices auront su les identifier.
Illustration: portrait photographique de Henri Berson dans les années 1930 (coupure de journal extraite d’un dossier documentaire rassemblé par Georges Desdevises du Désert en 1938, CC BY-SA 4.0)
(1) Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (The Human Condition, 1958).
(2) Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Payot, 1982, p.342.
(3) Hans Jonas, Pour une éthique du futur, Payot, 1998.
(4) «La création de ce que l’on appelle l’intelligence artificielle porte en elle la tentation d’abandonner notre humanité à des machines statistiques», Alberto Manguel, discours de clôture du colloque organisé par la BNF sur la bibliothèque de demain. 31 mars 2025, pour les trente ans du site François Mitterrand, Le Point, 10 avril 2025, p.118.
(5) Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est certain, Seuil (La couleur des idées), 2002. D’Ulrich Beck, précédemment cité, nous ferons implicitement référence à son ouvrage: La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité. Flammarion (Champs essais), 2008. Nous aurions pu également mentionner l’essai collectif de Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Points Essais, 2014 (Seuil (La couleur des idées), 2001). Essai qui se lit dans le sillage de L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders.
(6) À propos de la controverse, consulter: Jimena Canales, Einstein, du Collège de France à la Société française de philosophie, in Antoine Compagnon et Céline Surprenant (éd.), Einstein au Collège de France, Collège de France (Passage des disciplines 3) 2020.
(7) «Einstein a riposté avec toute son énergie, sa force et ses ressources. Dans les années qui suivirent, Bergson fut largement perçu comme ayant perdu le débat face au jeune physicien. Les vues du scientifique sur le temps finirent par dominer la plupart des discussions savantes sur le sujet, mettant en suspens non seulement celles de Bergson, mais aussi celles de nombreuses autres approches artistiques et littéraires, en les reléguant au second plan. Pour beaucoup, la défaite de Bergson représentait une victoire de la ‘rationalité’ sur l »intuition’. Elle marqua un moment où les intellectuels n’étaient plus en mesure de suivre les révolutions scientifiques en raison de leur complexité croissante. C’est pourquoi ils devaient s’en tenir à l’écart. La science et ses conséquences devraient être laissées à ceux qui en savaient quelque chose – les scientifiques eux-mêmes. Ainsi commença « l’histoire du revers, après une période de succès sans précédent, de la philosophie du temps absolu de Bergson – incontestablement sous l’impact de la relativité ». Plus important encore, commença alors la période où la pertinence de la philosophie déclina face à l’influence croissante de la science» (Jimena Canales, The Physicist & the Philosopher: Einstein, Bergson, and the Debate That Changed Our Understanding of Time, Princeton University Press, 2015, p.6, traduction Google, voir le premier chapitre).
(8) Günther Anders, L’obsolescence de l’homme, tome 2, Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle, traduction de Christophe David, Éditions Fario, 2011, pp.286-287.
(9) Ibid., p.287: «S’il y avait aujourd’hui un impératif catégorique il ne concernerait pas notre rapport aux autres hommes, à la communauté, ou à la société, mais notre rapport à l’état actuel ou à venir de la technique. Il dirait: « Agis de telle façon que la maxime de ton action puisse être celle de l’appareil dont tu es ou va être une pièce. » Ou, négativement: « N’agis jamais de telle façon que la maxime de ton action contredise les maximes des appareils dont tu es ou va être une pièce. »»
(10) L’incompréhension du chaos dans lequel, du jour au lendemain, un chef d’État plonge les échanges commerciaux et les paiements mondiaux peut s’analyser au filtre de cette crise temporelle. Effondrement du temps unifié, avènement d’une temporalité heurtée, fragmentée. Temps technicisé, perte du sens d’un projet historique unificateur. Les décisions se succèdent, contradictoires, dans un effet accéléré de surenchère et l’instant succède à l’instant, en l’absence de tout passé, de toute projection vers l’avenir.
(11) Walter Benjamin, Thèses sur la philosophie de l’histoire (Über den Begriff der Geschichte, dernier écrit de Benjamin en 1940). Dernière édition en français: Sur le concept d’histoire, traduction d’Olivier Mannoni, Payot (Petite bibliothèque), 2017.
(12) Chantiers politiques, Penser la catastrophe: nouveau plaidoyer pour un « catastrophisme éclairé », Nonfiction, 12 décembre 2010.
(13) Ce qui lui vaut la critique des dé-constructionnistes !
(14) Il rappelle que Kant affirmait que la raison humaine était capable de penser le mal radical et d’y opposer une action morale fondée sur la responsabilité.
(15) «Le principe de précaution considère que les risques sont d’autant mieux maîtrisés qu’ils sont rapportés à notre responsabilité. Or force est de constater qu’une telle proposition est inefficace: nous ne faisons rien pour éviter les grandes catastrophes écologiques dont nous savons pourtant, de source sûre, qu’elles se dérouleront. N’est-ce pas plutôt alors en invoquant la fatalité des catastrophes, c’est-à-dire en nous référant à ce qui leur donne précisément leur dimension catastrophique, que nous parviendrons à les éviter ? Le catastrophisme est la meilleure des protections» (Florent Guenard et Philippe Simay, Du risque à la catastrophe, À propos d’un nouveau paradigme, La Vie des idées, 29 mai 2011).
(16) Jean-Pierre Dupuy , «On peut ruser avec le destin catastrophique», Critique (Penser la catastrophe) 2012/8, pp.729-737.
(17) Josepha Faber Boitel, Le seuil du chaos (3), hic et nunc: Tikkun Olam et la mémoire en éclats, Forum protestant, 4 avril 2025.
(18) «Ce qui aurait dû être fait pour éviter ce qui est arrivé», «Il faut penser que le pire est inévitable pour qu’il ne le soit pas», écrit Jean-Pierre Dupuy (Pour un catastrophisme éclairé). Il faut également noter que le philosophe fait de nombreuses références à Heidegger en s’appuyant le concept de Gestell (le dispositif), à savoir l’arraisonnement du monde par la technique, qui transforme tout (et tous) en ressources (cf. l’affreuse expression ressources humaines).
(19) Jean-Baptiste Fressoz, Les leçons de la catastrophe, Critique historique de l’optimisme postmoderne, La Vie des idées, 13 mai 2011.
(20) « Le krach actuel représente l’accident intégral par excellence », Paul Virilio interrogé par Gérard Courtois et Michel Guerrin, Le Monde, 18 octobre 2008.
2 Commentaires sur "La catastrophe comme fondement du progrès ?"
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.


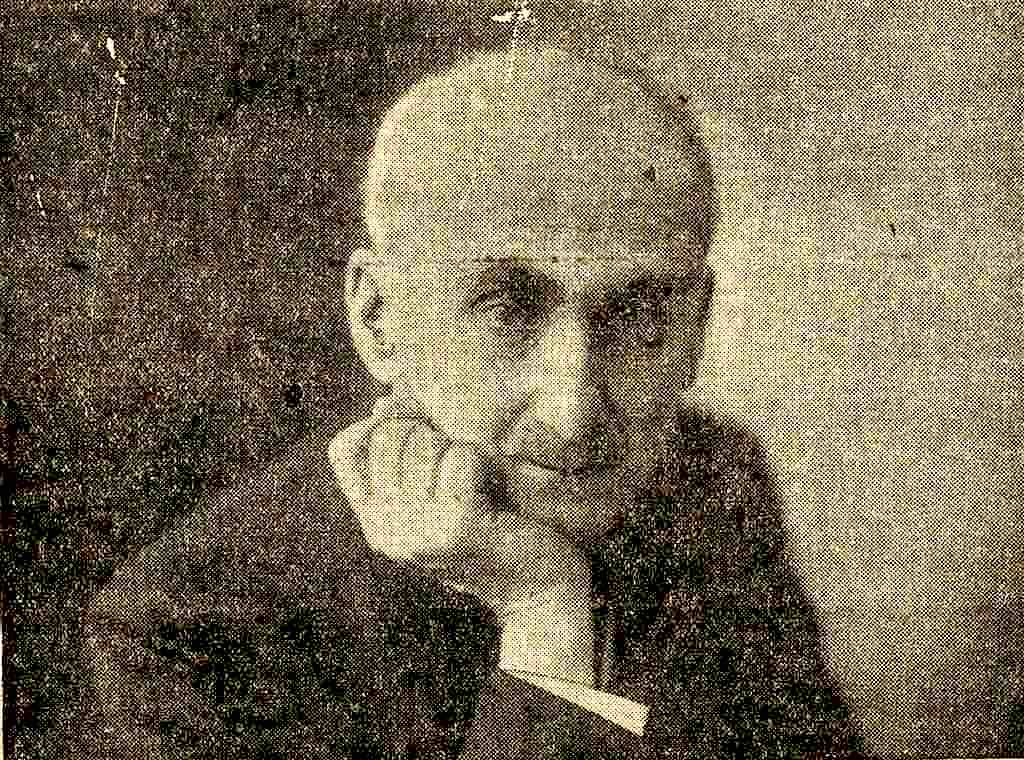



Votre article m’a profondément touché par la lucidité de son propos et la rigueur de sa pensée. Vous articulez avec clarté trois réflexions majeures : la crise du sens face à l’accumulation d’événements tragiques ; la crise du temps, où l’accélération technique désintègre notre expérience intérieure ; et enfin, l’appel à une éthique du catastrophisme, non comme renoncement, mais comme posture responsable face à l’avenir.
J’ai particulièrement apprécié la mise en perspective philosophique du temps, entre Bergson et Einstein, ainsi que votre manière de penser la vigilance non dans la peur, mais dans une forme de lucidité morale. Ce texte éclaire sans asséner, interroge sans désespérer. Une lecture précieuse, à l’image de l’ensemble de vos articles : exigeante, stimulante, toujours d’une grande qualité.
Madame,
Ne relisant que très rarement mes contributions, je ne prends connaissance, et par un pur hasard, de votre commentaire qu’aujourd’hui. Aussi suis-je confus d’y répondre avec retard. Je vous prie de m’excuser. Votre analyse sensible et profonde (vos propres articles en témoignent), si pertinente, me touche et je tiens à vous remercier. Je vous en suis d’autant plus reconnaissant qu’elle ajoute à ces modestes lignes un riche éclairage pour d’éventuelles futures lectures. L’idée que parfois nos réflexions se croisent et se complètent me comble et m’honore.