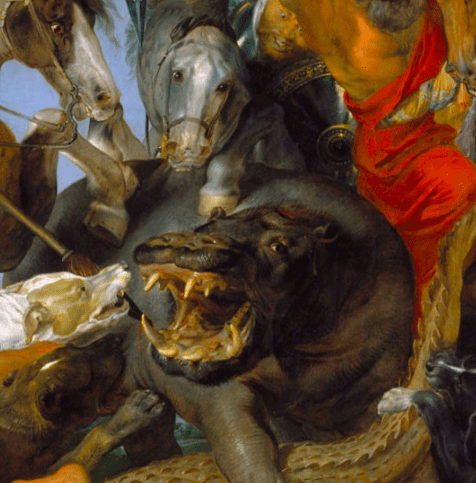Le surplus de subsistance
« Comme il n’y a rien de plus compliqué à percevoir que l’intérêt général, il faut un ajustement constant entre l’exploration par la société civile des affaires qui la préoccupent et les applications par l’administration des compétences que la société lui a déléguées. À tout moment, aussi bien la société que l’administration peuvent arrêter de poursuivre le bien commun et se corrompre. Soit que la société civile ait renoncé à prendre sur elle de décrire sa propre situation et qu’elle s’en soit remise trop longtemps à l’État du soin de la mener dans le bon sens – il y a dépolitisation générale par le bas – ; soit que l’administration, se croyant dépositaire à vie de l’intérêt général, imagine de résoudre par elle-même les questions qui lui avaient été confiées sans s’assurer du relais de la société civile – il y a dépolitisation par le haut. »
« La crise sanitaire actuelle est d’une telle dimension qu’elle commence à donner une petite idée des crises à venir imposées par la mutation climatique. » Intéressé par les « rapports entre ce qu’exigent les gouvernements et ce que les sociétés considèrent comme acceptable », Bruno Latour voit un « contraste entre l’autorité dont dispose l’État pour imposer des mesures concernant la santé, au sens traditionnel du terme, et celle dont il disposerait s’il en venait à nous imposer des mesures drastiques pour notre santé, au sens élargi qu’impose l’écologie ». Cette différence tient selon lui à ce que, « quand il s’agit de santé et de protection de la vie, on bénéficie de plusieurs siècles derrière nous au cours desquels la société civile a pris l’habitude de s’en remettre à l’État et, en gros, malgré d’innombrables critiques, à lui faire confiance ». Or « la situation est entièrement différente avec les questions dites écologiques » sur lesquelles il n’y a pas « de volonté générale partagée entre l’administration et le public, puisque ni le public ni l’État ne partagent des conceptions communes sur ce qu’il convient de faire ». D’une part parce que « chaque décision de l’État se trouve en conflit radical ou partiel avec les nécessités de la transition » écologique, d’autre part parce que, « si la société civile accepte de déléguer à l’État le rôle protecteur contre les épidémies, elle ne s’est pas encore décidée, si l’on peut dire, à lui offrir cette même autorité pour l’aider à traverser l’expérience encore plus traumatique d’une mutation complète des sociétés industrielles. L’État, dans ce cas-là, ne représente pas la volonté générale, parce que, tout simplement, la société civile n’a pas non plus d’idées précises et « générales » sur sa dite « volonté ». Elle est donc dans l’impossibilité de déléguer à l’administration la tâche de mettre en œuvre ce qu’elle « veut », faute de le savoir elle-même. »
(21 mai 2020)