Éric-Emmanuel Schmitt (1): « La foi demande qu’on plonge »
«Tout avait du sens.» Revenant avec Jean-Luc Gadreau pour Solaé sur sa «nuit de feu» dans le Hoggar et sur ses suites, Éric-Emmanuel Schmitt y voit la confirmation que «Dieu n’est pas un objet de savoir»: «J’habite cette ignorance avec confiance: je vis dans le Mystère. Le Mystère, ce n’est pas l’absurde, ce n’est pas l’absence du sens, c’est la promesse du sens». Une expérience de retournement ou plutôt de rappel que partage le dramaturge Jean-Marie Perinetti pour qui Jésus «était là, il n’avait pas bougé, il n’était même pas en colère ni frustré».
Émission Solaé, le rendez-vous protestant L’avent avec Éric-Emmanuel Schmitt (1/4), La rencontre, du dimanche 1er décembre 2024 sur France Culture.
Jean-Luc Gadreau: Partons à la rencontre d’un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Il est agrégé de philosophie, docteur, homme de théâtre, passionné de musique, membre de l’Académie royale de la langue et littérature françaises de Belgique, membre du jury Goncourt, dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur et comédien… Cet invité, c’est Éric-Emmanuel Schmitt.
Éric-Emmanuel Schmitt: J’ai l’impression que vous ne faisiez pas le portrait d’un homme mais d’un couteau suisse !
C’est vrai qu’il y a un peu de ça ! Homme de culture, peut-être, est une expression qui vous résumerait bien ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Ou courroie de transmission de la culture. C’est comme ça que je me vis car j’ai envie de partager au plus grand nombre ce à quoi j’ai eu accès.
Pour nous accompagner dans cette discussion: Jean-Marie Perinetti, metteur en scène et étudiant en théologie à l’Institut protestant de théologie, en vue de devenir pasteur. Pour entrer dans la thématique Rencontrer Dieu, voici un extrait d’un sketch de Raymond Devos:
«Récemment j’ai vu marqué sur un mur: « Dieu existe, je l’ai rencontré »… Ça, ça m’étonne !… Que Dieu existe, la question ne se pose pas. Mais que quelqu’un l’ait rencontré avant moi ?… Ça, ça m’étonne ! Parce que j’ai eu le privilège de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de lui, dans un petit village de Lozère, vous savez, abandonné des hommes, il n’y avait plus personne ! Et en passant devant la vieille église, touché par je ne sais quel instinct, je suis entré… Et là, j’ai été ébloui par une lumière intense, insoutenable… c’était Dieu ! Dieu en personne ! Dieu qui priait…»
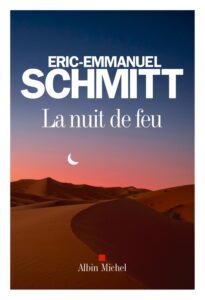 Rencontrer Dieu, vivre une expérience spirituelle intense qui transforme la vie, c’est une chose que vous avez en commun, Éric-Emmanuel Schmitt et Jean-Marie Perinetti. De votre côté, Éric-Emmanuel, un livre raconte cette histoire, La Nuit de feu (1). Vous aviez 28 ans, vous étiez dans le désert du Hoggar pour écrire le scénario d’un film sur Charles de Foucauld. Et puis, quelque chose s’est produit… Une révélation ? Une expérience ?
Rencontrer Dieu, vivre une expérience spirituelle intense qui transforme la vie, c’est une chose que vous avez en commun, Éric-Emmanuel Schmitt et Jean-Marie Perinetti. De votre côté, Éric-Emmanuel, un livre raconte cette histoire, La Nuit de feu (1). Vous aviez 28 ans, vous étiez dans le désert du Hoggar pour écrire le scénario d’un film sur Charles de Foucauld. Et puis, quelque chose s’est produit… Une révélation ? Une expérience ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Une «nuit de feu», comme le disait Blaise Pascal, qui, lui aussi, est passé en une nuit de l’incroyance à la croyance. Je suis né athée dans une famille athée, j’ai reçu une instruction athée. J’étais élève de Jacques Derrida à Normale Sup’, j’ai fait ma thèse sur Diderot… Donc autant vous dire que je l’avais creusé, l’athéisme ! Je n’étais pas un athée souffrant et espérant autre chose, j’étais vraiment sans attente.
«Une révélation, c’est une révolution»
À ce moment-là, aucune recherche particulière de ce point de vue, donc ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Une recherche intellectuelle, mais pas existentielle. Ça ne touchait ni ma chair ni mes sentiments. Et c’était problématique, la question de Dieu. Enfin, nous avons tous en nous la question de Dieu, c’est même le minimum syndical de la présence de Dieu en chacun de nous. Ce voyage était donc une grande marche de 10 jours dans le désert. Avec un groupe de 10 personnes, nous avons fait l’ascension du mont Tahat, le plus haut sommet du Hoggar, et quand nous sommes arrivés au sommet, assez exalté par la beauté du lieu, l’infini, j’ai dit à tout le monde: «Je passe devant». Personne ne me connaissait bien car, si cela avait été le cas, on m’aurait empêché de me diriger tout seul, n’ayant absolument pas cette case dans le cerveau ! Au bout de deux virages, je ne savais plus du tout où j’étais. Je suis descendu, enthousiaste, avec une allégresse qui à mon avis était le pressentiment d’un rendez-vous, puis, arrivé au bas de la montagne, je me suis dit que le campement devait être juste derrière le rocher duquel je m’approchais. Mais derrière, il n’y avait rien du tout: je m’étais perdu.
J’ai alors éprouvé une peur intellectuelle abstraite. Je me suis dit qu’il fallait trois jours pour mourir de soif, qu’il me restait donc trois jours soit pour retrouver mon chemin, soit pour mourir. Je me suis protégé du vent (car nous étions en février) en m’installant derrière des rochers et me suis ensablé pour garder un peu de la chaleur du soleil dans le sable. Et alors que je m’attendais à passer la nuit la plus atroce de ma vie, j’ai en réalité passé la plus belle nuit de ma vie (désolé pour les personnes concernées) ! J’ai vécu une extase, une véritable extase. Une partie de moi est restée dans le sable et une autre est montée rejoindre la lumière, la force, la puissance, le sens. Dans cette expérience, bien qu’il n’y ait pas eu de paroles, j’ai reçu le message selon lequel tout avait un sens.
Quand je suis revenu dans mon corps ensablé, tout avait changé. Il y avait cette trace définitive en moi et j’étais prêt à mourir ou à vivre, puisque tout avait du sens. Quand le soleil s’est levé, je me suis rendu compte que j’étais du mauvais côté de la montagne et, pendant toute la journée, j’en ai fait à nouveau l’ascension. Une fois passé le sommet, j’ai commencé à redescendre et, heureusement, le guide touareg qui était dans l’oued où nous passions cette nuit-là m’a aperçu et m’a rejoint (car j’étais de nouveau en train de me perdre). Quand cet homme, sec comme une broussaille, m’a serré contre lui, j’ai réalisé l’écart énorme entre ce que j’avais vécu et ce que j’avais obligé mes camarades à vivre: ils avaient passé une nuit d’angoisse absolue, avaient appelé dans la montagne, avaient allumé des feux… Comment fait-on du feu dans le désert ? Il n’y a pas de bois ! Le touareg avait tiré des racines et fait de grands feux pour que je les aperçoive pendant que moi j’étais en extase de l’autre côté de la montagne…
Cette disproportion m’a rendu muet et, à l’issue de cette expérience, je n’avais d’ailleurs ni les mots ni les concepts pour dire ce qui m’était arrivé. Une révélation, c’est une révolution et il a fallu le temps de la révolution, c’est-à-dire le processus intérieur d’acceptation – j’aurais pu tout aussi bien ignorer ce qu’il s’était passé, comme le font, je crois, beaucoup de gens –, pour que j’accepte et consente à cette merveille qui m’était arrivée. Il faut ensuite trouver les mots, tout redéfinir; on ne parle plus du même endroit. Ça m’a pris un certain temps. Puis, quand j’ai commencé à en parler, j’ai vu que je n’en disais jamais assez et les gens me répétaient: il faut que tu en fasses un livre ! Mais c’est tellement difficile d’écrire là-dessus, d’en parler, car le langage est fait pour décrire le visible, pas l’invisible ! On est condamnés à la poésie, à la métaphore, à l’analogie. J’ai réfléchi longuement et puis un jour j’ai témoigné de cette expérience. On ne peut pas convaincre, on peut juste témoigner.
«Écoute, ça ne marche pas»
C’est donc le point de départ. Plus tard, vous vivrez une expérience particulière à Jérusalem qui vous a également inspiré un livre. Jean-Marie, pour vous pas de désert mais peut-être que cette expérience ravive en vous des souvenirs ?
Jean-Marie Perinetti: Oui, vraiment. Un désert intérieur… Il avait fallu que je touche le fond, c’était une période où j’avais beaucoup de mal à encaisser la mort de mon père. J’étais directeur de théâtre en Irlande, un théâtre de jeunesse, j’avais encore quatre créations programmées et, dans ma tête, je savais qu’à la fin de la quatrième j’arrêterai tout, je ne pourrais pas continuer. Et j’ai tout arrêté. J’ai annoncé à tout le monde que je m’offrais le luxe d’une année sabbatique. J’avais des amis partout dans le monde et, pendant un an, j’ai fait le globe-trotter. Au début cela m’a occupé mais au bout d’un moment je me suis senti complètement perdu. Je ne savais plus où aller et j’ai appelé à l’aide des amis en Moravie, dans l’est de la République Tchèque, leur demandant si je pouvais venir chez eux. Ils m’ont accueilli à bras ouverts et m’ont laissé la liberté de choisir le moment où je désirais repartir.
Vous étiez perdu non pas dans un désert mais à l’intérieur de vous…
Jean-Marie Perinetti: Exactement. Un après-midi, pour essayer de me rendre utile, j’avais décidé de sortir leur chien et, je traversais les champs avec le chien lorsque j’ai fait une chose que je n’avais jamais fait auparavant – je ne saurai jamais pourquoi j’ai agi ainsi –, j’ai levé la tête vers le ciel et me suis adressé au Christ alors que le Christ ne faisait pas du tout partie de ma galaxie. Jésus, oui. Jésus maître de spiritualité, de sagesse, mais pas le Christ. Je me suis adressé à lui à la deuxième personne du singulier: «Écoute, ça ne marche pas, le projet Jean-Marie Perinetti, manifestement, c’est un échec. J’ai voulu faire du mieux que j’ai pu, j’ai planifié comme j’ai pu. C’est la grande plantade alors je te rends les clés».
J’ai beaucoup de respect pour la vie, je n’allais donc pas me foutre en l’air mais c’était plutôt le service après-vente, quoi: je retourne le produit, sauf que le produit, c’est moi. Il s’est alors passé quelque chose, j’ai senti un énorme poids ôté de mes épaules et c’est comme s’il avait toujours été là. Vous disiez qu’on ne pouvait communiquer que par métaphores et l’image qui me vient – ce n’est pas de la poésie mais plutôt une image très prosaïque – c’est qu’il était en fait en ligne depuis le début ! Je lui avais dit: «Attends, ne raccroche pas, j’ai des gens à la maison». Mais ces gens sont restés 45 ans ! Et lui il était là, il n’avait pas bougé, il n’était même pas en colère ni frustré.
Il attendait le bon moment, peut-être ?
Jean-Marie Perinetti: Peut-être. C’en était resté là puis, petit à petit, je me suis posé des questions. Qu’est-ce qu’il s’était passé ce jour-là, dans ce champ ? Est-ce que c’était juste dans ma tête ? J’ai commencé à explorer le sujet et j’ai senti que je n’avais pas la langue, pas le vocabulaire. Il n’y avait pas d’application comme Duolingo ou Babel pour traduire ! Car ce n’est pas un langage qui va de soi, ou alors on croit avoir compris puis on doute. Du coup, je suis allé faire des retraites et les choses se sont confirmées. Au cours de ces retraites, on vous donne un petit passage de la Bible puis on se rend avec dans une chapelle où l’on prend 35 minutes pour y réfléchir. Pourquoi fait-on cela ? Pourquoi ? Ces textes-là sont rugueux, ce n’est pas ma tasse de thé, et je suis donc passé par tous les états dans cette chapelle avant qu’il n’y ait un grand lâchage. Tout à coup, je me suis dit: alors, passer par ce texte serait un chemin pour aller vers lui ? Et comme je suis une personne qui aime bouquiner, qui veut en savoir plus, éplucher les choses, j’ai décidé de suivre des études de théologie. Progressivement, j’ai senti que les pièces du puzzle se recomposaient et que tout cela prenait sens.
«La rencontre dézingue, dépote ou dissout»
Merci Jean-Marie pour ce témoignage. Vincent Smetana, l’homme venu de ce plat pays qui est le vôtre aussi, Éric-Emmanuel Schmitt, souhaiterait partager quelques mots sur ce thème de la rencontre.
Vincent Smetana: Pourriez-vous dire quelle a été la rencontre capitale de votre vie et jusqu’à quel point cette rencontre vous a donné ou vous donne l’impression du fortuit, du nécessaire ou de l’incontournable (demandaient André Breton et Paul Éluard dans un questionnaire évoqué par Breton dans L’Amour fou) ? Pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l’impression de renaître ? Comment se rendre disponible à ceux qui vont intensifier nos vies, nous révéler à nous-même ?
Alors oui, il y a des signes qui distinguent une vraie rencontre d’un simple croisement – on croise plein de gens mais ça ne veut pas dire qu’on les rencontre, explique le philosophe Charles Pépin dans La Rencontre (2).
Le premier signe est que je suis troublé: je ne m’attendais pas à ça, cette personne ne correspondait pas à ce que j’attendais et pourtant elle me plaît. Ça, c’est le signe que la rencontre est en train de se faire.
Second signe: je suis curieux. Soudain, moi qui suis très autocentré, trop obsédé par moi-même, il y a quelqu’un qui m’intéresse beaucoup plus que moi. Soudain je suis décentré, je dis: mais cette personne est incroyable ! Ça, ce sont des signes qu’on est en train de naître. Et pourtant, parfois ça peut foirer ! C’est dingue ça, une rencontre, aussi vitale soit-elle, pourrait-elle foirer d’une façon ou d‘une autre ?
Rencontrer Jésus, par exemple, l’homme qui voit à travers les visages ou philosophe suprême ou tout simplement homme suprême dans le splendide et singulier face à face de la rencontre. Et que lui nous donne accès à la joie de la rencontre, la sève de la rencontre, véritable élixir d’amour soudain vivement répandu dans les sinueuses venelles de nos cœurs. Traduction d’une très ancienne citation en lombard: «Ils vont à la rencontre de Christ et ils meurent». Ils meurent ! Mourir à quoi, sinon mourir à soi, mouvement soudain et magistral d’une trajectoire de vie déroutée littéralement par l’éruption vive de la foi ?
Là où l’idée de mort à soi-même est liée à ce qu’on appellerait «nouvelle naissance», la rencontre dézingue, dépote ou dissout notre ancienne nature pour que notre nouvelle nature puisse prendre toute la place. La mort à soi-même serait donc à la fois un évènement unique et momentané, tout à la fois l’incandescence d’une nuit de feu et le processus amoureux de toute une vie. Voilà une idée flippante et magnifique ! Rencontre ! Rencontre !… Déverbal féminin de rencontrer, hasard ou occasion, dit-on, fait de rencontrer fortuitement une personne mais aussi – et c’est mieux – rencontre: fait de rejoindre intentionnellement une personne, choisir d’aller au-devant de quelqu’un. Et même, plus fort encore: occasion, conjoncture de l’entrée en contact de deux natures voire de deux corps, duels, combat… Genre Jacob et l’ange dans un combat de boxe en douze reprises sur toute une nuit jusqu’à épuisement et score final: révélation d’une identité.
Alors, que celui qui a des poings frappe à la porte de la rencontre, allez ! Et le fait que nous soyons ici dans ce studio, Monsieur Schmitt et moi, ces deux messieurs de Bruxelles puis du Hainaut dont l’un a goûté de plus ou moins près à la boxe et l’autre non (je ne vous dirais pas lequel de nous deux mais en tout cas ce n’est pas moi), retenons ceci: dans la rencontre un engament, une insistance, un enchantement, tout mais surtout point de hasard.
«Être né deux fois»
Merci Vincent. Je crois que votre père, Éric-Emmanuel, était champion de boxe ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Mon père était boxeur, il était champion de France de boxe. Il a essayé de m’initier mais ça ne marchait pas du tout, je suis dépourvu d’agressivité. On m’a fait faire de l’escrime aussi… Je croyais que c’était de la danse ! Et quand il fallait monter à l’assaut, il n’y avait pas moyen. Mon père boxait et c’est moi qui ai le nez tordu !
J’ai envie de revenir sur ces mots de Vincent: «l’impression de renaître». J’ai forcément en tête cette phrase de Jésus: «Il faut que tu naisses de nouveau». C’est une expérience qui correspond à ce que vous avez vécu ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Moi, ce qui m’a frappé dans le témoignage de Jean-Marie Perinetti et qui est congruent avec mon expérience, c’est qu’on est très occupé par soi. On peut même être dégouté par soi, et il faut soit toucher le fond comme vous l’avez fait, soit être en situation de danger et perdre l’illusion de la maîtrise comme cela m’est arrivé.
Lâcher prise, finalement.
Éric-Emmanuel Schmitt: Voilà. J’étais un jeune homme qui voulait absolument tout maîtriser: ses pensées, ses émotions, ses sentiments… Un poids de contrôle de soi qui était une prison. Et, soudain, la peur, le danger me libèrent de cet idéal de la maîtrise. Si on n’a pas de failles, la lumière ne peut pas passer.
Jean-Marie Perinetti: Pour ma part, j’ai vécu et je vis cette renaissance comme un regard porté sur soi, un regard extérieur porté sur soi. Quand un enfant naît, il ne naît pas: on le fait naître. Et la première chose qu’il rencontre c’est un regard, un regard d’accueil, de bienveillance, d’amour. Et là j’ai découvert, j’ai senti en moi ce regard qui me regardait comme si j’étais un être nouveau, comme si j’étais lavé de tout, comme s’il ne pouvait m’arriver que des choses bonnes.
Éric-Emmanuel Schmitt: Avec le recul, j’ai eu le sentiment d’être né deux fois: une première fois de chair et une deuxième fois d’esprit, dans le Sahara. Parfois on ne naît pas à son propre esprit, on ne naît pas à sa présence au monde et même à son âme parce qu’on est sur des rails, parce que la vie nous conditionne, parce qu’on reçoit une éducation, une instruction… Tout ça, ça peut être des chemins de traverse par rapport à la rencontre du grand Autre et, sous son regard, de soi-même.
Vous avez récemment sorti un très beau DVD aux éditions Montparnasse, Éric-Emmanuel Schmitt sur scène, qui reprend trois de vos pièces de théâtre: Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Madame Pylinska et le secret de Chopin et Le Visiteur, pièce extrêmement importante dans votre carrière, ici interprétée par Sam Karmann, Franck Desmedt, Katia Ghanty et Maxime de Toledo dans une mise en scène de Johanna Boyé et jouée dans votre théâtre, le Théâtre Rive-Gauche. Le contexte: Vienne, 1938, les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les juifs. Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir mais, un soir d’avril, la Gestapo emmène sa fille Hannah pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une étrange visite. Qui est cet homme ? Un fou ? Un magicien ? Une projection de son inconscient ? Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend être: Dieu lui-même ? Devos, Schmitt, Perinetti, Freud… Tout le monde, finalement, peut rencontrer Dieu ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Oui, bien sûr… à condition de ne pas trop le vouloir ! C’est-à-dire à condition de ne pas être tendu, en attente. Beaucoup de gens me confient chercher activement, mais il faut se calmer, laisser advenir, laissez les portes s’ouvrir et, à la limite, prendre des risques. Voyagez, allez au-delà de vous-même, perdez votre confort ! Il faut savoir partir pour peut-être rencontrer. Il faut savoir quitter, aussi. Quoiqu’il en soit, la recherche ne doit être ni angoissée, ni volontaire.
«Ce n’est pas une vérité que je peux partager mais dont je peux témoigner»
Jean-Marie, cette rencontre a quand même changé des choses dans votre vie, non ? Vous avez gardé le théâtre mais vous avez cependant aussi fait le choix d’aller vers la théologie. Vous mêlez d’ailleurs les deux dans un spectacle autour de Bartimée. Un homme qui va recouvrer la vue, c’est intéressant…
Jean-Marie Perinetti: J’avais été comblé par le théâtre et je pensais que c’était une histoire terminée alors qu’en fait, on est venu me chercher à cet endroit-là. Je viens donc d’écrire une pièce autour de l’aveugle Bartimée, Un cri dans la houle ou La confession de Bartimée. Je faisais un stage de gospel cet été et dans le temple autour de nous figuraient des photos de migrants prises par SOS Méditerranée. Il y avait un clash, là: comment chanter du gospel avec ces visages autour de moi ? Il fallait en faire quelque chose et j’avais cette figure de Bartimée qui me hantait, cet homme qui crie dans la foule. On a beau le rabrouer, il n’en a rien à faire, il continue à crier: «Jésus, aie compassion de moi»… et puis retrouve la vue. J’ai imaginé ce que ça donnerait si le culte protestant était animé par lui, s’il débarquait au beau milieu d’un culte, qu’il prenait les choses en main et qu’il portait un regard ironique sur le monde. Il ne s’agit pas du tout de culpabiliser le public mais de réveiller le Bartimée qui est en chacun de nous, qui a besoin, qui a envie, qui doit crier, jeter son manteau et bondir au milieu de la houle.
Éric-Emmanuel Schmitt, la conversion est pour beaucoup un chemin vers une forme de vérité, de paix intérieure. Qu’avez-vous découvert en vous, dans votre rapport au monde, après cette rencontre spirituelle ? Qu’est-ce qui a vraiment changé ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Quand j’étais athée, j’habitais l’ignorance – notre lot commun à tous. Pourquoi est-on là ? Comment doit-on agir ? Qu’est-ce que la mort ? Qu’est-ce que la vie ? Toutes ces questions métaphysiques qui reçoivent des réponses qui ne sont jamais que des hypothèses. J’habitais cette ignorance fondamentale qui est la nôtre avec angoisse. Depuis que j’ai la foi, j’habite cette ignorance avec confiance: je vis dans le Mystère. Le Mystère, ce n’est pas l’absurde, ce n’est pas l’absence du sens, c’est la promesse du sens. Je vis dans cette promesse du sens, donc aussi dans l’espérance, et je dois avouer une chose assez ignoble: c’est plus confortable ! Mais en quoi la souffrance serait-elle l’indice du vrai ? Et, ne pas prétendre savoir, c’est une façon plus humble aussi d’habiter la condition humaine. Vous avez employé le terme de vérité: c’est une vérité subjective, ce n’est pas une vérité que je peux partager mais dont je peux témoigner. Une vérité objective c’est deux et deux font quatre. Deux et deux font quatre, ça met tout le monde d’accord, ça ne demande pas notre assentiment, alors que les valeurs, la foi, demandent notre assentiment, notre consentement, demande qu’on plonge.
Il y a d’ailleurs souvent beaucoup de doutes chez les personnages de vos pièces, de vos écrits. Je pense à L’Évangile selon Pilate, par exemple, qui en est un bel exemple. Ce doute est important et demeure.
Éric-Emmanuel Schmitt: Oui, mais je crois que le doute ne se situe pas dans la même partie de l’esprit que la foi. Je suis très disciple de Blaise Pascal à ce niveau-là – c’est vraiment un de mes philosophes de référence. Pascal nous dit que l’esprit est fait de cœur et de raison. Pour la raison: oui, on ne trouve pas Dieu parce que Dieu n’est pas l’objet d’une démonstration philosophique ni mathématique, Dieu n’est pas derrière la lentille d’un microscope ou d’un télescope. Dieu n’est pas un objet de savoir. On n’y arrive pas de ce côté donc on est dans le doute et dans la suspension du jugement. Et concernant le cœur: si, comme dans les deux moments vécus racontés, on a éprouvé Dieu, si on l’a aperçu, si on l’a ressenti, si on l’a accueilli, alors on n’a aucun doute. Ma foi a des flux et des reflux mais je dirais qu’elle ne m’a jamais laissé dans le doute. C’est moi qui m’éloigne de ma foi de temps en temps, ce n’est pas ma foi qui s’éloigne de moi. Car je ne suis pas à la hauteur de la foi que j’ai eu le bonheur de recevoir. C’est ma faute !
Transcription réalisée par Pauline Dorémus.
(1) Éric-Emmanuel Schmitt, La nuit de feu, Albin Michel, 2015.
(2) Charles Pépin, La rencontre, Une philosophie, Allary Éditions, 2021.





