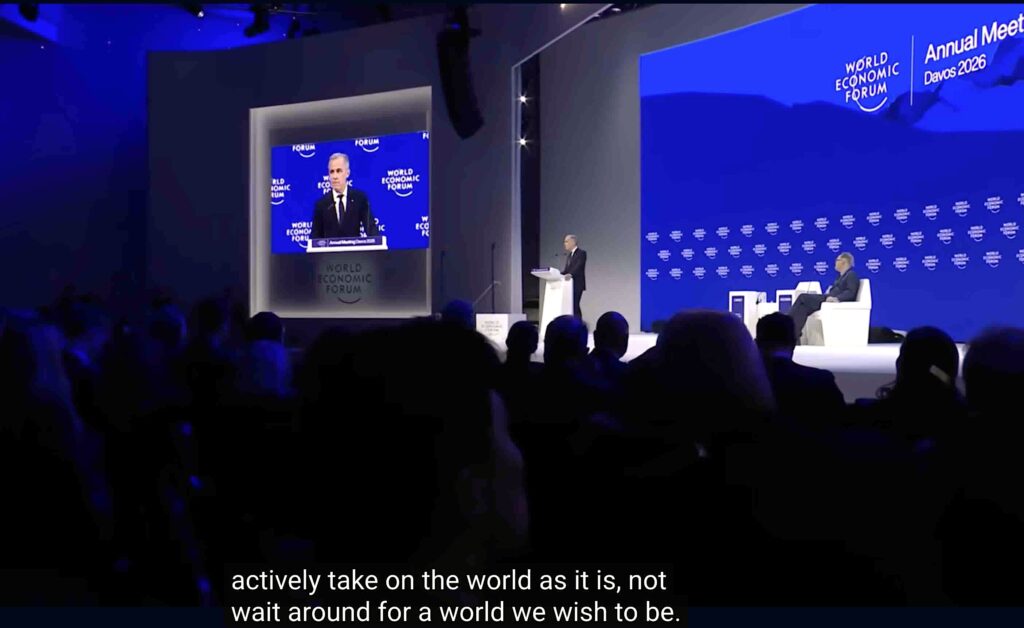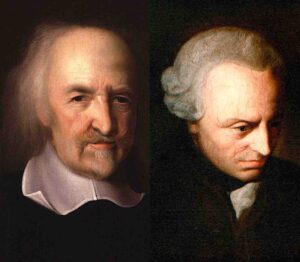L’Europe à l’épreuve de la vérité
«Capacité de cesser de faire semblant, d’appeler la réalité par son nom, de renforcer notre position chez nous et d’agir ensemble» selon le premier ministre canadien Mark Carney dans son discours remarqué à Davos, «la vérité est ambivalente». Car, pour Jean-Paul Sanfourche, elle est à la fois «ce qui peut permettre à l’Europe de se réinventer en tant que ‘grande puissance’, c’est-à-dire en tant qu’acteur capable de peser collectivement sur l’ordre mondial» et «aussi ce qui menace de la disloquer si elle n’est pas accompagnée d’un récit politique». Un récit «plus que nécessaire», «urgent», face «aux contre-narrations agressives, intérieures ou extérieures».
«Nous ne comptons plus uniquement sur la force de nos valeurs, mais également sur la valeur de notre force.»
«Mais à partir de cette fracture, nous pouvons bâtir quelque chose de meilleur, de plus fort et de plus juste» (Mark Carney) (1).
La question du devenir de l’Europe s’impose désormais comme une problématique lancinante et préoccupante. Le discours prononcé par le premier ministre du Canada à Davos fera date. Des commentateurs bien plus avertis que moi sauront en voir tous les prolongements en échappant à l’effet de séduction immédiate qui gomme parfois l’essentiel. En ce qui nous concerne, nous nous en tiendrons à sa reconnaissance de l’hégémonie américaine et au caractère historiquement asymétrique du multilatéralisme occidental. Nous considérerons que sa conclusion est moins une leçon morale que l’appel à voir enfin la réalité en face, de rompre avec des fictions rassurantes mais dangereuses:
«Les puissants ont leur pouvoir. Mais nous avons aussi quelque chose: la capacité de cesser de faire semblant, d’appeler la réalité par son nom, de renforcer notre position chez nous et d’agir ensemble.»
Un discours qui veut s’inscrire dans une temporalité de rupture et non de transition. «Permettez-moi d’être direct: nous sommes en pleine rupture, pas en pleine transition.» Un discours qui formule conceptuellement ce que Volodymyr Zelensky exprime de façon plus directe, peut-être plus brutale mais si profondément humaine: dans un monde de rivalités, la vérité cesse d’être un principe abstrait mais une condition de survie politique. La lucidité devient la seule condition de la souveraineté. Il s’opère comme un glissement du registre éthique à celui de la géopolitique, déplacement qui éclaire la situation des «puissances moyennes», prises entre la nostalgie d’un ordre multilatéral (révolu ?) et la brutalité d’une compétition systémique assumée. Déplacement qui met aussi en lumière, dans un contraste saisissant, l’acteur central et implicite qu’est l’Europe. Mais on pourrait aussi considérer à la lecture de ce discours qu’elle en est comme le point aveugle. Non parce qu’elle ne serait pas concernée par les dynamiques décrites. Parce qu’elle en est l’héritière la plus accomplie et la victime peut-être la plus exposée. Au prisme du «vivre dans la vérité», la question du devenir de l’Europe se pose avec insistance. Cela prend la forme d’une aporie: peut-elle survivre à la fin d’un monde qui l’a rendue possible ?
Un texte de «seuil»
Mark Carney ne plaide pas l’annonce graduelle, prudente d’un ajustement du système international, mais la reconnaissance explicite et tardive d’une discontinuité historique. En citant Vaclav Havel et son appel à «vivre dans la vérité», il évoque un acte de résistance: agir selon la vérité dans un système fondé sur le mensonge ou l’illusion, la propagande, la conformité forcée. Il ne s’agit nullement d’être seulement «honnête», comme certains journalistes l’ont écrit, mais de remettre en cause un ordre établi. Dans le sillage d’Havel, Carney semble s’inscrire (tardivement, bien après le discours de la Sorbonne) dans une tradition dissidente selon laquelle la vérité n’est jamais neutre mais politiquement engagée, donc conflictuelle. Ce qui relevait chez Havel d’une résistance à l’ordre totalitaire devient ici une condition de l’action politique dans un monde post-libéral. C’est l’option d’un choix courageux, potentiellement risqué, mais qui implique désormais de prendre position contre des systèmes ou des discours dominants.
Dès lors, que serait «vivre dans la vérité» pour les puissances dites «moyennes» ? Accepter la fin des fictions fondatrices: la neutralité des marchés, la convergence naturelle des intérêts économiques, la séparation illusoirement étanche entre prospérité et sécurité. Cesser de se laisser aveugler par ce qui se révèle être une terrible vulnérabilité. Penser la souveraineté non comme une autarcie mais comme la capacité à décider, à faire des choix, dans un environnement implicitement ou explicitement hostile.
Une aporie manifeste
Et c’est précisément sur ce point qu’il nous semble que l’Europe est directement concernée. Ce n’est pas explicite dans le discours – à dessein – mais elle s’impose à sa lecture attentive comme un impensé central. L’Union Européenne est l’héritière la plus aboutie de cet ordre que Carney constate désormais remis en cause pour ne pas dire défunt. «Nous savons que l’ancien ordre ne reviendra pas.» Elle est cet espace politique qui a institutionnalisé la «dépolitisation du monde», comptant sur «la force de ses valeurs»: primat du droit sur le rapport de forces, croyance dans la normativité universelle, refus obstiné de penser la conflictualité comme horizon durable. Héritage d’une longue histoire, politique, philosophique, culturelle. Mais la voici comme la victime la plus exposée à cause de ces valeurs, car son existence semble reposer sur la permanence de conditions qui ne sont plus garanties – mais l’ont-elles jamais été ? –: ouverture, prévisibilité, confiance en la retenue stratégique des grandes puissances. On mesure la signification tragique de ce qu’implique ce «vivre dans la vérité» pour l’Europe. Reconnaître la réalité du monde tel qu’il est revient à interroger les fondements mêmes de son projet et, pourrions-nous dire, de sa raison d’être.
C’est là que l’aporie devient manifeste: l’Europe peut-elle survivre à la disparition d’un ordre international d’après-guerre qui l’a rendue possible sans se renier ? Si elle persiste à se penser comme une «puissance post-historique», elle risque l’effacement stratégique dans un monde qu’elle n’a jamais voulu accepter comme tragiquement historique. Mais, si elle accepte la logique incontournable de la rivalité, elle doit renoncer à une part de son imaginaire fondateur qui est un imaginaire éthique. Mettant à profit «la valeur de sa force» ?
Le chiasme puissant de la citation mise en exergue agit comme un révélateur impitoyable. Évidemment, Carney ne trace pas une nouvelle voie européenne, mais force l’Europe à se regarder dans le miroir d’un monde où la vérité n’est plus un idéal partagé, mais devient un choix coûteux, voire existentiel.
Une fidélité reconfigurée
Relisons le discours. «(Nous) ne comptons plus uniquement sur la force de nos valeurs, mais également sur la valeur de notre force !» Avouons que nous, Européens, avons malgré nous entendu cette phrase comme une injonction, en gommant spontanément le «Nous» ou en nous y incluant. Peut-être était-ce aussi le dessein de Carney. Injonction déguisée dont la clef herméneutique réside dans le glissement du «uniquement» vers le «également». Ces modalisateurs (2) adverbiaux condensent toute l’ambiguïté politique et philosophique de la position européenne actuelle. Ce chiasme opère à plusieurs niveaux. Sémantiquement il associe deux champs traditionnellement opposés. Celui des valeurs (le registre normatif, moral, institutionnel) et celui de la force (le registre du pouvoir, de la contrainte et du stratégique). Mais, syntaxiquement, tout se joue dans la modulation du rapport exclusif (uniquement) vers le rapport que nous pourrions qualifier d’additif (également). Le mouvement de pensée n’est donc pas celui d’une inversion, d’une substitution brutale d’un registre à l’autre, mais d’une recomposition, d’un rééquilibrage (3). Le réalisme de Mark Carney est celui d’une pédagogie du réel. («Nous acceptons pleinement le monde tel qu’il est, sans attendre qu’il devienne celui que nous aimerions voir.» Mais sans y renoncer.) Cet «également» a une fonction d’ajustement en même temps qu’il préconise un changement de paradigme. À la force des valeurs morales doit désormais s’ajouter la valeur de la force. Ou, plus exactement, la valeur de la force doit répondre à la force des valeurs morales. Ou, en d’autres termes, le registre éthique se prolonge dans le registre stratégique et réciproquement.
Il est là, le cœur du message. C’est la fin irrévocable des illusions. Zelensky, à sa façon, nous exhortait amèrement à en prendre conscience. Carney introduit dans le langage politique la leçon de Weber (conviction et responsabilité): le normatif et le géopolitique ne sont pas antagonistes, ne se neutralisent pas. La responsabilité du politique, celle de l’homme d’État, mais celle aussi du penseur et bientôt de l’historien, est de les faire coexister dans une tension permanente. Cela veut dire que l’Europe ne doit pas renoncer à ses valeurs, qui fondent son identité, mais les repenser dans un environnement tragique. «Vivre dans la vérité» n’est pas renoncer aux valeurs morales ou philosophiques. C’est renoncer lucidement à la dénégation (4).
Mais ce «également» inaugure le temps d’une dissonance qu’il nous faut intégrer et assumer. Un idéal ne doit pas rendre aveugle, ni se substituer à un autre idéal. Zelensky comme Carney nous obligent à reconstituer une totalité politique encore plus complexe. À repenser nos destins – ceux de nos enfants et petits-enfants – selon cette évidence nouvelle, déchirante, mais qui s’impose: la puissance n’est plus l’antithèse de la valeur; elle est désormais son garant paradoxal. Il faut admettre désormais que l’idéal européen du droit ne peut survivre sans outils coercitifs. Que la lucidité de Raymond Aron, que nous avions ignorée, s’accomplit: il n’y a pas de paix libérale concevable sans vigilance armée. L’efficacité comme condition de la morale.
Une Europe du courage lucide
Mais quels échos durables auront ces discours dans une Europe dont l’unité est bien fragile (5) ? Dans la conscience des Européens ? La conférence de la Sorbonne n’en eut aucun, alors qu’elle invitait déjà l’Europe à une révision profonde de son rapport à elle-même. Pour mettre fin à ce «jour sans fin», pour agir et non périr, l’Europe doit non seulement prendre conscience de la fin d’un imaginaire post-historique mais entrer résolument dans un temps où la survie de ses principes ne dépend que de sa capacité à les défendre concrètement. Soyons juste: des frémissements significatifs laissent penser que l’Europe est décidée à convertir la force en vecteur de légitimité. Avec l’épisode du Groenland, nous avons assisté à un réarmement – à tous les sens du terme – de la pensée européenne. Ce fut un tournant majeur. La puissance ne fut pas perçue comme la trahison des valeurs, mais comme la condition de leur préservation. Plus que l’Europe, c’est «l’idée» (6) de l’Europe qui s’est défendue et imposée. Autrement dit: la fidélité à l’idéal européen par l’exercice responsable du pouvoir. «Il faut nous battre, avoir la force et le pouvoir, car c’est malheureusement le langage qui sera compris à l’avenir», déclare Mette Frederiksen (7).
Donner chair à la politique par la grammaire ?
C’est là, dit sobrement, le véritable programme politique de l’Europe, dans la perspective ouverte par Carney. Par ce «malheureusement», autre modalisateur (!), l’Europe est mise à l’épreuve de son propre langage. Il rejoint en écho ces «uniquement» et «également» en agissant comme la relecture des fondements de la rhétorique européenne. Cette Europe qui s’est construite sur une grammaire de l’exclusivité éthique, au nom de principes universels, dans une approche toute relative des rapports de force. Ces modalisateurs sont comme des particules de réalisme, respectant la syntaxe de la morale. La «rupture» de Carney se traduit dans ces infléchissements discursifs qui suggèrent qu’à défaut de croire que la raison se suffit à elle-même, un langage assume désormais, face à la déraison brutale du monde, que la raison doit se défendre. Ces variations linguistiques traduisent une (r)évolution politique que nos consciences d’Européens doivent entendre, dans le flux d’un nouveau récit. Seule une puissance collective permettra aux valeurs de demeurer opératoires. Non pour dominer; juste pour ne pas disparaître. Toutes ces discrètes unités lexicales transforment les discours en geste performatif. Elles reconfigurent la possibilité d’agir dans la fidélité à nos valeurs dans un monde qui les nie.
Qu’on me pardonne cet excursus linguistique. Ce sont pourtant ces petites nuances qui engagent les refondations conceptuelles. Elles obligent ici à penser la coexistence de la norme et du pouvoir, de la conviction et de la décision.
L’Europe à l’épreuve de sa vérité
Ceci dit, il faut modérer nos enthousiasmes un peu théoriques et conceptuels et revenir à la complexité politique de notre Europe.
«Notre nouvelle stratégie repose sur ce qu’Alexander Stubb a qualifié de « réalisme fondé sur des valeurs » — autrement dit, (…) c’est parce que nous ne sommes plus une grande puissance qu’il nous faut une grande politique, parce que, si nous n’avons pas une grande politique, comme nous ne sommes plus une grande puissance, nous ne serons plus rien.»
Cela ressemble à s’y méprendre à une citation du Général De Gaulle.
Oui, mais… Quid de l’Europe, de son futur, dans l’éclairage de cette formule apocryphe ? Elle ne peut être comprise comme une «puissance moyenne» telle que l’entend Mark Carney. Elle constitue plutôt un agrégat de «puissances moyennes» dont les histoires, les cultures – y compris les cultures stratégiques – les valeurs et les points de vulnérabilité sont profondément différentes. Dans l’environnement international dominé par la coercition économique et la rivalité entre grandes puissances, des incitations s’exercent sur ces États tendant à les éloigner d’une logique d’intégration collective. Chacun est tenté de défendre ses intérêts nationaux au détriment de l’Europe dont ils sont pourtant les membres, alimentant par conséquent une concurrence intra-européenne. Ce qui peut apparaître rationnel au niveau national est collectivement destructeur. Privée d’une unité stratégique (même minimale), l’Europe se condamnerait à perdre toute capacité d’influence autonome, et à n’être «plus rien». Juste un espace convoité, vassalisé par des puissances extérieures, sans capacité d’initiatives réelles, objet et non sujet de l’Histoire mondiale. La vérité du monde nous confronte à notre vérité en rendant nécessaire l’approfondissement de l’unité européenne. Unité qui, aujourd’hui, relève aussi de l’illusion sinon du mensonge. Comment les vingt-sept pays membres pourraient-ils partager en vérité le symbole fort du drapeau étoilé qu’ils ont en commun (8) ? L’accomplissement de cette unité européenne idéale impliquerait des choix politiques coûteux. Construire une capacité stratégique commune suppose des transferts de souveraineté explicite dans les domaines de la défense, de l’énergie, de l’industrie, des nouvelles technologies. Cela exige des arbitrages entre des intérêts nationaux divergents. Cela exige une redistribution des ressources, une acceptation de risques partagés. Cela exige surtout la légitimation démocratique de décisions dépassant les cadres politiques traditionnels de chaque pays. Or nos sociétés européennes sont façonnées par des décennies de paix, de prospérité relative. Sont-elles prêtes, même si la guerre est aujourd’hui à nos frontières, à tous ces sacrifices ? Continueront-elles à associer ces sacrifices à des pertes nationales d’un illusoire contrôle alors qu’ils contribueraient à un gain de sécurité collective ?
Un dilemme tragique
Et c’est dans cette tension que se cristallise l’aporie européenne. La vérité du monde contemporain impose l’unité comme condition de la survie européenne; mais cette même vérité fragilise les bases politiques, sociales et symboliques de cette unité. L’Europe est ainsi confrontée à un dilemme tragique: persister dans une forme de déni, au risque de l’impuissance stratégique, ou assumer pleinement la lucidité, au risque de provoquer des fractures internes susceptibles de remettre en cause la cohésion (l’illusoire cohésion) de l’ensemble. La vérité est ambivalente. Elle est ce qui peut permettre à l’Europe de se réinventer en tant que «grande puissance», c’est-à-dire en tant qu’acteur capable de peser collectivement sur l’ordre mondial. Mais elle est aussi ce qui menace de la disloquer si elle n’est pas accompagnée d’un récit politique, d’une solidarité matérielle et d’une volonté collective à la hauteur des exigences. En ce sens, l’avenir de l’Europe ne dépend pas seulement de sa capacité à vivre dans la vérité, mais de sa faculté à transformer cette vérité en principe d’unité plutôt qu’en facteur de dissolution.
La nécessité d’un récit européen
Le discours de Carney et son intuition gaulliste nous apparaissent comme une somme de récits en puissance, sous forme de trajectoires possibles parce qu’imaginables. Il met en perspective le récit à construire de l’Europe. Nous serons ici, une fois de plus, fidèle à la leçon ricœurienne. Les communautés se forgent aussi par un récit cohérent qui relie le passé, le présent et l’avenir en une trajectoire émancipatrice. L’identité narrative est un processus temporel et téléologique. Il configure le sens de l’action dans le temps. Pour l’Europe, le récit suggéré par Carney est celui d’une «puissance moyenne démultipliée» par l’intégration. Récit de la construction d’une identité collective supra-nationale ne concurrençant pas les identités nationales, de la transformation de la fragmentation en force à dimension multiple, économique, normative, sécuritaire. Un récit qui loin de peindre un fédéralisme abstrait tracerait les lignes d’une «grande politique» assumant une interdépendance comme levier d’une souveraineté partagée, sans repli national.
Ce récit est plus que nécessaire, il est urgent. Pour faire face aussi aux contre-narrations agressives, intérieures ou extérieures. La Russie déploie un grand récit civilisationnel de «guerre contre l’Occident décadent» (9), justifiant son agression ukrainienne comme rempart contre une hégémonie libérale perçue comme nihiliste. Discours, relayé par une propagande hybride, qui fracture l’Europe en attisant les peurs souverainistes. En interne, l’AfD allemande incarne un récit nationaliste revanchard – «re-migration» et rejet de l’intégration –, opposant une Allemagne «pure» à une «Union diluée dans le multiculturalisme et la bureaucratie bruxelloise» (10). Ces narrations, par leur puissance émotionnelle et binaire, populistes, menacent de dissoudre l’Europe en États moyens concurrents, validant le pire scénario de Carney.
Pour conclure
Reste donc ouverte la question décisive de l’unité européenne. Le discours de Mark Carney a frappé les esprits. Il laisse ouverte la question décisive: l’Europe dispose-t-elle réellement de la volonté politique, de la cohésion sociale et de l’imaginaire collectif nécessaires pour emprunter cette voie exigeante ? C’est dans cette indétermination que se joue le devenir même du projet européen. «… Nous pouvons bâtir quelque chose de meilleur, de plus fort et de plus juste.» La lucidité n’ouvre pas nécessairement un avenir meilleur. Plus juste certainement, ce qui est encore plus exigeant. Refuser cette lucidité et ne pas agir, c’est consentir à un effacement progressif, à la vassalisation silencieuse. L’accepter comporte des risques: les divisions internes, la confrontation avec des choix que nous n’avons plus l’habitude d’assumer. Cependant, c’est à cette condition, à cette condition seulement, que l’Europe pourra demeurer sujet de l’Histoire. Non en dépit de la vérité, mais par elle (11).
Illustration: le discours du premier ministre canadien le 21 janvier 2026 à Davos.
(1) «Bâtir quelque chose de meilleur»: le discours intégral de Mark Carney à Davos, Le Grand Continent, 21 janvier 2026.
(2) Moyen linguistique par lequel le sujet parlant manifeste son attitude vis-à-vis de ce qu’il énonce.
(3) Certains commentateurs, dont des journalistes canadiens, ont vu dans ce discours une «stabilisation réaliste» d’un capitalisme libéral en crise plutôt qu’une véritable refondation d’un ordre politique international. Ces critiques méritent d’être aussi prises en compte, même si, selon nous, le cœur du message n’est pas là.
(4) Mea culpa de l’Européen anonyme et sans importance que je suis ! Car je me suis trop souvent réfugié dans l’apparent confort d’un discours où il me semblait nécessaire de concilier sans heurts soucis de l’universel et intérêts matériels. Je m’inscrivais donc sur le versant du «uniquement», espérant encore en cette innocence institutionnelle. Regard protestant ?
(5) Propos d’Hubert Védrine: «En Allemagne, il y a des voix autorisées, des centristes et des verts qui commencent à dire: on n’est pas sûr qu’il y ait un système européen dans dix ans». Commentaire, Radio Classique, émission du samedi 24 janvier (37’52 »).
(6) Selon les termes de la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, lors de la conférence de presse à l’Élysée le 28 janvier 2026.
(7) Propos tenus lors de son interview au Journal de 20 heures (France2) le même jour.
(8) Il faut rappeler que le drapeau européen incarne l’unité durable des peuples d’Europe autour de valeurs communes, indépendamment des frontières et du nombre d’États membres qui la composent. Aujourd’hui, l’Union Européenne compte 27 pays membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
(9) «L’Ukraine est un pion et un outil utilisé par l’Occident pour établir une tête de pont aux frontières mêmes de la Fédération de Russie afin de menacer directement notre sécurité», a déclaré, jeudi, Sergueï Lavrov, selon l’agence TASS. «Considérons-nous ce conflit comme une confrontation majeure entre la Russie et l’Occident ? La réponse est oui», a ajouté le ministre russe des Affaires étrangères (Le Monde, 29 janvier 2026).
(10) Les propositions radicales du parti d’extrême droite allemande AfD en Saxe-Anhalt, où il est aux portes du pouvoir, Le Monde, 30 janvier 2026.
(11) Au moment de conclure cette communication, nous prenons connaissance du discours prononcé par Mario Draghi le 2 février 2026 à l’Université de Louvain. Il n’est plus temps de montrer comment ce discours prolonge, confirme, réoriente (et nuance) celui de Carney. Ils se rencontrent sur l’essentiel. Il serait fructueux d’établir un dialogue entre ces deux points de vue. Juste deux citations, que nous pourrions intégrer à ces lignes: «Nous n’avons pas à sacrifier nos valeurs pour obtenir le pouvoir»; «Ce qui a commencé dans la peur doit se poursuivre dans l’espoir». Agir ou périr ? Unir nos forces ou subir l’Histoire ?