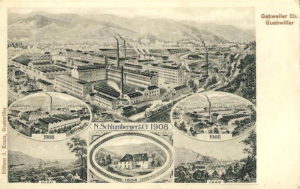Protestantisme et intégrité
Dans notre société, on observe un net décrochage de la notion d’intégrité (professionnelle, politique, mais aussi privée), comme si cette notion était surannée, voire inutile, sauf dans les slogans relatifs à la consommation. Alors, le protestantisme s’est-il laissé digérer par cette tendance ? Ne doit-il pas formuler des exigences en matière d’intégrité… et se les appliquer ?
Parmi les images traditionnelles du protestant, il y a celle de l’intégrité, d’une certaine rigueur morale. Or, deux questions se posent. Premièrement, cette légende est-elle toujours vraie ? Deuxièmement, les protestants y tiennent-ils tant que cela ? À la première question, il est délicat de répondre. À la deuxième, une certaine tonalité de l’expression protestante et des prédications faites dans les églises peut donner une amorce de réponse. Les considérations qui vont suivre ne s’appuient sur aucune étude systématique, encore moins sur une enquête sociologique. Simplement, à partir de quelques textes bibliques (il paraît que les protestants lisent la Bible…) et de quelques prises de position de protestants notoires d’un passé plus ou moins récent, nous verrons s’il faut se couler dans l’air du temps sur fond de tolérance et de neutralité bienveillante, ou bien s’il faut incarner une forme de permanence de certaines valeurs au travers des âges. Nous nous demanderons si l’exemplarité tant réclamée par nos concitoyens pour les autres a une chance de renaître, et si les protestants ne pourraient pas rendre service à la communauté nationale en réactivant concrètement leur légende. Cette contribution est une modeste participation à notre Forum de Regards protestants. Elle peut servir de base à des réflexions mieux informées et à des prises de position diverses.
Un des carburants les plus dangereux de la crise qui agite notre société, c’est la défiance qui frappe le monde politique et la sphère publique en général. Déliquescence de l’État et recul de facto de ses responsabilités dans la conduite du pays ; « affaires » en cascade (Woerth, Cahuzac, DSK, liste embryonnaire et non close) ; autoprotection des copains et des coquins, dont la non-levée de l’immunité parlementaire du sénateur Serge Dassault par le Sénat, pourtant classé à gauche, est un exemple gravissime (1) ; capitulation quasi constante du personnel politique devant la Bourse (qui prospère à chaque annonce de licenciements massifs) et devant la finance internationale ; bouleversement profond et très rapide des mœurs via les affaires d’alcôves à répétition (dont les deux derniers présidents de la République ont abondamment alimenté la chronique ; ils ne sont ni les seuls, ni les pires, nous y reviendrons) et via des modifications des lois matrimoniales et bioéthiques (PACS, Mariage pour tous, avortement, fin de vie…). Tout cela laisse à penser que la déstructuration de la société vient du haut et perfuse peu à peu dans le peuple, qui n’arrive pas à suivre, se voit sommé d’adhérer à des valeurs qu’il n’a pas vraiment intégrées, et qui, de manière schizophrénique, subit l’injonction de vivre de manière éthique et économe alors qu’au sommet corruption et gaspillage se développent dans une impunité certes partielle mais, par définition, excessive.
Perfusion, diffusion
Dans Pour le meilleur et sans le pire, Évelyne Sullerot analysait la diffusion de nouveaux modes de vie conjugale dans la population. L’exemple qu’elle prenait était celui du célibat, ancien modèle et nouveau modèle. Mais on pourrait en prendre d’autres, comme la place de l’homosexualité dont on débat partout, aussi bien à Paris qu’à San Francisco, en passant par la Russie et l’Ouganda :
En France, ceux et celles qui ont opté pour ce nouveau style de vie et ne se marient pas se recrutent parmi les groupes qui, en règle générale, jouent le rôle d’une avant-garde et se trouvent par la suite imités par des catégories voisines : il s’agit en effet d’hommes et de femmes de niveau socioprofessionnel élevé ou assez élevé, de niveau d’éducation également bon, habitant Paris surtout, ou la région parisienne, ou les très grandes villes. Il y a les plus grandes chances pour que les modes qu’ils initient se propagent ensuite, avec des délais plus ou moins importants, auprès des couches plus moyennes et des habitants de villes moins importantes. (2)
Par ces propos, Évelyne Sullerot illustre la fameuse parabole de la grenouille dans l’eau bouillante : plongez-la dans de l’eau froide progressivement chauffée, elle mourra sans s’en rendre compte au bout d’un moment ; plongez-la directement dans l’eau bouillante, elle s’en échappera tout de suite, si elle peut. Or, pour les chrétiens, pour les gens de foi en général, et pour les personnes attachées à des valeurs de longue durée, ces mutations posent une question de fond : sont-elles dues à la perversité d’une élite branchée qui les infuse dans la population jusqu’à ce que celle-ci les avale, les digère, et les fasse siennes ? Ou bien s’agit-il d’évolutions nécessaires et bienfaisantes qui n’ont que trop tardé ? On peut prendre l’exemple de l’esclavage, pratique que le christianisme n’a pas attaquée de front (mais de biais, notamment dans un texte comme l’épître de Paul à Philémon) et contre laquelle dix-neuf siècles auront été nécessaires pour qu’elle commence à être interdite, grâce à l’action de chrétiens militants !
Pense-t-on pour nous ?
Il y a donc, d’abord, un travail d’herméneutique à reprendre sans cesse, sous peine de finir comme la grenouille thermiquement mithridatisée. Qu’avons-nous accepté d’inacceptable sans nous en rendre compte ? Et, au contraire : dans quoi nos traditions nous ont-elles enfermés dont nous devrions nous extraire ? Ou encore : à l’intérieur d’un même élément qui nous est présenté, quels ajustements, ou quelles rectifications devons-nous proposer entre ce qui nous semble bienfaisant et ce qui nous semble polluant ? À cet égard, un fameux verset de Paul mérite d’être médité dans chacun de ses termes :
« Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréé et parfait. »
Notre intelligence n’est-elle pas trop aisément consentante à l’air du temps, sous prétexte de bons sentiments ? Comme le faisait remarquer Jean-Claude Guillebaud, il est si facile de ricaner des erreurs (et des horreurs…) de ceux qui nous ont précédés, alors qu’on reste à peu près aveugle sur les inconséquences de notre propre époque… de laquelle riront nos enfants. Variation sur le thème de la paille et de la poutre. Dans « La force de conviction », dont l’objet est une « réflexion sur la croyance », Guillebaud montre que « des croyances qui paraissaient solidement établies et durables ont perdu leur crédit avec une promptitude singulière ». Contre « des emportement hâtifs et potentiellement agressifs », il plaide pour « la mémoire longue », ce qui est bien en phase avec l’exhortation paulinienne que nous venons de citer (3).
Il y a déjà quelques décennies, Jean Baubérot se demandait si les protestants étaient solubles dans la société qu’ils ont contribué à façonner (bien au-delà, d’ailleurs, de leur importance numérique). Or, que ce soit en matière de mœurs privées, en matière d’économie etc., les protestants se sont-ils mis dans le sens du vent par empathie chrétienne, ou bien ont-ils été plus clairvoyants que les autres sur les évolutions à mener dans les mentalités ? Les derniers mots de la belle préface que Baubérot consacre à un recueil de textes de Roger Williams, fondateur de Rhode Island et pionnier de la liberté de conscience, nous placent devant une interrogation qui mérite d’être ruminée : « Son amour de la liberté questionnait son siècle, son amour de la vérité questionne le nôtre. » (4)
Bref rappel théologique sur le prix de la grâce
Dans tout ce qui va suivre, on s’apercevra que les auteurs et les passages des Écritures cités abordent des thèmes qui nécessairement s’entrecroisent. D’où la difficulté de séparer des éléments peu séparables. Pédagogiquement, nous allons cependant nous y efforcer.
Une des bases du christianisme, que le protestantisme a eu raison de réaffirmer, c’est que nous sommes sauvés par grâce. À cet égard, il semble que les théologies qui évacuent la question du sacrifice substitutif du Christ arrachent beaucoup trop de pages de la Bible. « Quelqu’un a payé le prix de votre rachat », écrit Paul. Commentant ce verset, c’est bien ce que Dietrich Bonhoeffer a tenu à marteler dans des lignes qui ne sont pas à prendre sous l’angle d’un simple symbole :
La grâce à bon marché est l’ennemie mortelle de notre Église. […] La grâce à bon marché, c’est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n’a qu’à rester comme avant. [mais…] La grâce qui coûte […] coûte cher d’abord parce qu’elle a coûté cher à Dieu, parce qu’elle a coûté à Dieu la vie de son Fils –‘Vous avez été acquis à un prix élevé’– parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous (5).
Nous prendrons donc ici le parti d’un protestantisme confessant, non coupé de ses racines scripturaires, pour tenter de proposer des pistes concrètes en matière d’intégrité. Celle-ci découle d’une foi vivante, active et reconnaissante.
Calvin et l’obéissance du cœur
Dans l’Institution chrétienne, Calvin va bien au-delà d’un énoncé de règles auxquelles il conviendrait de se conformer par soumission servile à Dieu : « La vie de l’homme doit être réglée par la Loi, non seulement à une honnêteté extérieure, mais aussi à la justice intérieure et spirituelle. » Selon lui, il est utile à la société que le « législateur mortel » mette des freins à nos mauvais penchants même si son rôle « ne s’étend que jusqu’à l’honnêteté externe ». Penser au meurtre sans le commettre, c’est quand même moins mal, ou moins nuisible, que de passer à l’acte. Mais du chrétien, il est exigé davantage ; bien dans la ligne du Sermon sur la montagne, Calvin explique dans son savoureux langage que la Loi doit procéder du cœur, être profondément ancrée dans l’être :
Or la plupart des hommes, même quand ils veulent dissimuler d’être contempteurs de la Loi, conforment en quelque sorte leurs yeux, leurs pieds et leurs mains, et les autres parties de leur corps, à observer ce qu’elle commande : cependant leur cœur demeure tout aliéné de l’obéissance de cette Loi. Ainsi, ils se pensent bien acquitter, s’ils ont caché devant les hommes ce qui apparaît devant Dieu. Ils entendent : Tu ne tueras point ; tu ne paillarderas point ; tu ne déroberas point. Par suite, ils ne dégainent point leur épée pour tuer, ils ne se mêlent point avec les paillardes, ils ne jettent point la main sur les biens d’autrui. Tout cela est bon. Mais leur cœur est plein de meurtre, et brûle de concupiscence charnelle ; ils ne peuvent regarder le bien de leur prochain que de travers, le dévorant par convoitise. En cela, ce qui était le principal de la Loi leur défaut.
On devine qu’une soumission à l’autorité humaine qui ne procède pas d’une conviction intime ne tiendra pas longtemps : elle se videra d’abord de l’intérieur, et finira par louvoyer, par chercher des accommodements, ou par céder aux mentalités ambiantes. Mais Calvin veut sortir du « ne fais pas à autrui… » pour en venir au : « Fais à autrui… » ; non pas une morale de l’autocensure, mais une morale de l’action positive :
Mais nous demandons quelque chose davantage, que les hommes n’entendent communément en confessant cela. Car par la vertu contraire au vice, ils entendent seulement s’abstenir de vice ; mais nous passons outre, à savoir en exposant que c’est faire le contraire du mal. Car en ce précepte : Tu ne tueras point […] je dis qu’il faut y entendre plus, à savoir que nous aidions à conserver la vie de notre prochain, par tous les moyens qu’il nous sera possible.
L’exemplarité protestante – qui est notre sujet – consistera donc, bien davantage qu’à faire de la résistance aux corruptions de la modernité, à lui faire des propositions positives, constructives, à mettre notre grain de sel dans la soupe ambiante. Encore faut-il, répétons-le, être animé d’une profonde conviction intérieure pour avoir l’énergie de faire davantage que de conserver ce qui a tenu le coup. Double rôle du sel : conserver et donner de la saveur.
De DSK à Gilles Bernheim : la conscience morte
L’affaire DSK est emblématique de ce qui nous menace si, sous prétexte de droit à la vie privée, nous nous abstenons d’émettre une opinion sur des pratiques qui, indéniablement, ne sont pas dans un compartiment étanche sans effet sur l’action publique des personnages mis en cause. Dominique Strauss-Kahn, président du Fonds monétaire international, était pressenti pour devenir président de la République. Certains savaient qu’il avait de gros problèmes de fidélité, qu’il fréquentait les boîtes échangistes. À New-York, il y a eu ce qui semble bien (précaution oratoire, puisque c’est moyennant quelques finances qu’un non-lieu a été négocié) être une tentative de viol sur une femme de chambre. À Lille, M. Strauss-Kahn a bénéficié des services de prostituées de luxe dans des conditions où son taux de complicité reste mystérieux. Puis a éclaté l’affaire Cahuzac. Ce monsieur, ministre du Budget, c’est-à-dire responsable suprême des économies de la France et de la lutte contre la fraude fiscale, a fini par avouer qu’il avait fraudé le fisc. Dans un premier temps, il est passé aux aveux partiels. Ce ministre, qui s’est dit, avec un anglicisme, « dévasté », n’était pas si dévasté que cela puisqu’il envisageait de reprendre, comme il en avait légalement le droit, son poste de député !
Ensuite, quelqu’un a eu la bonne idée d’éplucher quelques livres publiés par le Grand Rabbin de France, Gilles Bernheim ; et il a prouvé que celui-ci non seulement avait utilisé un nègre, mais qu’il avait volé des pages entières de livres déjà publiés, sans mention de la source, c’est-à-dire en s’attribuant la paternité de ces passages (6). Bernheim a gardé le silence, jusqu’à ce que quelqu’un s’avise d’aller vérifier s’il était vraiment agrégé de philosophie, comme il le prétendait partout depuis une trentaine d’années. Là aussi, mensonge. Deux ou trois jours plus tard, le spécialiste des Saintes Écritures trouvait des explications misérables, mais pas un mot de contrition. Et il n’envisageait pas de démissionner de sa fonction, car ce serait de l’orgueil, disait-il ! Il a fallu que le Consistoire juif le pousse dehors.
Quel est l’enseignement spirituel de ces quelques situations ? Dans tous ces cas, il a fallu attendre d’être pris la main dans le sac, ou la main au panier. Et même avec cela, les aveux ont plus que tardé. Pire encore : les personnages mentionnés ne semblent même pas avoir sincèrement honte de leur attitude. Ils s’accrochent à leurs privilèges, continuent de paraître en public, ne s’excusent de rien ou avec une absence évidente de sincérité. Tout cela est extrêmement inquiétant et, semble-t-il, relativement nouveau. Il y a un engrenage qui mène au suicide de la conscience. Trois questions se posent alors : ces gens vivent-ils dans le même monde que nous ? Allons-nous devenir comme eux ? Ou bien : serions-nous déjà comme eux ? Les médias protestants (nous nous en tiendrons au service public) peuvent nous donner des inquiétudes à cet égard.
Do not disturb
L’essentiel des émissions juives du service public – radio et télévision – portent sur la Bible sans pour autant être ennuyeuses, même lorsqu’il s’agit d’un commentaire direct. On peut s’étonner que les émissions protestantes n’aient pas la même simplicité. Malgré quelques efforts relatifs à la Bible elle-même, notamment à la télévision, on fait souvent dans le social, ou bien dans la poésie sirupeuse. Si le premier aspect a son utilité et sa valeur de témoignage, bien souvent il pourrait ne pas être protestant, comme s’il avait peur d’annoncer la couleur, comme s’il craignait d’offenser. Quant au second, il serait intéressant de faire une étude sémantique du discours dominant : psychologisant, assez abstrait, plein de circonlocutions, il nous paraît souvent échouer à nous mettre en prise avec les textes, qu’il contourne davantage qu’il ne s’y confronte. Jésus est bon ; il vous comprend, il vous aime comme vous êtes, il vous accompagne dans votre vie pour vous faire du bien. On est à la limite du « surtout, ne changez rien ». Il reflète un type répandu de prédication entendu dans l’EPUF, comme si le/la pasteur(e) souhaitait que ses paroissiens ressortent du temple dans l’état où ils y sont entrés. Prière de ne pas déranger.
Cela tient plus de la berceuse dominicale (dont, en général, on ne retient rien) que de l’exhortation. Celle-ci n’a pourtant pas besoin de se faire à coups de massue ou de propos menaçants pour nous inciter à aller plus loin. Certes, le constat est un peu caricatural, trop unilatéral. Mais, tout de même, n’est-il pas largement exact ? Et, quitte à risquer une volée de bois vert, y a-t-il un intérêt à occuper du temps d’antenne avec des méditations gentillettes qui ne prêchent (qui ne causent) qu’à des convertis ou supposés tels ? De ce point de vue, il serait intéressant que les responsables du service radio-télévision de la FPF produisent dans Le forum les courriers qu’ils reçoivent, et surtout leur teneur et l’impact éventuel qu’ils reflètent. Ayant longtemps travaillé dans la radio et la presse (de tendance évangélique…), l’auteur de ces lignes sait un peu de quoi il parle. Et il souhaiterait que ses insinuations soient démenties par les réactions des auditeurs/spectateurs du service public.
Du silence à la licence
La parabole des deux maisons est une des plus connues des Évangiles (7). Elle est d’une simplicité enfantine. Pourtant, on a vite fait de commettre des contresens à son sujet. Comme de dire, par exemple, qu’elle met en scène ceux qui croient en Dieu contre ceux qui n’y croient pas. Profonde erreur : les deux maisons sont deux maisons de croyants. Et cette parabole s’adresse à des gens qui croient en Dieu et même, plus précisément, en Jésus-Christ. Concernant les flots et les vents qui s’abattent sur les deux maisons, il ne faut pas exclure l’interprétation du jugement divin comme étant la ruine finale qui peut frapper ceux qui ne vivent pas sa parole. Nous penchons cependant pour l’interprétation de Jean Chrysostome : le Christ veut nous dire que vivre sa Parole dans la vie quotidienne permet de résister à tout. Si la Parole de Dieu est bien ce qu’elle dit être, c’est-à-dire une parole de vie, elle fait vivre, elle fait bien vivre, elle est source de sagesse, de bon sens, de droiture. Et ce qui nous ramène à notre sujet – il suffit de regarder autour de soi où mènent les égarements divers de nos contemporains : ils n’ont pas des vies enviables (les magazines people ne visent-ils pas davantage à nous faire frissonner d’effroi devant les turpitudes, les scandales et les vies chaotiques des vedettes bien plus qu’à nous faire envier leur existence ?). Écouter la parole du Christ, c’est donc s’assurer une vie pas forcément facile, mais une vie qui tient debout, et qui tiendra debout dans l’adversité et les pressions de l’extérieur. Avec Jésus, la maison que je construis, c’est du parasismique !
Le passage situé en Jean 7, 53 – 8, 11 (d’origine mystérieuse, il est parfois attribué à Luc) sert de prétexte à un glissement interprétatif auquel on consent trop fréquemment : ne jetez pas à la pierre à la femme adultère (« je suis derrière », ajoutait Brassens). Cet épisode bouleversant où Jésus détourne une sentence fatale en renvoyant chacun à son propre péché est souvent utilisé dans un sens lénifiant, consensuel, indulgent (presque au sens papiste). Cette femme a commis quelques écarts sexuels ? Et alors ? La preuve que ce n’est pas si grave, c’est que le Christ lui évite la peine capitale, qu’il la comprend, qu’il laisse entendre que son comportement n’est pas plus fautif que celui des pharisiens qui veulent sa peau (et dont certains, peut-être, l’ont caressée). De nos jours, c’est ainsi que la sexualité est devenue un sujet où l’on s’abstient de toute appréciation, où chacun et chacune est libre de ses actes, de ses choix, de ses pratiques les plus étranges (voire violentes) ou de ses dérapages (si on ose encore ce mot), dans un monde où la parole donnée est si facilement reprise. Or, on cite fort rarement la fin du passage considéré : « Alors Jésus se redressa et lui dit : « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t’a donc condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Jésus dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, et désormais ne pèche plus ». »
Cette admirable réponse du Christ résume en peu de mots toute son œuvre : d’une part, il a toute l’autorité divine pour faire miséricorde au pécheur ; d’autre part, cette miséricorde n’est nullement un prétexte pour se laisser aller à recommencer. Or, trop souvent, on passe sous silence la proposition finale, ce qui a pour conséquence qu’on n’exhorte pas autrui à progresser sur la base de la miséricorde divine… et qu’on ne s’exhorte pas soi-même à ne pas répéter demain les errements de la veille. Alors, retentit à nos oreilles cette fausse question de l’apôtre Paul qui contient sa propre réponse : « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, pour que la grâce foisonne ? » L’épisode ultra miséricordieux de la femme adultère n’annule pas la Loi : il la confirme ! C’est ce qu’allait nous signifier un prophète du monde moderne.
Le sida vu par Ellul
En 1987, parut un article de Jacques Ellul, Le sida et la morale, qui eut un retentissement considérable. À contre-courant de ce qui se disait à l’époque, et encore plus à contre-courant de ce qui se dit maintenant, Ellul proclamait, tel un prophète vétérotestamentaire, que le jugement de Dieu s’exerçait au travers de cette maladie nouvelle et ciblée :
Nous assistons depuis vingt ans à une érotisation démente de notre culture occidentale. […] L’homosexualité, c’est très bien. L’inceste aussi. Récemment, films et romans ont fait l’apologie de l’inceste. […] « L’amour en rond » devient une expérience respectable, et l’échange de couples aussi. On ne voit pas pourquoi on poursuivrait les pédophiles, « si ça fait plaisir aux enfants », comme il fut dit dans un procès célèbre. Plus possible de voir un film ou un téléfilm sans devoir absorber une scène érotique. Même si elle n’apporte rien au film. […] Dans ce climat, la vie de l’homme occidental est obsédée pas le sexe. Les relations multiples font qu’il n’y a plus aucun interdit, aucune réserve, aucune règle. […] Punition ? Péché ? Nous voilà donc dans le « religieux » ? Et pourquoi pas ? Je crois que Dieu, qui ne conduit pas chaque homme mécaniquement, qui n’est pas le fabricant permanent de toute l’histoire, intervient parfois aussi pour châtier.
Quelques mois après ces propos retentissants, l’auteur de ces lignes avait eu le privilège d’enregistrer quelques entretiens avec Jacques Ellul, notamment autour de ce texte. En conclusion de l’interview, Ellul reprenait dans un même mouvement les préoccupations de Calvin et celles de Bonhoeffer :
Moi, certains des textes de théologiens bien en cour me font penser au bon Dieu des dessins d’Effel. Que voulez-vous, c’est une caricature de Dieu et c’est complètement ridicule. La révélation chrétienne est bien autre chose. Elle est une révélation qui, à la fois, nous parle précisément de cet amour de Dieu, mais d’un amour qui, dans le même temps, est infiniment sérieux, et même tellement sérieux que Dieu n’a pas hésité à mourir lui-même dans la personne de son Fils… Alors tout de même, on ne peut pas prétendre à ce moment-là que Dieu nous aime d’un amour vague, et qui n’implique aucune exigence ! (8)
Ce qui fait la force d’Ellul le briseur d’idoles, c’est son obsession, constante dans son œuvre, de ne jamais professer une foi qui ne ferait pas la preuve de sa cohérence par les œuvres qu’elle produit. Il faut citer un passage d’une force peu commune dès les premières pages de La subversion du christianisme :
Il est impossible de dire : « Certes, notre pratique est mauvaise, mais voyez donc la beauté, la pureté, la vérité de la Révélation. » Nous avons insisté sur l’unité des deux. […] Il n’y a pas de Révélation connaissable hors de la vie et du témoignage de ceux qui la portent. C’est la vie des chrétiens qui atteste de qui est Dieu, et quel est le sens de cette révélation. « Voyez comme il s’aiment », et c’est à partir de là que commence l’approche du Révélé. […] Si le chrétien n’est pas conforme dans sa vie à sa vérité, il n’y a plus de vérité. […] Par conséquent nous sommes acculés à être chrétiens ou à reconnaître la fausseté de ce que nous croyons. Telle est l’épreuve irrécusable de la pratique. (9)
Comme souvent, emporté par son élan, Ellul est trop radical sur un point que nous contestons : la Révélation biblique peut, s’il le faut, se passer de notre témoignage : on cite le cas assez fréquent de musulmans se convertissant en lisant les Évangiles hors de toute fréquentation chrétienne, quand ce n’est pas par une révélation directe du Saint-Esprit qui les conduit à Jésus-Christ. Néanmoins, l’exhortation ellulienne fait mouche. Pour l’essentiel, elle reste vraie et, pour le chrétien, elle nous semble incontournable : faute d’exemplarité, on tombe dans la duplicité. Contre les pharisiens, Jésus prononçait ces propos terribles : « Faites et observez donc tout ce qu’ils vous diront, mais n’agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Et aux chrétiens, il lance l’appel à une attitude diamétralement opposée à celle des pharisiens : « Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu’ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
Le croire et le faire : sur la corde raide
Nous avons peu parlé de la fraction évangélique du protestantisme, qui n’est négligeable ni sur le plan numérique, ni sur le plan de son message. Il n’est pas faux de dire que certaines de ses composantes (les évangéliques étant extrêmement variés dans leur style et dans leur pensée) ont une relative tendance au légalisme. Il est assez significatif que les études bibliques les plus prisées des évangéliques ne soient pas… les Évangiles, mais l’Ancien Testament et les épîtres. Loi d’un côté, discipline ecclésiastique de l’autre : tout ce qu’il y a de plus cadrant dans la Bible. Mais au milieu, il y a ces quatre Évangiles très déstabilisantes qui, dès que vous vous sentez prêt à bâtir dessus une théologie cohérente, vous glissent un petit « oui mais » qui vient vous empêcher de conclure. Pour s’en tenir à un seul exemple, la parabole du bon Samaritain est une formidable peau de banane théologique. Partant d’une question sur le salut, Jésus répond en parlant des œuvres et, pire encore, de celles d’un bâtard hérétique qu’il faut imiter. On ne sait pas si la réponse à la question initiale est vraiment donnée (et quid du salut du Samaritain ?). Même chez quelqu’un de radical comme Jean, on a parfois des surprises. Bref, comme le martelait Ellul, avec Dieu, on n’est jamais installé.
Ce constat n’est cependant pas une prime au n’importe quoi. Et les évangéliques ont la qualité très louable d’avoir l’obsession de mettre leurs actes en cohérence avec leur profession de foi. Certes, le dérapage vers un néo-salut-par-les-œuvres guette toujours. C’est ainsi ; et, à moins de recourir à la méthode d’Oscar Wilde en cédant à la tentation pour s’en débarrasser, il nous faudra toujours vivre dans cette tension permanente entre l’assurance de la grâce et le souci de l’honorer par notre comportement.
La morale n’est pas l’exclusivité des chrétiens. Albert Camus, dont on a récemment commémoré le centenaire, n’a cessé de chercher à définir une morale dans un monde absurde et largement dépourvu de référence transcendante. Camus conteste les « pensées qui répandent le nihilisme : elles proclament que la différence entre le bien et le mal et les hiérarchies de valeurs sont arbitraires, qu’elles tiennent à la volonté subjective de celui qui les formule. » C’est ce que Camus récuse et, par exemple, en matière de journalisme, il a défini quelques critères simples qui font toujours autorité aujourd’hui… quitte à ce qu’ils ne soient pas respectés : « Ses leçons de déontologie agacent les vieux routiers de la profession, mais plaisent aux confrères de sa génération. » (10). Si un personnage agnostique du calibre de Camus n’a pas craint de traduire ses convictions en principes solides, n’y aurait-il pas quelque indécence à voir les disciples de Jésus-Christ faire preuve de timidité face à une société qui leur conteste jusqu’au droit de s’exprimer dans le débat public ? Camus pressentait-il ce danger ? Voici l’exhortation qu’il lançait à des dominicains à la fin des années 1940 :
Si je me permettais, à la fin de cet exposé, de revendiquer de vous quelques devoirs, il ne pourrait s’agir que des devoirs qu’il est nécessaire d’exiger de tout homme aujourd’hui, qu’il soit chrétien ou qu’il ne le soit pas. […] Je sais, avec quelques autres, ce qu’il faut faire, sinon pour diminuer le mal, du moins pour ne pas y ajouter. […] Et si vous ne nous y aidez pas, qui donc dans le monde pourra nous y aider ? (11)
Nous voici à fronts renversés. Non seulement un homme qui ne croit ni à Dieu ni à diable se définit de fortes exigences pour lui-même, mais il considère que les chrétiens doivent être en tête de ligne pour combattre la décrépitude du monde ! Quel formidable hommage rendu aux dépositaires de l’Évangile, et quel appel inspiré ! Comment éviter le moralisme ? Poser des limites, oser définir des tabous, exiger des engagements résolus, c’est s’exposer illico à l’accusation de moralisme, sans qu’on sache bien faire la différence avec la morale, que l’on remplace par le terme d’éthique qui fait plus classe.
Le moralisme, c’est le pharisaïsme : fais ci, fais pas ça. Jésus n’abolit pas la notion d’obéissance, mais il nous dit de la surpasser : « Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Mais comment exercer pratiquement ce dépassement ? Dans le prolongement de Calvin (qu’il accuse pourtant de « rigidité morale »), c’est encore Jacques Ellul qui nous donne l’exégèse de la pensée du Christ : il faut que le faire descende dans l’être :
La conduite qui est appelée est un dépassement de la morale, de toute morale, qui apparaît comme un obstacle à la rencontre avec Dieu. L’amour n’obéit à aucune morale et ne donne naissance à aucune morale. […] Évidemment, ce qui est ainsi provoqué, c’est une façon d’être, un certain modèle de vie, extrêmement aléatoire, constamment risqué, constamment renouvelé. Antimorale également parce que la vie chrétienne est antirépétitive. Il n’y a jamais un devoir fixé qui pourrait se reproduire tel quel au cours de la vie.
La tension est ici palpable : Ellul parle d’un modèle de vie (ce qui suppose la notion de normativité sur laquelle il revient en détail dans son livre), mais celle-ci n’est jamais fossilisée. En fait, il faut toujours flirter avec l’institution (chrétienne…) sans jamais s’y installer.
Mourir pour l’intégrité
La lutte pour la justice, pour l’intégrité, pour la fidélité à certaines valeurs minimales, sait-on que, aujourd’hui encore, cela peut mener jusqu’au martyre ? Ayant dénoncé, à l’Université protestante d’Afrique centrale où il était professeur, une gestion suspecte, des achats de diplômes, des pratiques corrompues, du plagiat et de l’omerta, en 2012, Éric de Putter est assassiné au Cameroun, à l’âge de 31 ans. Il convient de rendre hommage à sa mémoire pour le sujet qui nous occupe : son exemple doit nous inspirer. En effet, la triche n’est pas l’apanage de l’Afrique : elle sévit également chez nous, y compris en milieu universitaire. Souvent, on ferme les yeux : à chacun sa conscience ; cela ne me regarde pas ; de quoi je me mêle ?
Et puis, il y a des risques à s’immiscer dans les scandales. La conviction doit être doublée de bravoure et, en écrivant cela, on ne se sent pas très à l’aise. On fait soi-même partie des ramollis, on n’a pas le courage physique forgé au feu de l’adversité, voire de la persécution. Modestie indispensable, donc. Mais est-ce une raison pour renoncer à ce qui nous reste encore et que nous pouvons exercer avec un risque presque égal à zéro, tant qu’il en est encore temps : le droit d’exprimer nos convictions, le droit de dire que la débrouille, la magouille, les combines, la triche, la corruption, le népotisme, ça suffit. Ne faut-il pas retrouver la fierté d’afficher des valeurs, des valeurs tout court, dans un monde où il semble passéiste d’en avoir ? Reconnaissons que, même si on ne partage pas leurs convictions, les gens qui se sont déplacés dans la Manif pour tous ont eu un courage indéniable : celui de montrer leur désaccord avec ce qui était présenté comme un progrès allant dans le sens (inéluctable) de l’Histoire.
Nous avons tous fait l’expérience suivante : dans un groupe où la conversation surfe au hasard sur des valeurs dominantes (ayant trait à la réussite, au sexe, à la drogue, etc.), celui qui n’est pas dans l’air du temps s’écrase, au propre et au figuré. Il a honte par rapport aux autres, même si intérieurement il est fier de ce qu’il croit. Ce qu’il ignore, c’est que dans le groupe, il y a probablement d’autres personnes qui pensent comme lui, qui se taisent aussi, sans oser espérer que quelqu’un va avoir le courage de porter la contradiction. Cela ne s’observe pas seulement dans des rencontres d’étudiants autour de quelques jus de fruits et de quelques bouteilles de whisky ; cela s’observe jusque dans un Conseil presbytéral. On a beau être chrétien, on a beau se sentir épaulé par Jésus-Christ, jusque dans un petit groupe où tout le monde affiche les mêmes convictions essentielles (ne parlons pas de prendre la parole dans une conférence devant des centaines d’individus !), eh bien on a peur de s’exprimer parce qu’on pressent qu’on sera mal reçu. Pourtant, quand on se risque, on a parfois de bonnes surprises ; et il arrive qu’on déjoue un projet aberrant simplement en faisant remarquer la chose ; on renverse la vapeur. Et on peut servir de locomotive à la minorité silencieuse.
Minorité, le protestantisme l’est, en France. Silencieuse ? Certes non. Courageuse ? Dans certains domaines, oui (par exemple, sur le droit d’asile). Dans d’autres, c’est moins net. On voit bien que, dans notre société (par souci de simplification, nous n’évoquons pas « le reste du monde », comme disent les Américains), les tensions montent, la pression aussi. La crise économique et la crise des valeurs suscitent une forte dose d’inacceptable. Or, le consensus n’est pas toujours possible ; la négociation a ses limites. Si notre foi chrétienne, si nos convictions protestantes doivent nous conduire à des refus catégoriques, cela n’est pas à exclure. L’intégrité, c’est le fait de rester entier, de ne pas se laisser disperser au gré des engouements et des élans compassionnels irréfléchis, « façon puzzle ».
(1) Certes, cette levée a été acquise, moyennant un second vote, mais M. Dassault avait lui-même dit souhaiter cette levée de son immunité quelques jours avant que celle-ci ne devienne inévitable.
(2) Pour le meilleur et sans le pire, p.32, Fayard, 1984. Au passage, il est piquant de voir qu’en 1984, c’était le refus du mariage qui était subversif, et seulement, bien sûr, chez les hétérosexuels. Trente ans plus tard, c’est la revendication du mariage, chez les homosexuels, qui provoque de fortes résistances dans une partie non-négligeable de la population. Cette inversion brutale des polarités en dit long sur la mutation des idéologies dominantes ou en passe de l’être.
(3) La force de conviction, p.209, 340, 385, Seuil, 2005.
(4) Roger Williams, Genèse religieuse de l’État laïque ; préface de Jean Baubérot, p.7. Labor & Fides, 2013.
(5) Vivre en disciple : le prix de la grâce, Labor & Fides, rééd. 2009.
(6) Ses écrits contre le Mariage pour tous avaient été salués par Benoît XVI. On s’en étonnera d’autant moins que certains passages avaient été empruntés au père Joseph-Marie Verlinde !
(7) Mt 7, 24-27 et Luc 6, 46-49.
(8) Le Sida, fléau des temps modernes ? Entretien avec Jacques Ellul conduit par Philippe Malidor. Radio Réveil-Paroles de Vie, CH-2022, Bevaix.
(9) La subversion du christianisme, p.13, Seuil, 1984.
(10) Le Monde, hors-série Albert Camus, Journalisme, p. 115 (sept-nov 2013).
(11) Actuelles I, L’incroyant et les chrétiens, Œuvres complètes, Essais, p.371 et 374. Éd. de la Pléiade, 1965.