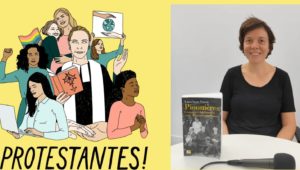Réconcilier foi chrétienne et identité LGBTQI (2)
Dans ce deuxième volet de l’entretien de Jérémie Claeys avec Juliette Marchet et Clémence Sauty, celles-ci racontent leur arrivée à l’Antenne inclusive de Strasbourg et le rôle de plus en plus important qu’elles ont été amenées à y jouer. Toutes deux font également le point sur la question queer, l’homosexualité et plus particulièrement la transidentité au sein de l’Église, offrant des conseils précieux, nourris de leur expérience, pour protéger les minorités, accompagner les familles et lutter contre toutes les formes d’intolérances.
Écouter ce podcast de la série Protestantes !
Lire le premier volet de cette retranscription.
Jérémie Claeys. Vous êtes les co-présidentes de l’Antenne inclusive de Strasbourg depuis quelques années. Il me semble qu’il n’y a qu’un seul équivalent, c’est l’antenne de Genève en Suisse. Il y en a d’autres ?
Juliette Marchet: Pendant longtemps il n’y a effectivement eu que l’Antenne inclusive à Strasbourg et l’Antenne LGBTI à Genève mais, de plus en plus, des paroissiens et des paroissiennes LGBT montent des groupes de prière ou des groupes de discussion au sein de paroisses. On commence à être plus nombreux.
«Je me suis retrouvée à Hétéroland»
Trop bien ! Comment avez-vous découvert l’antenne et qu’est-ce que cela vous a apporté ?
Juliette Marchet: J’ai découvert l’Antenne en arrivant à Strasbourg pour mes études de théologie et pour moi, c’était le lieu qui me faisait du bien à côté de la fac. Il faut s’imaginer que moi qui avais fait en Allemagne une année de sciences du genre dans une classe où il n’y avait que des lesbiennes et des personnes trans, me suis retrouvée à la fac de théologie de Strasbourg à Hétéroland. Je venais de faire mon coming-out et c’était vraiment un autre monde, j’étais en cours avec des gens qui n’avaient jamais entendu parler de trucs queers… J’étais en minorité, quoi. Il y avait parfois des gens sympas (je n’étais d’ailleurs pas la seule personne LGBT à la fac) mais souvent je me sentais un peu seule, sachant que le débat autour des mariages de couples de même sexe et de genre était encore très présent. La bénédiction dans notre Église a été votée après mon arrivée en théologie et les gens, des profs, même, ne se gênaient pas pour parler de nous sans nous considérer vraiment comme des êtres humains. C’était assez violent.
Et donc à côté de ça existait cette antenne où il y avait Joan Charras-Sancho, docteure en théologie. À l’époque je rêvais de devenir docteure en théologie, c’était mon objectif, et je la vois faire de la théologie inclusive, je vois l’Antenne, et je me dis que c’est possible, que je peux faire comme elle, que j’ai vraiment ma place quelque part. L’Antenne et Joan ont donc joué un grand rôle au début de mes études. J’avais l’impression d’avoir le droit d’être là puisque j’avais un modèle et un lieu. Au fur et à mesure, avec Clémence quand elle est revenue à Strasbourg, nous avons été de plus en plus engagées à l’Antenne. Celle-ci a aussi été un lieu d’expérimentation, un lieu où je pouvais parler des lectures que je faisais à côté de la fac avec des gens intéressés par le sujet, un lieu aussi où je pouvais écrire des prières pour les personnes LGBT. Ça me nourrissait beaucoup, c’était vraiment un espace de respiration comparé à la fac, lieu tout de même assez violent et compliqué.
Je suis très contente d’avoir fait de la théologie, je ne regrette pas du tout, même si l’arrivée du Covid n’a pas facilité les conditions d’études. Mais heureusement qu’il y a eu l’Antenne toutes ces années pour nourrir ma réflexion sur l’inclusivité, l’accueil des personnes en marge. Ce sont des sujets de plus en plus développés aujourd’hui avec l’inclusion des personnes porteuses de handicaps, l’antiracisme, etc. En réalité, quand on met le doigt sur qui sont les personnes en marge de l’Église, on se rend compte qu’il n’y a pas que les personnes homosexuelles et trans, et c’est le début de notre travail pour aller vers quelque chose de plus grand.
Clémence Sauty: De mon côté je n’ai pas d’histoire légendaire avec plein de rebondissements à raconter. Je suis simplement tombée sur l’Antenne inclusive en cherchant sur Internet.
Tu as donc dû chercher ! Parfois des personnes LGBT chrétiennes m’écrivent pour me demander où elles peuvent aller et je les renvoie aux antennes de Genève ou de Strasbourg. C’est tellement important que cet espace existe… Après avoir trouvé l’adresse, tu as donc débarqué là-bas comme une fleur ?
Clémence Sauty: Exactement. On se voyait tous les premiers lundis du mois et assez rapidement j’ai pu m’engager dans l’organisation des événements. L’idée est de donner un espace de ressourcement permettant de créer du lien social, de ne pas se sentir seuls, de se sentir compris, d’avoir des gens à qui parler à qui on n’a pas besoin de tout expliquer, de tout justifier… C’est un lieu de ressourcement intellectuel et spirituel, aussi. Des conférences sont organisées mais également des temps de prière qui, à mes yeux, sont vraiment très importants.
Pour ma part je suis à l’Antenne pour à peu près 15.000 raisons. J’ai l’impression que c’est tout à fait cohérent avec l’histoire de ma vie car j’ai beaucoup souffert (notamment au moment des années de la Manif pour tous) qu’on parle de nous, comme disait Juliette, comme si nous n’étions pas des êtres humains, comme si nous n’étions pas là, en définitive, comme si nous étions soit un objet, soit une sorte d’expérience de pensée: «Si quelqu’un pouvait être attirée par les femmes en étant une femme, est-ce qu’on serait d’accord pour que cette personne puisse communier avec nous ?» Mais on existe, en fait !… Et non seulement on existe, mais nous avons aussi une dignité humaine, ce qui est non négociable. Pour moi il est vraiment important de rappeler qu’on peut avoir des émotions, qu’on peut avoir des réactions quand on découvre des choses sur des personnes queer, des identités queer.
En ce moment, il y a énormément de débat sur les droits des personnes transgenres. Les sentiments sont propres à chacun ou chacune mais au lieu de projeter ses pensées sur les autres en disant qu’ils sont répugnants ou dangereux, la question est plutôt de savoir pourquoi on a peur, pourquoi cela provoque une réaction aussi épidermique. Pourquoi je me sens en colère tout à coup ? Qu’est-ce qui en moi provoque une émotion pareille pour que j’aie envie de passer du temps à écrire une chronique dans les pages du journal de mon Église ou de ma paroisse pour dire que c’est horrible que les personnes trans existent ? Alors qu’il y a des personnes trans qui sont là, qui ont une dignité humaine, qui sont aimées de leur communauté, de leurs proches, de Dieu, quoi qu’on en dise. Elles ont été créées et choisies par Dieu pour être accompagnées par Dieu toute leur vie.
Pour moi il est vraiment important que nous soyons là et que nous ayons cette possibilité de l’exprimer, parce qu’on est ensemble, parce qu’on est en communauté, parce qu’on est à l’Antenne inclusive. De nombreuses personnes le pensent mais n’ont peut-être pas le lieu ou parfois aussi le courage de le dire. Il n’y a rien à négocier sur la dignité humaine d’une personne, quelles que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre; il n’y a rien non plus à négocier en théologie sur la possibilité pour une personne d’être aimée de Dieu ou non. Car nous sommes aussi souvent accusés de n’être pas capables d’aimer, d’être en lien avec les autres ou avec Dieu. Encore une fois, c’est une projection, cela parle de la personne qui le dit, pas de nous.
Juliette Marchet: Amen to that !
Cela me touche que tu évoques le fait d’avoir la décence et l’honnêteté de reconnaître qu’on a peur plutôt que de pointer du doigt. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le sujet, reconnaître que ça nous fait peur, parce que ça va vite, parce que c’est complexe et que ça nous dépasse, force à montrer sa vulnérabilité. Mais on a tous peur, on a le droit d’avoir peur…
Juliette Marchet: Moi ça me touche parce que je suis dans cette situation un peu rigolote et étrange d’être à la fois pasteure d’une paroisse méga-classique d’Alsace, du Nord de Strasbourg, et en même temps à l’Antenne. Quand j’arrive dans ma paroisse classique, je ne peux évidemment pas prêcher de la même manière qu’à l’Antenne inclusive; ils ne comprendraient pas ce qui leur arrive. C’est une chose qui m’a fait peur quand je suis arrivée dans cette paroisse, en septembre 2023. Je me disais que la seule chose que je savais vraiment bien faire et dans laquelle je me sentais experte était de parler aux personnes LGBTQ+. Comment est-ce que j’allais faire pour parler à des personnes en grande majorité hétéros, alsaciens, etc. ?
Et là où j’ai vraiment pu me connecter avec eux, c’est à l’endroit de la vulnérabilité, à travers le fait que ces personnes, en majorité âgées, ont peur et sont en situation de faiblesse à cause de leur corps qui est en train de les lâcher progressivement, parce qu’elles ont peur de la mort, parce qu’elles ont l’impression que tout va trop vite et qu’elles n’arrivent pas à suivre. Et c’est étonnant parce que moi, je me sentais très vulnérable en tant que personne queer en arrivant dans cette paroisse. Je me suis demandée ce qui allait m’arriver, si je n’allais pas être attaquée, si on n’allait pas me refuser le droit d’être là… Cela n’a pas été le cas mais nous nous sommes rencontrés sur cette vulnérabilité et je garde ce lien en tête quand, souvent, j’essaie de prêcher sur ce sujet.
De plus, il faut quand même garder en tête que, statistiquement, on trouve des personnes LGBT dans toutes les paroisses, même s’il s’agit d’un papy de 80 ans qui a vécu toute sa vie avec une femme. Je me le dis aussi pour me rassurer, me dire que je ne suis pas seule. Aujourd’hui, nous avons réussi à connecter et c’est vraiment très beau. Les personnes avec qui cela se passe particulièrement bien sont en général des personnes ayant des soucis de santé car elles voient bien que je les vois et que j’essaie de leur parler là où elles sont, non pas comme des personnes exceptionnelles à qui l’Église ne parle que parce qu’elles vont bien, mais comme des personnes qui sont empêchées, qui sont en train de vieillir.
«Il faut prendre le temps de mesurer ce que nos paroles impliquent et prendre conscience que ça pourrait impacter des gens pour tout le reste de leur vie»
Ce sont des fragilités qui se rencontrent (enfin, on se comprend, ce n’est pas une fragilité d’être LGBT) ou en tout cas des points sensibles, et parfois ça peut être compliqué. Il faut savoir reconnaître que ce n’est pas simple mais qu’il est possible de se rencontrer dans notre complexité, dans notre humanité.
Clémence Sauty: Oui, et c’est aussi une belle expérience que je vis en ce moment. Et, comme le dit Juliette, l’objectif n’est jamais de juger une personne ou de dire qu’elle est mauvaise parce qu’homophobe ou transphobe. L’idée est de dire que ses actes font du mal et entraînent des conséquences bien plus grandes que ce que cette personne peut imaginer car ils s’inscrivent dans un contexte déjà hyper violent. Peut-être que cette personne ne met que 3, 4, 5, 6 gouttes d’eau… mais derrière, il y a déjà un tsunami dans le monde entier, notamment pour les personnes trans. Dans un certain nombre de parlements, l’idée en ce moment est de retirer un maximum de droits aux personnes trans pour qu’elles n’aient pas le droit d’exister. Quelle alternative cela laisse-t-il aux gens ? De ne pas exister ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire: «Meure !». C’est la seule autre possibilité.
Et de même lorsqu’on dit qu’en tant que chrétiennes et chrétiens, la chose la plus précieuse dans notre vie est l’amour de Dieu et qu’ensuite on se tourne vers la personne à côté de nous pour lui dire qu’elle, en revanche, n’a pas cet amour, qu’est-ce qu’on lui laisse comme alternative ? Je comprends que, puisque beaucoup de choses se passent et que beaucoup de gens prennent la parole, on puisse se dire qu’il faudrait quand même avoir un avis sur ces questions, mais il est important de prendre le temps de réfléchir aux conclusions de certaines prises de position. Quelles possibilités laisse-t-on aux gens quand on leur dit qu’ils ne peuvent pas être en contact avec des humains parce que dangereux, qu’ils ne peuvent pas être en lien avec Dieu, qu’ils sont rejetés par Dieu parce qu’ils l’ont rejeté, qu’ils n’ont pas le droit d’avoir une existence légale administrativement ni d’accéder à des soins médicaux absolument nécessaires à leur vie et à leur épanouissement ? Il faut savoir prendre le temps de respirer et de mesurer ce que nos paroles impliquent pour les gens et prendre conscience que ça pourrait les impacter pour tout le reste de leur vie, parfois avec des conséquences fatales. Je comprends que ce que je dis peut paraître dramatique mais c’est la réalité vécue de ces personnes. Il y a donc cette notion de vulnérabilité qu’on a chacune et chacun la responsabilité d’accepter en soi-même. C’est très dur mais il en va de la vie et de la mort de personnes, notamment les LGBT.
Comment est-ce que ça se passe, à l’Antenne inclusive ? Comment vivez-vous cet accueil, cette communauté, cette communion ?
Juliette Marchet: On revient, avec cette notion d’accueil, à l’idée d’inclusivité. Il arrive que des gens viennent nous demander pourquoi nous nous appelons Antenne inclusive alors que pour eux toute l’Église est inclusive et accueillante. Or, dans la pratique, on sait que ce n’est pas vrai. Les personnes LGBT savent que pour se protéger, elles doivent aller vérifier explicitement si elles sont réellement les bienvenues dans telle paroisse ou telle communauté religieuse. Et nous, à l’Antenne, nous allons avoir un travail d’explicitation, nous allons dire clairement que les gays, les bi, les trans, les personnes non-binaires, etc. sont les bienvenues. On nomme ces personnes, ce n’est pas juste un thème, ni un sujet.
C’est très important que dans nos liturgies et dans nos prières, on parle d’eux et en employant le terme qu’il faut pour qu’ils sachent que c’est bien d’eux qu’on parle. Et ça, c’est rare dans l’Église. Combien y a-t-il de pasteurs dans notre Église en UEPAL qui font des prières d’intersection, qui vont dire qu’ils prient pour les enfants trans ce dimanche ? Ça n’existe pas ! Ou peut-être que ça existe mais je ne suis pas au courant !
Le travail de l’accueil, c’est ensuite un travail de traduction. Pour ce public-là, un public LGBT à qui on a besoin de s’adresser avec certains termes, on se concentre beaucoup sur la parole – ce qui est très protestant –, sur la traduction de la Bible et de la tradition chrétienne. On arrive à le faire parce qu’on est nous-même concernés et qu’on sait ce qui nous ferait du bien. Et ça c’est aussi quelque chose de très fort: ce sont les personnes concernées qui accueillent et non pas une personne hétérosexuelle et cisgenre qui prétendra mieux savoir qu’eux et les considérera comme de pauvres petites choses malmenées. OK, il est vrai qu’on est parfois malmenés, mais nous demeurons assez forts et fortes pour ne pas être simplement des victimes et pour nous accueillir les uns les autres.
Clémence Sauty: Oui, cette idée que chacun et chacune va être présent et présente les uns et les unes pour les autres est très forte car parfois, il suffit d’avoir un lien humain avec quelqu’un qui te dit que tu es important ou importante et qui va prendre 5 minutes pour parler de ta vie avec toi. Tu demandes comment c’est d’être accueilli à l’Antenne inclusive: l’idée est qu’on va remettre de l’Église dans tout ça, dans le sens où on va être deux. Nous sommes des personnes queer parlant à d’autres personnes queer mais nous constituons également une communauté qui nous dépasse. Nous sommes les membres d’un corps qui nous dépasse et dans ce corps existent aussi d’autres personnes qui ne sont pas LGBT mais hétérosexuelles, cisgenres, et qui sont là pour nous dire qu’eux aussi nous accueillent et qu’eux aussi sont accueillis par nous. Il y a cette construction, ensemble, d’une relation. L’idée est que les personnes sachent qu’elles sont accueillies pour ce qu’elles sont et non pas en dépit de ce qu’elles sont, ou en devant se cacher (car il est possible par ailleurs de vivre de cette manière).
Nous donnons ici notre propre point de vue mais certaines personnes LGBT se satisfont très bien de cette notion descriptive des LGBT, sont lesbiennes, par exemple, mais considèrent que cela ne change rien dans leur vie. Pour ces personnes, l’accueil dans l’Église va être totalement différent, elles n’auront pas forcément besoin de se rendre à l’Antenne inclusive, et c’est très bien. Et en même temps, pour ceux qui ont senti qu’ils avaient besoin de s’amputer d’une partie d’eux-mêmes, à qui on a demandé de s’autodétruire pour avoir le droit d’être là, il y a notre espace qui est pensé pour eux, des prières écrites en se disant que, peut-être, cela leur parlerait, des moments de bricolage parce que, peut-être, cela leur ferait plaisir d’avoir un moment ensemble pour parler de religion ou d’autre chose de manière détendue et safe. Nous sommes dans la parole et nous apportons aussi des ressources théologiques, pastorales (il y a d’ailleurs beaucoup de pasteurs dans notre équipe bénévole qui viennent pour nous écouter) mais le fait de simplement créer un environnement où les personnes se sentent bien et où elles ont de l’espace pour se dire, si elles le veulent, est tout aussi important.
«Que tu sois LGBT ou non, ce n’est pas tous les jours qu’on te regarde dans les yeux en te disant que tu es aimé de Dieu»
Y a-t-il une anecdote qui vous aurait particulièrement touchées dans le cadre de l’Antenne ?
Juliette Marchet: Je crois que les moments les plus forts à l’Antenne depuis deux ans ont été nos cultes de Pride. À l’Antenne, on fait un brunch le matin, on invite quelqu’un à parler d’un thème. Il y a deux ans, c’était Flo de la chaîne YouTube Queer chrétienne et l’année dernière, c’était Émeline Daudé. Après le brunch, la petite conférence et les échanges, il y a un temps d’envoi vers la Pride – ou Marche des fiertés – avec bénédiction. Cela fait deux ans que nous pensons une bénédiction qui soit aussi corporelle, où on bénit les gens en leur touchant les mains, en les regardant droit dans les yeux et en leur disant: «Dieu t’aime et Dieu te bénit», avec la mention de leur prénom, le tout suivi d’un petit signe liturgique.
La première année, on avait des croix en paillettes, l’année dernière c’étaient des bracelets arc-en-ciel. C’est vraiment aussi dans ces moments-là que je me suis dit que je voulais devenir pasteure. Là, l’Église fait une différence. Nous ne sommes pas juste dans des groupes unis parce qu’ils sont LGBT mais dans quelque chose de très grand, un endroit où l’on dit à l’autre qu’il est bon et qu’il s’insère dans quelque chose de très grand qu’est l’humanité entière. C’étaient des instants très forts, j’avais les larmes aux yeux, des gens pleuraient… Que tu sois une personne LGBT ou non, ce n’est pas tous les jours qu’on te regarde dans les yeux en te disant que tu es aimé de Dieu. Ce sont ces moments de bénédiction et ils sont pour moi le cœur de nos efforts à l’Antenne.
Clémence Sauty: Je suis d’accord avec Juliette, ces moments-là sont très forts. J’aimerais citer aussi les moments beaucoup plus terre à terre: quand, de temps en temps, on est invité par telle paroisse, tel consistoire ou tel groupe à venir présenter l’Antenne inclusive. On est là, avec notre petit stand et nos quatre flyers, les gens défilent et c’est assez impressionnant de se rendre compte que de nombreux parents de personnes LGBT sont bienveillants; ils ne savent juste pas comment faire mais ont ce courage de venir nous en parler. Pour moi, c’est quelque chose de très touchant et de très beau que je n’aurais sans doute jamais vécu en dehors de l’Antenne inclusive, ces personnes qui viennent me voir en me disant qu’elles aiment leur enfant et qu’elles seront fières de lui ou d’elle dans tout ce qu’il ou elle deviendra mais qui se demandent comment le lui dire. «Comment dire à mon enfant que je l’aime ?», c’est une belle question et je suis très heureuse de l’avoir reçue plusieurs fois.
Une autre initiative que tu as menée, Clémence, pendant plusieurs années c’est ton podcast L’amour, points de vues queers chrétiens. Qu’est-ce qui t’a motivée à faire ce podcast ?
Clémence Sauty: L’amour points de vues queers chrétiens, c’est vraiment basique comme titre mais cela dit déjà beaucoup de choses… Pendant très longtemps, et notamment au moment de la Manif pour tous (mais certainement bien avant aussi), des personnes hétérosexuelles et cisgenres ont voulu dire ce qu’était l’amour queer, comment se passaient les relations amoureuses ou sexuelles dans un couple gay, comment les personnes trans sont en fait dans la détestation d’elles-mêmes. Pour beaucoup d’entre nous, il y a toute une partie de notre vie où notre amour n’était pas notre amour, nos émotions n’étaient pas nos émotions. On nous dictait de l’extérieur qui on était et comment on vivait notre identité, comment on vivait nos relations, ce qui est quand même incroyable !
L’idée a donc été d’affirmer que nous avions aussi cette capacité de nous dire nous-même, parce que nous sommes des êtres humains dignes, réels et vivants. Nous avons cette possibilité nous aussi de faire de la théologie, de prendre la parole et d’aimer, d’aimer vraiment, en tant que nous-mêmes. On est agis par d’autres personnes que nous, des personnes qui souvent nous veulent sans doute du bien mais ne nous font pas du bien. Voilà ce que pour nous veut dire l’amour…
J’ai alors invité des personnes théologiennes et queer, dont notamment Juliette qui est à mes côtés aujourd’hui, mais aussi Émeline Daudé, à venir parler des questions qui s’imposent à nous quand on est dans cette situation. Par exemple, toutes ces personnes qui nous disent qu’elles agissent par amour alors qu’elles nous font du mal, ça nous donne l’impression que c’est totalement normal de vouloir casser une personne parce qu’on l’aime… Est-ce que c’est normal de faire du mal par amour ? Est-ce que l’intention rachète les conséquences ? Ça aussi c’est une question qui s’impose. Est-ce qu’aimer demande du courage et, dans ce cas-là, où est-ce qu’on trouve ce courage ? On a notamment fait un super épisode avec Maxime-Henri Kernen, étudiant en théologie protestante, sur l’éthique de l’amour.
J’espère qu’un jour tous ces travaux-là seront écoutés et lus par des personnes hétérosexuelles et cisgenre parce que, à mon avis, c’est intéressant pour tout le monde. De même que moi, j’adore lire et me nourrir de la théologie noire, autant que de travaux féministes ou queer. Ce sont des points de vue qui sont tellement riches et aussi tellement nouveaux… Non pas qu’ils existent depuis peu de temps, mais comme nous restons souvent entre nous, on ne les connaît pas. Je trouve que c’est une manière magnifique de voir la réalité sous un autre jour. Cela créé des ponts. Et en même temps, au-delà de l’objectif de réconciliation – qui serait une chose magnifique – simplement se dire qu’on peut apprendre d’une personne queer, ou d’une personne noire ! Il y a de très belles choses qui sont dites et qui à mes yeux rendent la vie meilleure.
«Ce serait très enrichissant de prendre le temps de se former collectivement pour mieux comprendre, [avec] un retour historique sur ce qu’ont vécu les personnes LGBT chrétiennes»
Nous avons parlé d’accueil en Église: qu’aimeriez-vous dire ou quelles recommandations, ressources pourriez-vous partager aux personnes qui nous écoutent, aux Églises, aux responsables d’Églises qui aimeraient cheminer sur le sujet ?
Clémence Sauty: Ma première suggestion serait de recruter des personnes queer. À un moment donné, on ne peut pas comprendre une chose qu’on ne connaît pas, c’est normal, et personne n’exige ça de quiconque. Je pense que ce serait très enrichissant de prendre le temps de se former collectivement pour mieux comprendre, et l’un des éléments qui pour moi serait prioritaire dans cette formation-là serait un retour historique sur ce qu’ont vécu les personnes LGBT chrétiennes depuis, disons, le début du 20e siècle. Cela nous permettrait de nous rendre compte de tout ce qui s’est passé et qui a été mis sous le tapis sous prétexte que la situation s’est arrangée.
Tant qu’on n’admet pas que quelque chose de grave s’est passé, qu’on ne le regrette pas et qu’on ne demande pas pardon, qu’on ne travaille pas à la réconciliation avec les personnes qui ont été exclues et maltraitées, et qu’on ne s’engage pas à ne pas reproduire cela en adoptant des politiques, des réflexions, des groupes de travail adaptés, les personnes qui ont vécu ces choses-là, elles, ne peuvent pas vraiment dire que c’est fini. Si c’est sous le tapis, c’est qu’à tout moment cela peut resurgir. Pour moi il y aurait donc cette dimension-là de formation qui ne serait pas dans le but de culpabiliser ou de dire que les chrétiens ont tous tort, mais d’accepter de traiter un passé parfois très, très récent et dont il reste des traces. Tant que cela ne sera pas fait, non, on ne pourra pas affirmer qu’on accueille tout le monde.
On est condamné à répéter notre histoire si on ne la connaît pas. C’est un peu cela ?
Clémence Sauty: Même sans savoir si cela va se répéter ou pas, dans tous les cas, pour les individus qui l’ont vécu, personne n’a mis un point au bout de la phrase, personne n’a fait d’alinéa, personne n’a dit qu’on changeait de chapitre. On est donc toujours dans le même chapitre et toujours dans la même phrase. C’est la même chose qui continue. Ça paraît beaucoup de dire qu’il y aurait une vraie démarche de demande de pardon à faire et en même temps, je pense que tout le monde se sentirait bien mieux une fois qu’on l’aurait fait. Ce serait vraiment très beau et ça ferait du bien non seulement aux croyants mais aussi aux non-croyants à qui cela donnerait de l’espoir, pour ne pas dire de l’espérance.
Juliette Marchet: Tout à fait d’accord avec Clémence. De mon côté, j’insisterais aussi sur des aspects un peu plus logistiques. Par exemple, une personne LGBT en quête d’une paroisse n’a d’autre choix que d’effectuer des recherches approfondies, à part peut-être les personnes qui seraient parvenues à vivre toute leur vie sans jamais être blessées (mais je pense qu’elles sont assez rares). On n’est pas encore arrivé au moment où on est assez apaisé par rapport à l’Église.
Alors, si vous êtes pasteur ou quelqu’un d’engagé dans votre paroisse et que vous voulez montrer aux personnes LGBT que vous êtes accueillants et accueillantes: signifiez-le. Ce n’est pas parce que vous êtes une Église chrétienne et que vous dites être super ouverts que les personnes vont avoir confiance. Cela peut être des petites choses: des drapeaux arc-en-ciel sur la vitrine de la paroisse, même un tout petit, l’idée n’est pas de peindre une fresque ! Ou même expliciter sur le site de la paroisse que tous et toutes sont les bienvenus, en citant les minorités sexuelles et de genre. Cela demande un peu de courage. Et oui, il y a un risque que, peut-être, le vieux paroissien coincé vienne se plaindre et dise que dans ces conditions il quitte la paroisse… Mais dites-vous que les paroisses qui accueillent les personnes LGBT sont rares alors qu’il y en a beaucoup qui accueillent les vieux messieurs grincheux… donc ce n’est pas très grave !
Il est également important de se former, de s’intéresser aux identités LGBT et de respecter les pronoms des gens, évidemment. Si quelqu’un vient et dit qu’elle s’appelle elle, même si vous avez l’impression que cette personne ne ressemble pas à une elle… c’est elle. Respectez les prénoms, les nouveaux prénoms, les changements de prénoms. Tout cela se travaille en s’intéressant un peu à la question.
Parmi les ressources, il y a évidemment les ressources de l’Antenne inclusive. Nous avons un formidable Instagram, en partie managé par Clémence et dans lequel on trouve énormément de ressources. Et vous pouvez aussi contacter l’Antenne inclusive ou l’une de nous pour avoir des informations. D’ailleurs, nous aussi continuons d’apprendre, nous ne savons pas tout. Parfois je me trompe dans les pronoms des gens ou je dis des choses bêtes, qui ne sont pas cool, mais je continue quand même… Parce que si je m’étais arrêtée la première fois par peur de commettre une erreur, je ne serais jamais là où j’en suis maintenant. Et c’est pareil pour les autres: on préfère avoir quelqu’un qui se trompe et qui dit des bêtises mais qui a envie d’apprendre et de comprendre plutôt que quelqu’un qui dit que c’est trop compliqué, qu’il n’a pas envie, que de toute façon il n’y comprend rien. Dans ces cas-là, on n’a pas l’impression d’être accueillis. Ça demande du travail mais ce travail, on le fait pour toutes les communautés et c’est ensemble qu’on fait l’Église. Il y a aussi des personnes queer chrétiennes qui sont formées pour expliquer ce qui doit être expliqué, y aller tranquillement. On n’est pas obligé de tout faire tout seul avec son petit moteur de recherche Internet !
Qu’aimeriez-vous dire aux personnes LGBT qui écouteront cet épisode ?
Juliette Marchet: Je leur dirais franchement qu’être une personne queer dans l’Église, ce n’est pas facile… mais qu’on peut y arriver ! Parfois, je regarde en arrière et je me demande si la Juliette de 14 ans se serait imaginée un jour réaliser qu’elle est bi, être pasteure et être en couple avec la personne la plus formidable de la terre, Clémence. C’est fou ! Ma vie n’a aucun sens, elle est complètement absurde ! Parfois je me demande qui je suis, quoi ! Et en même temps, je suis trop fière de moi et trop contente d’être arrivée là où je suis.
En fait, cette vie est possible. Aujourd’hui j’arrive à vivre dans le présent, à ne plus serrer les dents, à me dire que ça va passer. Pour moi, c’est une super bonne nouvelle de constater qu’on est enfin arrivé au moment où, en tant que personne queer out on peut devenir pasteur (en tout cas dans l’UEPAL et dans l’ÉPUdF), on peut se marier, on peut fonder des familles. Ce n’est pas facile, des luttes restent à mener, on va encore se prendre des trucs dans la tête mais c’est fou, toutes les personnes qui nous soutiennent, nos familles, nos amis, tous ces gens qui nous aiment. C’est une énorme source de bénédiction et de joie pour moi et je pense que ça peut être le cas pour d’autres personne (d’ailleurs, je pense que c’est déjà le cas). Donc ça va aller, vous n’êtes pas seuls !
Et pour les personnes queer qui nous écouteraient, c’est très basique mais le fait que vous soyez là rend le monde vraiment plus beau. C’est aussi pour ça que j’aime tant le mois des fiertés: c’est un moment où je vous vois et je nous vois et je me dis: Waouh, on est vivants, on est vivantes ! On n’avait pas le droit (en tout cas dans beaucoup de nos traditions religieuses), et pourtant on est là… C’est super beau et chaque personne queer est précieuse, non seulement évidemment à mes yeux mais aussi aux yeux de l’Église et aux yeux de Dieu. Je sais que ce n’est pas le message le plus courant mais nous savons très bien tout ce que nous apportons et je crois que ça fait toujours du bien de le redire.
«C’est cette diversité des personnes qui fait la beauté de la création de Dieu»
Et qu’aimeriez-vous dire aux personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBT ?
Juliette Marchet: Vous ne vous débarrasserez pas de nous ! Non, ça c’est la réponse rigolote…
On est ensemble, on fait un corps ensemble. C’est Paul qui dit ça dans l’épître aux Corinthiens. On est tous des parties de ce corps-là et on ne peut pas enlever une partie du corps. Ça signifie qu’on fonctionne ensemble et que c’est cette diversité de personnes qui fait la beauté de la création de Dieu. Nous, à aucun moment nous n’avons envie qu’on soit les seuls sur Terre. Nous voulons juste vivre ensemble car nous sommes appelés à ça par Dieu et par le message du Christ. Nous sommes tous et toutes en chemin, on apprend tous et toutes à vivre ensemble avec nos spécificités et nos besoins. Donc: bon courage, ne vous en faites pas, on est tous passés par là, on continue. De toute façon, si vous suivez l’enseignement de Jésus, ça va bien se passer. Le cœur c’est l’amour, donc on continue comme ça.
Clémence Sauty: Quant à moi, j’aimerais m’adresser tout particulièrement aux parents mais aussi à toutes les personnes qui ont un rôle d’autorité auprès de personnes LGBT, et donc notamment les pasteurs. J’aimerais vous parler de ce moment où une personne décide qu’elle vous fait suffisamment confiance pour partager avec vous des informations nouvelles sur qui elle est et vous inviter à l’accompagner dans sa vie. Parfois ça fait très peur, on peut se demander ce que ça veut dire de soi, si on a fait quelque chose de mal ? On peut craindre pour l’avenir de son enfant, se dire qu’on aurait pu faire quelque chose pour éviter cela. Et je comprends, il faut donner du temps à ces choses-là, mais il faut aussi prendre le temps de respirer parce qu’il y a des choses que vous direz et que vous ferez qui resteront.
Dans un premier temps, peut-être que l’objectif est simplement de ne pas nuire, de dire: «Je suis là, je t’écoute et je prends le temps de découvrir, d’apprendre et aussi de vivre mes émotions». Et dans un second temps seulement, quand vous vous sentez prête et prêt, dire qu’en tant que parent, vous avez une parole à dire, que (par exemple) vous aimez votre enfant, que vous avez mis du temps à comprendre mais que vous allez l’accompagner et être là pour lui. Je ne peux pas vous dire à la place de votre enfant si tout est réparable. Parfois des gens chassent leur enfant de la maison alors que celui-ci est mineur parce qu’il est queer, ou lui font subir des thérapies de conversion (c’est interdit aujourd’hui) qui sont parfois des pratiques de torture. Là, le lien de confiance avec votre enfant peut être rompu, mais dans bien des cas, beaucoup de choses peuvent être réparées et même rendues très bonnes par le pardon.
Cela demande beaucoup de courage mais je vous glisse cette petite idée à l’esprit: si vous avez parlé trop vite, si vous n’avez pas pris le temps de vivre vos émotions et que vous avez reproché à votre enfant, par exemple, les émotions que ça vous suscitait d’apprendre qu’il était queer, eh bien vous avez toujours cette possibilité de demander pardon. Bien sûr, je ne sais pas quelle en sera la conclusion mais en tout cas, de votre côté, rien n’est jamais trop tard: il est toujours assez tôt pour proposer à nouveau, tendre la main à nouveau et redire qu’on s’est trompé et qu’on a envie d’être là pour quelqu’un.
Qu’évoque pour vous le mot protestante ?
Juliette Marchet: Pour moi, protestante, c’est une fierté, comme le fait d’être queer, parce que c’est vraiment la tradition religieuse qui me convient. C’est une communauté dans laquelle j’ai envie d’être et c’est une fierté aussi parce que ce n’est pas une identité majoritaire, comme être queer, et donc c’est aussi un coming-out qu’on fait de temps en temps: dire qu’on est protestante face à des gens qui ne connaissent pas, qui disent que c’est comme être catholique, etc.
Clémence Sauty: J’ai envie de dire tout comme Juliette. Parce qu’effectivement pour moi, protestante veut aussi dire vivre dans le pluralisme, aimer le pluralisme et ne pas en avoir peur puisqu’il y a cette idée qu’une Église est une Église et qu’il y a toute une diversité d’Églises protestantes. Je trouve ça magnifique de pouvoir vivre dans ce pluralisme-là et d’expérimenter les mêmes démarches intellectuelles et recherches qui ont mené les réformateurs à dire qu’il y avait des choses qui pouvaient être aménagées pour lutter contre les injustices. On peut encore dire aujourd’hui qu’une tradition religieuse nous est précieuse, à tel point que lorsque ce n’est pas juste, on peut décider de prendre la parole.
Transcription: Pauline Dorémus
Illustration : autocollant «God Made Me Queer» de la Metropolitan Community Church in New York dans une salle d’attente de Pennsylvania Station à Manhattan, New York City (photo Bohemian Baltimore, CC BY-SA 4.0).