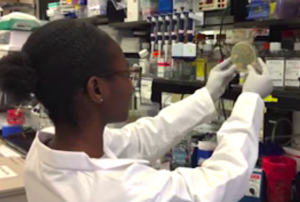L’exercice de la preuve et ses échappatoires
Les polémiques autour de la chloroquine et du docteur Raoult ont montré à quel point «le jeu médiatique peut déformer et rendre extrêmement difficile l’exercice de la preuve». Si nous nous en passons très bien au profit de la confiance «dans la plupart des domaines de notre existence», il en d’autres où elle importe comme la justice et la science où le fait décisif est peut-être que «seul celui qui est prêt à être contredit peut valablement dire qu’il cherche des preuves». Ce qui nécessite un «laborieux et long travail» avec «arguments et contre-arguments» auquel le champ médiatique est particulièrement «mal adapté».
Texte publié sur Tendances, Espérance.
Qui a envie de prouver ce qu’il dit ? Et qui essaye d’examiner si les affirmations de quelqu’un sont prouvées ? En fait, pas grand monde. L’exercice de la preuve est un exercice rébarbatif et, pour couronner le tout, souvent décevant, car on s’aperçoit que l’on doit changer d’avis !
Quand j’ai commencé mon activité de chercheur, mes premières interventions publiques, en dehors du champ de la recherche, ont été plutôt laborieuses : je passais beaucoup trop de temps à essayer de prouver ce que je disais, ce qui, finalement, lassait l’auditoire ! Au fil du temps, je me suis rendu compte que les affirmations gratuites ne gênent pratiquement personne, du moment que ce qu’on dit fait sens aux yeux des auditeurs. Cela m’impose une exigence éthique : c’est à moi de ne pas dire n’importe quoi et de ne pas abuser les autres. J’essaye, en général, de donner des indices assez faciles à exposer, qui soutiennent mon propos (c’est ce que je fais, également, ici). Mais il est difficile d’aller plus loin et, en fait, un exposé habile est capable, je l’affirme (gratuitement !), de faire passer n’importe quelle opinion.
Et, d’ailleurs, dans la plupart des domaines de notre existence, nous n’avons pas besoin de preuves. La confiance y supplée avantageusement et ce n’est pas moi qui vais ironiser sur la foi ! Je reparlerai de la foi à la fin de ce texte.
Mais il y a des domaines où la preuve importe.
On ne juge pas quelqu’un, dans un tribunal, sans preuve : l’enjeu est trop grave.
Et, en principe, l’activité scientifique est régulée par la preuve : pour l’ensemble de la collectivité, c’est ce qui est le plus efficace, même si pour chaque chercheur en particulier cela peut être un inconvénient. Le chercheur qui veut publier, et accéder à une certaine notoriété, n’apprécie pas forcément la remise en question de ses affirmations, lorsqu’elles sont mal étayées.
La preuve judiciaire
Commençons par l’activité judiciaire qui met en évidence plusieurs aspects importants :
D’abord, administrer la preuve coûte extrêmement cher. Des bataillons de personnes doivent se déployer pour récolter des témoignages, des indices matériels, des documents divers. Ensuite, il n’y a pas de preuve sans débat contradictoire. Aucune preuve n’est décisive par elle-même. En admettant, par exemple, que l’on ait filmé un crime (ce qui est extrêmement rare), il reste bien des questions ouvertes : y avait-il préméditation ? peut-on considérer que l’auteur a des circonstances atténuantes ? y avait-il des complices ? Toute preuve doit donc s’apprécier dans le cadre d’un procès où accusation et défense se rendent coup pour coup. Les juges ou les jurés doivent délibérer, donc discuter entre eux. Et, dernier point, tout cela prend du temps : on ne se forme pas une opinion éclairée en cinq minutes.
Ce qui me semble décisif est que (dans le domaine judiciaire, comme dans n’importe quel autre domaine), seul celui qui est prêt à être contredit peut valablement dire qu’il cherche des preuves. Dans tous les autres cas on peut parler d’expertise, éventuellement, mais pas de preuve. La preuve scientifique (et, contrairement à ce qu’on pense, cela vaut autant pour les sciences humaines et sociales que pour les sciences dites dures) est un protocole qui permet à des personnes de discuter, de se remettre en question les unes les autres et de se donner des moyens de produire un consensus à partir d’autre chose que d’un rapport de force.
Les scientifiques eux-mêmes sont tentés de biaiser avec les exigences de la preuve
C’est, en fait, une disposition d’esprit tellement inconfortable que beaucoup de chercheurs tentent d’y échapper au moins partiellement. J’ai siégé, à la fin de ma carrière, dans des comités de rédaction de revues, dans des comités de sélection de communications pour des colloques, dans des comités de recrutement divers et les rapports de force foisonnent dans ces lieux qui prennent des décisions importantes pour la carrière des chercheurs. Il m’est arrivé, à deux reprises, de proposer (après lecture à l’aveugle) de refuser un article bâclé, rédigé par un collègue connu (pas deux fois le même !) … à qui on a simplement demandé de mieux argumenter son papier. Mais plus généralement, il est clair que les logiques de chapelle, d’alliance, sont extrêmement fortes et cela nuit, d’ailleurs, à la qualité d’ensemble de la recherche. Les papiers soumis à des colloques prestigieux ressemblent les uns aux autres, car ceux qui les soumettent doivent respecter certains prérequis qui les rangent dans une chapelle donnée. Quant aux recrutements, ils ne s’effectuent jamais en double aveugle et le mandarinat peut s’y déployer librement.
La pression qui a été mise, ces dernières années, sur la quantité de publications a engendré, par ailleurs, des dérives, avec des revues (heureusement repérées par les spécialistes, en général) qui publient avec des lecteurs de complaisance, pourvu que celui qui soumet paye. Et même les revues sérieuses ne parviennent pas à se prémunir complètement contre les fausses expérimentations.
La science dans le jeu médiatique : deux types de discours qui cohabitent mal
Voilà le tableau général. Venons-en à des événements plus proches de nous.
On a beaucoup écouté dans les médias ces trois derniers mois des médecins universitaires. Et on a vu, alors, comment le jeu médiatique peut déformer et rendre extrêmement difficile l’exercice de la preuve. Entendons-nous bien : les médecins ont tous accumulé une expérience qui leur donne certaines compétences et une certaine expertise. Il est donc tout à fait normal d’écouter leur avis.
Mais restons sur la question de la preuve qui, je le répète, est autre chose qu’une expertise.
La saga de la chloroquine (mais il y aurait d’autres exemples, moins développés, à citer) me semble tout à fait emblématique de ce qui peut se passer dans une arène médiatique. Ce n’est pas la personnalité du principal acteur de cette saga qui m’intéresse. Je veux plutôt dérouler la manière dont il a raisonné et montrer l’écho qu’il a reçu dans les médias. Le 11 février, alors qu’aucune étude clinique n’est encore disponible, trois chercheurs dont Didier Raoult adressent une brève note à une revue (l’article sera mis en ligne le 15 février (1)) pour rappeler l’intérêt de la chloroquine dans le traitement des maladies virales. J’en extrait deux phrases : « We had 20 years ago proposed to systematically test chloroquine in viral infections because it had been shown to be effective in vitro against a broad range of viruses » (Nous avions il y a 20 ans proposé de systématiquement tester la chloroquine dans les infections virales car elle s’était révélée efficace in vitro contre un grand nombre de virus). L’argument reste le même 20 ans plus tard : le médicament est actif contre les virus in vitro, il faut donc l’essayer cliniquement. C’est la conclusion de cette note : « If clinical data confirm the biological results, the novel coronavirus-associated disease will have become one of the simplest and cheapest to treat and prevent among infectious respiratory diseases » (Si les données cliniques confirment les résultats biologiques, la nouvelle maladie associée au coronavirus aura été l’une des plus simples et moins coûteuses à traiter et prévenir parmi les maladies respiratoires infectieuses).
Jusque là, l’argument est tout à fait recevable. Le fait de rappeler que cette idée poursuit les auteurs de l’article depuis 20 ans crée quand même un léger malaise. Cela anticipe sur ce qui va se passer ensuite : l’idée de départ, qui précédait tout essai clinique, va rester inébranlable et toutes les remises en question seront sans effet. Sitôt les premières études cliniques publiées en Chine, Didier Raoult publie une vidéo, le 25 février, pour mettre en avant cette piste thérapeutique. Médiatiquement, c’est un scoop.
Je ne vais pas retracer toute la saga. Il faut souligner que Didier Raoult est un bon sujet pour les médias : un look anticonformiste, la langue bien pendue, l’art et la manière de créer l’événement par des déclarations à l’emporte pièce, etc.
Les premières études cliniques qu’il publie sont critiquées : mais toute étude clinique doit l’être, c’est normal. Ayant longuement pratiqué la statistique, j’essaye, pour ma part, de me faire une idée du débat. Le point d’achoppement est clair : vu qu’il prescrit de la chloroquine (je dis chloroquine pour simplifier mon propos, il y a d’autres molécules en jeu) rapidement, à des personnes qui ont encore peu de symptômes, il mélange des personnes qui auraient guéri spontanément et des personnes qui auraient eu besoin d’une assistance médicale de toute manière. Donc, quand on regarde l’évolution de la maladie, on ne peut pas savoir quel est l’effet propre du médicament (sans compter qu’il ne fait pas de test avec un groupe témoin et un placebo). Pour autant que je puisse en juger, ce point d’achoppement restera tout au long de cette histoire et l’auteur ne fera pas grand chose pour répondre aux objections.
Mais (et c’est pour cela que je tiens à dépersonnaliser cette histoire) cela ne nuit aucunement à sa surface médiatique. Seul Médiapart (à ma connaissance) fait, début avril (2), un travail journalistique sérieux en se renseignant sur les raisons pour lesquelles le CNRS et l’Inserm ont retiré en 2018 leur label au laboratoire alors dirigé par Didier Raoult (dont les contours ont changé depuis). En d’autres temps, cet article aurait été totalement ravageur. Mais la saga de la chloroquine est devenue une affaire internationale. Et, d’ailleurs, il reste tout à fait possible que le médicament soit efficace (ce n’est pas parce que la démonstration est lacunaire que le résultat est faux).
Et, finalement (je fais un grand bond en avant dans le temps), c’est l’étude parue dans The Lancet qui tombe, le 22 mai. Là les auteurs de l’article se sont vraiment donné les moyens de faire des comparaisons (même si, il faut le souligner, ils n’ont pas recouru à un groupe témoin avec placebo : ils ont comparé l’effet de différentes stratégies thérapeutiques entre des malades aussi comparables que possibles). Les conclusions sont totalement défavorables à la molécule (et ses dérivés et adjuvants). Cette dernière étude est elle-même critiquée : une fois encore, c’est normal. La lettre ouverte (3) envoyée à la rédaction de The Lancet, le 28 mai est dans l’ordre des choses : il faut pouvoir accéder aux données afin de vérifier les dires de l’article. D’autres réactions posent plus question. Didier Raoult qualifie d’emblée l’étude de « foireuse » et finit par dire : « rien n’effacera ce que j’ai vu des mes yeux ». La phrase m’a frappé, car je l’ai entendue à de nombreuses reprises comme objection à des résultats des sciences sociales. L’une ou l’autre personne fait part de son expérience : « moi je sais, car j’ai vu ». Mais, justement, on essaye de faire de longues vérifications pour se prémunir contre les impressions spontanées dont on sait qu’elles peuvent parfaitement être trompeuses.
Là dessus un ancien ministre de la santé, médecin lui-même (et membre du conseil d’administration de l’IHU de Marseille), critique l’étude publiée par le Lancet en disant que les malades n’ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques d’un groupe à l’autre. Peut-il ignorer que, précisément, l’avantage des grands nombres et de cette méthodologie est de permettre de comparer, d’un groupe à l’autre, des malades comparables ? En clair, s’il y a 50 malades dans le cas A dans le groupe 1, et 100 malades dans le même cas dans le groupe 2, on ne va pas comparer globalement le groupe 1 et le groupe 2 : on va comparer les 50 malades du groupe 1 et les 100 malades du groupe 2 qui relèvent, les uns comme les autres, du cas A. Mais peu importe, il a réussi à jeter le trouble et il faut de laborieux efforts de la presse pour expliquer pourquoi cette critique est fallacieuse.
Le temps incompressible de la preuve
Une nouvelle question a surgi, ces derniers jours, concernant la possibilité d’une immunité croisée (certaines personnes pouvant être protégées du Covid-19 par leur résistance passée à des coronavirus moins agressifs). Pour le coup, la plupart des tenants de cette hypothèse usent de prudence et ne lui donnent que le statut d’hypothèse. Pour autant que je puisse en juger, certains indices accréditent cette hypothèse et d’autres la discréditent (notamment l’infection de 70% des marins du Charles de Gaulle). On en est aux indices. Obtenir une preuve est impossible à court terme. Et aucun décideur politique n’aura l’idée de se lancer dans une expérimentation en grandeur réelle !
Pour un chercheur il est absolument normal de faire des hypothèses, et c’est même plutôt stimulant. Mais, en l’occurrence, on voit bien la charge émotionnelle très forte d’une telle hypothèse, qui la fait rentrer dans un champ très étranger au laborieux et long travail de la preuve.
Une fois encore, le champ médiatique est mal adapté aux arguments et contre-arguments qui président, progressivement, au travail de la preuve.
Et la foi ?
Il n’en reste pas moins que la confiance (pour y revenir) est, dans un autre registre que celui de la preuve, un phénomène social tout à fait décisif, y compris dans l’acte thérapeutique. La confiance entre le médecin et le malade est un facteur décisif pour l’efficacité du traitement. L’état d’esprit du malade, son optimisme ou son pessimisme, jouent également un rôle fort.
D’une manière plus générale, la confiance est quelque chose de crucial. Certaines personnes deviennent capables de faire des choses étonnantes simplement parce qu’on leur fait confiance. Et la réciproque est vraie : la défiance détruit.
La confiance dans la vie, en Dieu ou dans les autres, a, pour l’essentiel, trait au sens, à la valeur que l’on attribue à des choix. On se consacre à certaines activités, on passe du temps avec certaines personnes, on développe des relations, parce que l’on est convaincu que cela vaut la peine. La foi appartient à ce registre. C’est parce que j’entends dans l’appel de Dieu une parole libératrice, qui me propose un projet de vie motivant, que je lui accorde ma confiance. Et ce projet de vie inclut l’attention aux autres.
Or, c’est parce que je considère que l’on ne doit pas faire n’importe quoi avec les autres, qu’il me semble important, au moins pour certains actes graves et décisifs, de bien peser nos choix, d’examiner jusqu’à quel point ils peuvent être améliorés et, pour ce faire, d’entamer une discussion serrée où autre chose que de simples opinions s’exprime.
Autrefois des théologiens ont tenté de prouver l’existence de Dieu. Mais, pour moi, la dynamique est inverse : c’est parce que je crois en Dieu que je trouve important de prendre le temps de considérer collectivement ce que nous faisons, dans des arènes où on se donne des outils d’évaluation robustes et partagés pour trancher entre plusieurs décisions, plusieurs stratégies possibles, là où le choix n’a rien d’évident a priori. C’est cela prouver. Cela implique que l’on peut se tromper collectivement. Toute connaissance ainsi produite est révisable. Mais c’est, quand les décisions sont lourdes de conséquences, la moins mauvaise manière de décider.
Illustration : personnes attendant pour se faire dépister devant l’IHU Méditerranée Infection à Marseille.
(1) Chloroquine for the 2019 novel coronavirus SARS-CoV-2, International Journal of Antimicrobial Agents, volume 55, n°3, mars 2020.
(2) Chloroquine: pourquoi le passé de Didier Raoult joue contre lui, Pascale Pascariello, Médiapart, 7 avril 2020.
(3) Concerns regarding the statistical analysis and data integrity, 28 mai 2020.