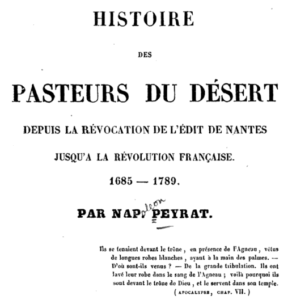François Hartog : «Un moment d’entre deux»
«On a d’un côté ce qui n’est plus et de l’autre ce qui n’est pas encore» : s’il y a effectivement un monde d’avant et un monde d’après, on ne peut ni chercher dans le passé des moments comparables, ni en tirer d’hypothétiques «leçons de l’Histoire». Le philosophe et historien François Hartog nous invite lui à utiliser le concept de brèche dans le temps pour comprendre la crise actuelle et se projeter dans le futur en laissant derrière nous ce qu’il appelle le présentisme, attitude au temps qui fait fi à la fois du passé et de l’avenir.
Texte publié sur Le blog de Frédérick Casadesus.
Le débat public, depuis le mois de mars, est encombré de références historiques. Ici autant qu’ailleurs, les lecteurs ont pu s’abreuver de mille retours au passé – comme à quelque village d’enfance. Une telle démarche, même quand elle se nourrit de bonnes intentions, peut se révéler vaine.
«Un certain nombre de nos concitoyens déclarent qu’il est bon de regarder ce qui a existé pour comprendre le présent, mais ils se gardent bien d’en tirer les conséquences, regrette en souriant François Hartog (1). On s’est beaucoup servi de l’expression « leçons de l’histoire », évoquant notamment la peste noire, la grippe espagnole ou la fameuse grippe de Hong-Kong – laquelle, en 1969, a provoqué la mort de 30000 Français dans l’indifférence générale. Mais la plupart de ceux qui se sont livrés à de tels exercices avaient pour ambition de dire, soit que l’on n’avait pas tiré de leçons de ce qui avait eu lieu, soit que l’on était coupable d’amnésie. Cela n’avait pas beaucoup d’intérêt. »
Devons-nous renoncer à tisser des liens entre ce qui a été, ce qui est, ce qui sera ? Non, bien entendu. François Hartog appelle en revanche à relativiser les situations. «Attention, prévient-il, cela ne veut pas dire que l’on doive tomber dans le relativisme, prétendre que tout se vaut. Bien au contraire, il s’agit de mettre en rapport les événements les uns avec les autres, dessiner un paysage, une cartographie qui permette à chacun d’éveiller sa conscience. L’historien ne doit pas adopter une position de surplomb, mais contribuer à ce que nos concitoyens ouvrent les yeux, qu’ils voient plus clair, qu’ils soient plus lucides – au sens littéral, puisque cet adjectif tire son origine du mot lumière.»
Depuis quelques semaines, le débat fait rage entre les tenants de la table rase et les partisans de la préservation de ce qui existe. «Les deux forment un couple, estime notre interlocuteur. Pour eux, cette crise est un « kairos », une occasion à saisir. Les plus radicaux se postent à l’avant-garde, révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Mais sommes-nous certains d’aborder correctement la notion de rupture, alors que notre vie, collective comme individuelle, paraît portée, voire tendue vers l’illusion d’une continuité, d’un avenir pacifique sans fin ?»
Quand un accident spectaculaire se produit, on est désorienté. Pour faire face, pour comprendre ce qui nous arrive, plusieurs attitudes sont possibles. La première consiste à établir des parallèles entre ce que l’on vit et ce qui a été jadis. Pour François Hartog, il n’y a là rien de nouveau: «Plutarque, déjà se livrait à cet exercice. Mais c’est une illusion car, comme le disait Montaigne, « tout exemple cloche » (2). Et c’est encore plus vrai quand on compare des événements qui se sont déroulés à des époques radicalement différentes.» Pour le dire aimablement, à quoi sert d’évoquer la Peste noire à propos du Covid-19 quand sait tout se qui distingue notre temps du 14e siècle ? Est-il pertinent de trouver dans la débâcle de juin 40 quelques points de ressemblance avec le printemps 2020 ?
La recherche d’un bouc émissaire est un autre réflexe. Depuis le mois de mars, entre les Chinois, les laboratoires, les chercheurs et les pouvoirs publics, on a l’embarras du choix. Que le Premier ministre soit visé par une soixantaine de plaintes en dit long sur la pérennité de cette tradition.
«La grande difficulté qui s’impose à nous tient à ce que l’on essaie de comprendre ce qui est en train d’advenir avec les mots, les idées qui appartiennent à ce qui, déjà, n’est plus.»
Mais le concept de rupture ne provoque pas que des maladresses ou de mauvaises manières. Ainsi la philosophe Hannah Arendt a théorisé la notion de brèche dans le temps (3). Ce concept, à l’heure où nous cherchons des clés pour ouvrir de nouvelles portes, pourrait nous être utile. « C’est un moment d’entre deux, où l’on a d’un côté ce qui n’est plus et de l’autre ce qui n’est pas encore, explique François Hartog. La grande difficulté qui s’impose à nous tient à ce que l’on essaie de comprendre ce qui est en train d’advenir avec les mots, les idées qui appartiennent à ce qui, déjà, n’est plus. Comment penser la nouveauté sans se servir de concepts qui ont déjà servi, fusse pour leur donner un sens nouveau ? Telle est la gageure qui nous est lancée.»
Une telle démarche permet de renouer un lien avec l’Histoire, alors que depuis quelques années ce qui était un récit commun – et discuté – s’était effacé au profit de la Mémoire. Comme on le sait, François Hartog a théorisé ce qu’il nomme le présentisme, un rapport au temps qu’il critique parce qu’il fait fi de ce qui a été, qu’il refuse de se projeter dans l’avenir. «La rupture de toute continuité, voulue, espérée par Michel Foucault, s’est réalisée, observe-t-il. Dans ce cadre, les événements se succèdent les uns aux autres, un ordinaire des jours interdisant de concevoir toute aventure collective, tout imprévu se trouvant assimilé à une catastrophe.»
Le président de la République, dès la fin du mois de mars, a déclaré que rien ne serait plus comme avant. Cette affirmation, qu’on s’en réjouisse ou le déplore, est partagée par beaucoup. Avec la pandémie du Covid-19, le présentisme a-t-il connu sa première brèche ? «On aimerait le croire, nuance encore François Hartog. Mais si le président de la République a paru désigner un temps suspendu, à l’intérieur duquel nous pourrions penser le monde d’une manière nouvelle, il a aussi induit l’idée qu’il en avait la maîtrise. Or, il ne suffit pas de décréter que nous entrons dans une brèche du temps pour que cela se mette en œuvre de manière mécanique. Autrement dit, les déclarations présidentielles pourraient tout aussi bien refléter une toute autre intention, celle qui reviendrait à dire que tout commence et tout finit avec lui, avec nous. La circonspection des Français quant à la possibilité que rien ne soit plus comme avant pourrait s’expliquer par là : sans identifier des faux semblants, des mensonges, une hypocrisie, peut-être perçoivent-ils un hiatus.» Cultivons notre lucidité…
Illustration : la sculpture d’Arman L’Heure de tous, cour du Havre à Paris, devant la gare Saint-Lazare.
(1) Il vient de rédiger la préface de l’ouvrage de Georges Duby Sur les traces de nos peurs (Textuel) et publiera cet automne un nouveau livre, Chronos, aux éditions Gallimard.
(2) «Comme nul évènement et nulle forme ressemble entierement à une autre, aussi ne diffère nulle de l’autre entièrement. Ingénieux mélange de nature. Si nos faces n’étaient semblables, on ne saurait discerner l’homme de la bête ; si elles n’étaient dissemblables, on ne saurait discerner l’homme de l’homme. Toutes choses se tiennent par quelque similitude, tout exemple cloche, et la relation qui se tire de l’expérience est toujours défaillante et imparfaite.» (Essais, 3, 13, De l’expérience).
(3) En particulier dans son introduction à La crise de la culture (Between Past and Future, 1961), où elle part d’une citation de René Char à propos de la rupture provoquée par la Seconde Guerre mondiale: «Notre héritage n’est précédé d’aucun testament».