Un recueil pour le Rwanda
«Parcourir un chemin de sympathie», «nommer ceux qui sont morts»: c’est en poésies que Jacqueline Wosinski, infirmière et enseignante-chercheuse dans des écoles de soins infirmiers, en mission au Rwanda jusqu’en 1991, a choisi pendant les 30 années qui nous séparent du génocide de 1994 de «rendre un hommage digne à chacun des personnages qu’elle a connus, appréciés, aimés». Elle l’accompagne d’une réflexion critique pour expliciter son propre Chemin à travers le non-sens.
Un recueil, comme on dirait recueillement, pour le Rwanda, ce pays d’Afrique où a eu lieu, en 1994, un des génocides du 20e siècle.
Questions africaines
L’Occident s’interroge, actuellement, sur la politique africaine qu’il a menée dans les décennies passées. Peut-être a-t-il fallu que le Sud global, selon l’expression actuelle, l’incite vivement à reconnaître ses connivences avec des régimes corrompus et son soutien apporté sans scrupule à des ethnies alliées devenues meurtrières, et à réparer autant que faire se peut les blessures de la mémoire.
En ce qui concerne la France, le 12 août dernier notamment, une lettre rendue publique du président Emmanuel Macron adressée à Paul Biya, son homologue camerounais, a établi la responsabilité de notre pays dans la guerre menée contre des groupes insurrectionnels luttant pour l’indépendance, et dans la persistance de ces actions même après la décolonisation. Dans ces périodes agitées, des massacres de masse ont eu lieu.
Pour le Rwanda, toute clarté ne semble pas avoir été faite dans le parti pris par la France à l’égard du génocide des Tutsi: le 21 août, il y a quelques jours, deux juges d’instruction parisiennes ont ordonné un non-lieu en faveur d’Agathe Habyarimana, soupçonnée d’entente en vue du déclenchement du génocide et installée en France sans statut légal, après avoir été exfiltrée de son pays en avril 1994. Cette décision scandalise le Parquet national antiterroriste et les parties civiles; elle est dénoncée comme une «aberration révoltante» par le collectif de leurs associations (1). L’instruction «incompréhensiblement bâclée», selon leurs termes, laisse peser la suspicion, de leur point de vue, sur l’impartialité de la justice et fait planer l’idée que l’examen de conscience n’est pas achevé, dans ce cas précis.
L’actualité brûlante du sujet se manifeste aussi à travers les productions des artistes et des intellectuels: Michel Bussi, célèbre écrivain, vient tout juste de publier un roman, Les ombres du monde, qui raconte cent jours de terreur et de sang des massacres rwandais, sur un mode à la fois historique et fictionnel. Au micro des stations de radio où il est invité à présenter son livre en cette rentrée littéraire, il appelle avec véhémence la France à clarifier son récit des événements, sinon son action passée (2).
Il se trouve que la rentrée littéraire des éditions Jas sauvages fera écho à ces sujets, avec la parution du recueil intitulé Sous l’arche d’eucalyptus (3), qui évoque lui aussi les événements du génocide rwandais. Jacqueline Wosinski, qui fréquente les paroisses de l’Église protestante unie dans la vallée du Buëch, nous a confié cette collection de textes, écrits entre avril 1994 et la commémoration des trente ans du massacre, en avril 2024.
Le génocide rwandais à travers un recueil de poèmes
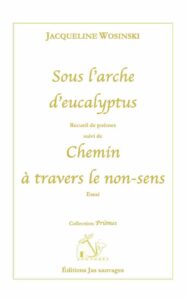 Pourquoi ajouter un recueil de poésie à la littérature abondante qui se diffuse sur cette période de l’histoire récente ? Sans doute parce qu’il s’agit là d’un genre littéraire bien particulier, qui affine notre perception et notre sensibilité humaine. On pourrait lui appliquer les vertus qu’un personnage de Dostoïevski reconnaît à la prière, dans Les Frères Karamazov, car ces deux voies d’inspiration éclairent mystérieusement les consciences :
Pourquoi ajouter un recueil de poésie à la littérature abondante qui se diffuse sur cette période de l’histoire récente ? Sans doute parce qu’il s’agit là d’un genre littéraire bien particulier, qui affine notre perception et notre sensibilité humaine. On pourrait lui appliquer les vertus qu’un personnage de Dostoïevski reconnaît à la prière, dans Les Frères Karamazov, car ces deux voies d’inspiration éclairent mystérieusement les consciences :
«Jeune homme, n’oublie pas la prière. Si ta prière est sincère, chaque fois un nouveau sentiment y passera, et en lui une pensée nouvelle, que tu ne connaissais pas encore et qui te redonnera du courage: et tu comprendras que la prière est une éducation» (4).
En l’occurrence, lire de la poésie équivaut à partager l’émotion et la pensée de l’écrivain, à s’enrichir d’une ouverture à l’humanité de l’autre. Et quand il s’agit d’accéder à une expérience aussi bouleversante, d’un point de vue aussi exceptionnel, l’écriture poétique devient irremplaçable pour élargir notre être dans la fraternité.
Jacqueline Wosinski a été chercheuse dans les disciplines médicales, enseignante dans des écoles de soins infirmiers, en mission au Rwanda jusqu’en 1991. Elle a donc subi violemment le choc des événements de 1994, à travers des répercussions psychologiques qui l’ont profondément marquée. Certains de ses textes s’apparentent à la prière. L’un d’eux porte d’ailleurs précisément ce titre. En voici un extrait qui manifeste les qualités de son écriture :
Le lac céruléen
Inviolé par l’histoire
Ne mire que les cieux
Un soir pourtant
Les rais fuyants
Charrièrent du sang
Les rouges briques tièdes
De l’église centenaire
Appellent à la prière
Qu’au pays des collines
La repentance soit seconde chance
Et le pardon bénédiction
Quelquefois les lecteurs éventuels redoutent la difficulté de l’expression poétique. Il est clair qu’ici, il n’en est rien. Les textes sont des tableaux, quelquefois des récits qui reflètent l’histoire, dans une recherche de paix toujours inventive de ses méthodes: le pardon, la guérison médicale des traumatismes. L’évocation des massacres est intense et sobre dans l’écriture de Jacqueline Wosinski, mais sa profession imprime sa vocation de soignante à l’intérieur même de son œuvre poétique. Elle se ressource dans la chaleur, les couleurs et la sérénité des paysages, en particulier celle du lac Kivu dépeint en quelques traits dans ces strophes.
Pour ma part, j’ai éprouvé l’efficience de sa poésie qui nous fait parcourir un chemin de sympathie, à la rencontre du souvenir de personnes dont on nous fait rarement connaître avec autant de cœur la résilience malgré le dénuement, le courage, la fragilité extrême ou la sagesse malgré la détresse. Quelquefois l’approche n’est pas dénuée d’un humour attendri, quelquefois elle déborde d’affection. La poésie est déclinée dans toutes les nuances de la bienveillance des relations humaines.
Jacqueline Wosinski nomme ceux qui sont morts, ses textes prennent alors toute la puissance d’un mémorial qui fait vivre, encore, les victimes, dans la résistance au néant qu’opposent les mots. Cependant, ils ne bercent pas d’illusions. Un poème dédié à Jean Nkuranga, directeur de l’École de Science Infirmière où Jacqueline Wosinski, a exercé énonce l’irréparable et nous laisse atterrés:
TU TE NOMMAIS JEAN NKURANGA
Il en a fallu des fagots
Sous la lourde marmite
Pour que tu grandisses
Trop
Il en a fallu des courses
Sur les chemins pentus
Pour que tu apprennes
Bien
Il a fallu quelques saisons
Pour qu’au sein du rugo (5)
Le mariage s’édifie
Fort
Il t’a fallu bien du courage
En dépit des embûches
Pour rester debout
Droit
Il a fallu tant de haine
En maillage acharné
Pour que tu tombes
Mort
Cette poésie varie sans cesse son style, de manière à surprendre toujours le lecteur par des aspects inattendus de la situation, par l’irruption de personnages touchants et pittoresques. Dans le souci de rendre un hommage digne à chacun des personnages qu’elle a connus, appréciés, aimés, Jacqueline Wosinski invente un art consommé, jamais uniforme, toujours vivant dans sa recherche des effets justes et parlants.
L’impératif de la lecture
Pourquoi lire un tel recueil, poignant, qui va nous prendre aux tripes et nous heurter jusqu’à nous laisser l’âme chancelante ? Ce serait un argument facile que d’insister sur les pistes d’avenir annoncées par ce livre. Certes, elles existent. Mais surtout, Jacqueline Wosinski avance de manière imparable l’argument de la manifestation de notre mort spirituelle que représenterait notre indifférence, si nous nous détournions pour protéger notre sensiblerie.
Elle a d’ailleurs placé l’ensemble des poèmes sous le signe de Pâques, puisque les massacres ont commencé vers cette date, en 1994:
«Nous venions de célébrer Pâques, ce qui explique le titre du premier poème de ce recueil. Je l’ai écrit d’un jet, à ce moment-là, et l’ai très peu remanié par la suite. Il me semblait que la mort du Christ et celle des Tutsi participaient de la même pulsion destructrice».
Si le supplice du Christ n’entre pas dans notre dévotion comme une image traditionnelle de l’histoire sainte, désormais dénuée de mordant sur nos consciences, alors sans doute ne pouvons-nous pas nous dérober à cette réactualisation du message, telle que Jacqueline Wosinski nous la propose.
D’autant qu’alors, nous pourrons mettre en œuvre ce que Paul appelle «l’allègement du chagrin partagé», dans la Deuxième épître aux Corinthiens (6), et que son art d’écrire aura réussi à créer le recueillement d’une vraie communauté en poésie.
Poèmes et réflexion critique
Dans une deuxième partie du livre, l’autrice développe une réflexion, sous forme d’essai, intitulée: Chemin à travers le non-sens. Elle y explique avec le ton mesuré qui est sa marque de fabrique, toutes les circonstances dans lesquelles les poèmes ont été écrits. On suit sa démarche de création; l’enjeu et le sens des poèmes se précisent sous ce nouvel éclairage.
L’approche critique n’esquive aucune question délicate: comment considérer aujourd’hui les tortionnaires, où a commencé la complicité, dans quelle mesure les ONG portent-elles la responsabilité d’un silence, quel a été le rôle de la France, quel doit être son discours aujourd’hui ?
En lisant l’ensemble du volume, on comprend que la nécessité de parler, d’écrire, ne correspond pas seulement à une mission d’information, ni même à une volonté de réparer un tant soit peu le passé, mais à un besoin impérieux de dénoncer radicalement le non-sens des conduites humaines qui se perpétue encore aujourd’hui dans un monde toujours plus à feu et à sang.
La portée du texte n’est donc pas exclusivement historique, mais elle interpelle l’être humain, dans sa nature et aussi dans ses convictions religieuses: car les Hutu, chrétiens assidus à l’Église, n’en ont pas moins accompli le travail que d’aucuns leur prescrivaient en massacrant leurs frères. Cette inconséquence sidérante, et si fréquente dans l’histoire, ne peut qu’exciter les poètes, les écrivains, à rechercher les effets d’un discours littéraire qui réveille les consciences et la compréhension par l’inattendu de cris personnels, originaux, à la fois stridents et doux.
Jacqueline Wosinski prolonge sa réflexion historique, politique, spirituelle, par le récit de ses recherches scientifiques, en matière de soins post-traumatiques, qu’elle a menées après avoir vécu cette épreuve destructrice. On perçoit alors toute la dimension inlassablement constructive de sa démarche, dont tous les aspects convergent, au service du vivant.
En lisant son livre, on a le souffle coupé quand on découvre la profondeur douloureuse de l’expérience qu’elle a vécue, mais on est aussi béat d’admiration devant la force, même brisée, qu’elle rafistole et déploie pour honorer sa mission de soignante, de «réparatrice des brèches», selon l’expression d’Ésaïe qui est un de ses repères. On s’ahurit aussi de la maîtrise de son expression qui dit intensément l’indicible.
Au fil du recueil, elle nous confie quelques mots, dans la langue du Rwanda, le Kinyarwanda, et quelques repères géographiques qui nous introduisent dans l’espace d’une nouvelle fraternité.
Illustration: la forêt de Gishwali au nord-ouest du Rwanda (photo Andr96, CC BY-SA 4.0).
(1) Se référer aux propos d’Alain Gautier, co-fondateur du Collectif des parties civiles pour le Rwanda, rapportés dans le podcast de Radio France signé par Béatrice Dugué, Génocide au Rwanda : le non-lieu prononcé en faveur d’Agathe Habyarimana suscite l’indignation des parties civiles, 22 août 2025.
(2) Se référer par exemple au podcast de France Culture, Polar et histoire avec les écrivains Michel Bussi et Michel Jean, dans Les Midis de Culture avec Élise Lépine (14 août 2025), et aussi à l’article de Valentin Etancelin, Avec Les ombres du monde, Michel Bussi met la France face à ses contradictions au Rwanda, Huffpost, 14 août 2025.
(3) Jacqueline Wosinski, Sous l’arche d’Eucalyptus, poèmes, suivi de Chemin à travers le non-sens, essai, Marseille, éditions Jas sauvages, 80 pages, 17€.
(4) Fiodor Dostoïevski, Les Frères Karamazov I, Le Livre de Poche, 1972, p.404.
(5) Dans la langue rwandaise, le kinyarwanda, rugo signifie maison.
(6) 2 Corinthiens 2, 5.





