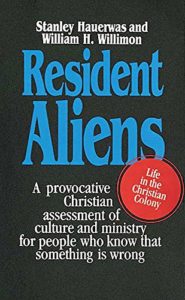Des lumières aux lucioles
Invité à parler des Lumières lors du festival des Chemins de Tolérance en Cévennes, Jean-Pierre Rive a préféré s’inspirer de leur « geste subversif » plutôt que de leur pensée pour brosser un tableau de notre situation vue sous 3 angles : Ouvrir les yeux sur notre présent et ses racines, Éviter l’évitement dont font preuve les « dirigeants de notre monde » face à la réalité, voir les Nouveaux (re)commencements à l’œuvre un peu partout, « pistes fécondes » pour partager « des décroissances choisies » plutôt qu’une « régression subie, chaotique, fratricide et catastrophique ».
Les Lumières avaient aussi leur zone d’ombre, leur part d’obscurité ; sans renier loin de là tout ce que nous leur devons, je me demande si, dans l’état de crise qui est le nôtre, le plus grand service, la plus belle manière de les honorer ne serait pas de les oublier ; ou plutôt, sans les oublier, oublier les contenus de leur travaux marqués par un contexte culturel, social, économique et politique qui n’a plus rien à voir avec le nôtre, et par contre ne pas oublier leur geste subversif fondamental qui, dans une période incertaine, a permis à des société moribondes de revivre, de rechercher du sens, de redonner de l’espérance au cœur des désarrois ou des aveuglements qui les environnaient. En un mot, renouveler complètement les imaginaires, comme le souligne Serge Latouche (1) lorsqu’il nous interpelle pour que nous changions de paradigmes, de logiciel, bien que le mot me déplaise car il appartient à cette société numérique qui, de mon point de vue, apporte plus de malheurs que de bienfaits (et je m’aperçois que je commence déjà à citer alors qu’au nom même de l’impérieuse nécessité d’inventer, de recommencer, de créer, je m’étais promis d’économiser au maximum les citations… mais, comme le disait Rousseau, « j’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés » (2)). Alors comment juger ce présent qui, à force de sombrer dans un productivisme et un consumérisme sans mesure, nous plonge les uns dans l’immédiateté d’une jouissance sans lendemain, les autres dans une déréliction infernale et parfois macabre ? Comment juger cet hybris (3), cette démesure qui entraîne l’humanité vers un destin incontrôlé et maintenant semble-t-il incontrôlable et inéluctable : les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes ! On y reviendra.
Je vous propose un exposé en trois points.
Tout d’abord, il s’agira d’ouvrir les yeux lucidement, sans aveuglement, sans préjugé, sur le présent et ses racines.
Ensuite, nous évoquerons les stratégies d’évitement, de camouflage que la plupart des dirigeants de notre monde, y compris en France, adoptent en face de la situation réelle.
Et puis, avant de conclure, nous ferons un examen des commencements, des recommencements qui s’inaugurent de ci de là, de telle sorte que surgisse un monde qui, dépassant le catastrophisme éclairé cher à Jean-Pierre Dupuy (4), puisse s’offrir à nous si nous le voulons bien : un monde sinon paradisiaque (parce que nous ne nous laisserons plus duper par des messianismes douteux), du moins plus acceptable, acceptable pour que la vie sur notre terre et en particulier celle des hommes et des femmes qui nous succèderont soit préservée et qu’ils trouvent ainsi une raison de vivre dans une justice sociale, économique, et politique, qui sera par ailleurs le corollaire d’un juste usage des biens communs qui nous ont été légués et dont il nous faudra bien prendre soin.
1. Ouvrir les yeux
Alors, où en sommes-nous ? Quel est cet hybris qui nous tient aux entrailles, et où nous a-t-il conduit ?
Je fais l’hypothèse que chacun de nous, chacune de nos sociétés, sommes traversés par deux sentiments qui, selon les circonstances dans le temps et selon les territoires, se disputent voire s’opposent : je veux dire la peur et la compassion. Et pour ma part (mais c’est là un acte de foi très personnel), je pense que la compassion l’emporte et l’emportera mais que la peur toujours présente est souvent le ressort secret de bien des comportements, qu’ils soient individuels ou collectifs. Et c’est cette peur qui engendre l’hybris, la démesure, car il faut bien, pour vivre en sécurité, juguler la peur.
En étant un peu caricatural, je dirais en regardant vers le passé que nous nous sommes dotés il y a bien des lustres d’idoles bien commodes, de puissances surnaturelles avec qui il s’agissait de négocier pour dominer le sentiment d’insécurité qui nous collait à la peau : c’est là le socle de toutes les religions antiques. Puis est venu dans certaines contrées le temps du monothéisme. Il était plus simple d’avoir un seul interlocuteur car les états d’âmes des dieux multiples pouvaient parfois être contradictoires, difficiles à gérer, même si l’un d’entre eux, Zeus ou Jupiter, était sensé les surpasser.
Est donc venu le temps du monothéisme et finalement c’est à un seul Dieu, progressivement doté de toutes les vertus de la toute puissance, qu’a été confié le soin de rassurer. Mais il demeurait cette douloureuse écharde qu’était le sentiment de dépendance à l’égard d’une altérité incontrôlable : il fallait ramener Dieu sur terre, le maîtriser et pourquoi pas le dissoudre dans la volonté autonome des créatures que nous sommes. N’était-ce pas là la réalisation de l’antique prophétie écrite il y a trois mille ans : « Vous serez comme des Dieux » (5) que susurra le serpent à l’oreille d’Ève et d’Adam ? « Il fallait régner et ne plus être le valet des dieux », reprit à son compte Friedrich Nietzsche.
La Réforme Protestante, en inventant l’individu, sujet responsable n’ayant plus rien à négocier avec un dieu miséricordieux, octroyant sans condition une grâce salvatrice, fournit alors à ses héritiers la possibilité de se reconstruire un monde offert à une liberté délivrée de ses chaînes et de devenir maître et possesseur de cette création ainsi que le proposa René Descartes . On n’avait donc plus besoin de la religion pour se sentir en sécurité, seules les réussites économiques sociales et même politiques permettaient de se sentir à l’aise dans un monde qu’il s’agissait maintenant de dominer.
Cette autonomie conquise, alliée à la sobriété calviniste, allait donner naissance à l’esprit du capitalisme. C’est la thèse de Max Weber, qui demeure encore aujourd’hui l’idéologie régnante dont nous commençons à considérer enfin les effets néfastes. Car avec l’effacement progressif de cette austérité, de cette simplicité, de cette mesure calviniste, à l’esprit d’entreprise créateur de biens communs pour le bien de tous s’est substitué un égoïsme démesuré mettant en exergue la réussite individuelle, fût-elle au détriment du plus grand nombre. Cette démesure est devenue d’autant plus radicale qu’on la voit aujourd’hui s’appuyer sur ces théologies évangéliques hérétiques dites de la prospérité qui, reprenant de manière perverse l’héritage calviniste de l’homme responsable, entrepreneur de bien commun, le dénaturent en justifiant les comportements les plus oppressifs de ceux qui, dans leur délire de toute puissance, veulent faire passer leurs réussites pulsionnelles pour un signe de la bénédiction de Dieu (au passage, rappelons à quel point les entourages de Messieurs Trump et Bolsonaro relèvent de ce milieu).
Désormais, au Dieu tout puissant obsolète s’est substituée la volonté de puissance. L’humanité n’a plus peur des dieux mais, aujourd’hui, elle a peur d’elle-même. Alors qu’elle était en fin de compte solidaire face à des forces mystérieuses qui lui échappaient, elle se divise et se déchire sans mesure maintenant que l’homme redevient un loup pour l’homme tandis que tous les contrats qu’elle avait élaboré avec persévérance pour pacifier les peurs semblent désormais caducs quand ils ne sont pas jugés nuisibles.
Alors oui, nous allons vers le chaos, vers la catastrophe ; nous y sommes d’ailleurs déjà probablement puisque nous allons manquer d’eau potable, d’air pur, de terres fertiles. J’hésite à énumérer ici ce qui se profile à l’horizon, et ce qui est déjà en marche : jour après jour, les journaux et les experts publient articles et études alarmantes.
Hormis les généralités que sont la définition de l’anthropocène (cette nouvelle ère où l’homme détruit son propre espace) ou cette nouvelle science de la collapsologie (qui essaie de prévoir comment tout va petit à petit ou brutalement s’effondrer), il y a des faits concrets qui, suite au réchauffement climatique, sont désormais reconnus. Aux dernières nouvelles par exemple, le permafrost, ces terres gelées en profondeur aux abords du Cercle Arctique, est en train de dégeler 50 ans avant ce qui était prévu. Si bien que du méthane, du CO2, des méga-virus vont se répandre et sortir de leur hibernation … et que c’est à 4° de plus que nous devons nous attendre d’ici à la fin du siècle. Aussi ne peut-on pas accorder une seconde d’intérêt aux propos des climato-sceptiques.
Mais le plus grave, c’est que cette catastrophe qui se profile intervient dans un monde de plus en plus inégalitaire. La cupidité, la démesure des richesses de nos sociétés gagnées par la mondialisation économique et financière se fait sur le dos d’une population pauvre et dominée qui n’est pour rien dans la crise qui s’impose à nous et que nous subissons. Ce sont les riches qui détruisent la planète (pour reprendre le titre d’un livre d’Hervé Kempf (6)). Les riches, ce sont bien-sûr les 1 % qui possèdent 80 % des richesses et qui exploitent les peuples.
Mais c’est aussi vous et moi qui utilisons des smartphones friands en terres rares, extraits par des enfants de 8 ans qui descendent dans des mines étroites sans protection où la mortalité est importante. C’est vous et moi qui prenons l’avion ou le bateau pour des voyages touristiques organisés et préfabriqués. C’est vous et moi, citoyens d’un pays qui, par ses ventes d’armes, soutient des tyrans qui assassinent et torturent sans honte. C’est vous et moi lorsque nous prenons possession à 8 heures du matin d’un bureau qui a été nettoyé dès 6 heures du matin par une dame malienne après une heure de transport en RER, sans papiers, qui a quitté un pays où les cultures vivrières ont été détruites pour que du soja ou du maïs vienne nourrir des animaux martyrisés dans des méga-élevages pour satisfaire notre consommation en viande. C’est vous et moi lorsqu’une entreprise abandonne en Afrique une mine d’uranium qui a alimenté nos centrales nucléaires et laisse le soin à une population désemparée, sans moyens et sans défense, d’en gérer les déchets. C’est vous et moi qui bénéficions d’une croissance qui s’est appuyée depuis des décennies, sinon des siècles (voir le rôle de la traite négrière dans la production et la diffusion du sucre) sur la domination de peuples, leur mise en esclavage et l’exploitation irresponsable d’une nature complexe et vulnérable.
Alors ne croyez pas que je veuille nous culpabiliser. Il ne s’agit pas de nous paralyser dans un constat sans issue mais plutôt de nous sentir désormais responsables, maintenant que nous avons les yeux ouverts, maintenant que nous ne sommes plus aveuglés par cette religion de substitution que fut la croyance au progrès sans discontinuité et sans limites. Il nous appartient, dans cette liberté durement acquise, de résister au pire, de vouloir le meilleur et de le construire. Nous ne pourrons plus dire comme certains au lendemain de la découverte de l’horreur de la Shoah que « nous ne savions pas ». J’espère que nos enfants, nos petits-enfants, n’auront pas honte de nous lorsqu’ils apprendront que nous savions tout cela, y compris que des hommes et des femmes, des enfants, à la recherche d’un lieu sûr pour vivre, ont été rejetés à la mer par milliers et sont venus mourir sur nos plages polluées par nos crèmes bronzantes (en septembre 2019, on comptait 900 morts en Méditerranée depuis janvier).
J’espère qu’il ne s’écrira pas un livre un de ces jours dont le titre pourrait être Ils savaient, ils n’ont rien fait, un point c’est tout (cf. le livre dePatrick Cabanel (7)) …
2. Éviter l’évitement
Bien-sûr, certains sont encore dans le déni et s’imaginent que de nouvelles technologies, numériques en particulier, vont nous sauver. On pourrait d’ailleurs se demander si ces technologies numériques ne portent pas en elles-mêmes une malédiction : celle du calcul binaire où 0 et 1 sont les seules alternatives à la complexité du réel. Réduire le réel à ce dualisme appauvrissant, n’est-ce pas par excellence une opération de déshumanisation qui, en voulant maîtriser notre monde par une simplification abusive, l’assassine ?
D’autres pensent que l’on pourra même découvrir dans l’espace céleste des lieux habitables, en tout cas par une minorité privilégiée pendant que tous les autres succomberont dans les décharges et les poubelles d’une histoire achevée.
D’autres pensent survivre dans des cités artificielles bunkerisées où l’oxygène sera produit par de nouveaux esclaves permettant à ces quelques détenteurs de richesses de sauver leurs pauvres vies. Des hommes augmentés ou des robots humanoïdes continueront leur danse macabre comme un thé dansant sur un Titanic en perdition. Et puis, il y aura l’immense cohorte des résignés qui, ne voulant pas entendre les bruits de bottes contre lesquels il faut lutter, s’assoupiront dans le silence mortel des pantoufles que l’on ne veut pas quitter.
Il est de plus en plus évident que ces tentatives d’évitement de la réalité n’ont pas d’avenir et qu’il nous faut maintenant faire le deuil d’un monde au bord de l’abîme (cf. Requiem pour l’espèce humaine de David Hamilton (8)). Il nous faut maintenant imaginer un monde nouveau.
3. De nouveaux (re)commencements
La fin d’un monde n’est pas la fin du monde, saint Augustin le rappelait déjà en apprenant le sac de Rome par ceux que l’on appelait alors les Barbares. C’est à ce prix que nous pourrons à nouveau espérer reconstruire. C’est à ce prix que nous pourrons échapper ou du moins contrecarrer ces monstres prêts à surgir lorsqu’un monde ancien disparaît et que le nouveau tarde à survenir, comme l’avait souligné Antonio Gramcsi.
Je voudrais essayer de synthétiser quelques pistes fécondes pour l’avenir et commencer par évoquer ce que l’on appelle les leçons du passé. En temps de crise, par définition, l’histoire ne peut être une répétition, mais le moment de choix décisifs, inaugurateurs, créateurs. Les théologiens diraient qu’il s’agit de discerner le kaïros, le moment opportun, l’instant propice à l’irruption de comportements nouveaux qui, d’ailleurs, n’ont rien à voir avec la course à l’innovation incessante que nos économies mercantiles déploient et qui, dans leur prétention à promettre des solutions salutaires, ne sont que la répétition du même avec les déboires conséquents que l’on connaît déjà.
Hannah Arendt, reprenant Tocqueville, dit qu’en temps de crise, le passé ne peut éclairer le présent parce que l’esprit erre dans l’obscurité. « À certains moments, (et je cite Eva Illouz, une intellectuelle israélienne), vouloir illuminer le présent par le passé revient à chercher un objet perdu sous un lampadaire parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière. » Qui peut le mieux analyser une crise, demande-t-elle, « ceux dont les normes sont anciennes ou ceux dont l’esprit est libre de tout préjugé » (9) ?
Aussi, malgré la tentation qui peut être la nôtre de déceler dans le passé quelques similitudes avec notre présent (je pense en particulier à ceux qui évoquent, comme je l’ai fait d’ailleurs en citant saint Augustin, la fin de l’Empire romain ou ceux qui comparent notre début du 21e siècle avec les années 30 du précédent, la montée du fascisme et du nazisme), il nous faut être libres de tout préjugé. Si nous voulons dans ce temps de rupture assumer et non pas subir les contraintes qui nous inquiètent, il ne faut pas nous laisser aveugler par un passé qui de toutes façons ne se répétera pas, puisque ce qui vient sera par définition différent. Il nous faut laisser de côté la sentence du philosophe Hegel qui évoque l’envol du soir de la chouette de Minerve, symbolisant la sagesse philosophique qui arrive toujours trop tard pour éclairer le jugement. Hannah Arendt, toujours, elle, nous a dit que c’est au cœur même de la journée que le jugement peut nous aider à comprendre la particularité de notre situation et que c’est là le seul moyen d’en assumer toute la responsabilité.
Et bien, nous sommes en plein cœur de cette journée ! Une journée bien remplie d’événements insaisissables. Par exemple, pour n’en citer que quelques uns, le phénomène Trump (qui déstabilise tous les codes qui nous étaient familiers) et puis bien entendu cette crise écologique qui elle aussi met à bas toutes les certitudes qui étaient les nôtres depuis quelques siècles. Sans parler de cette opinion de plus en plus commune, indécente, qui nous conduit à faire de notre sol un territoire signalé par le panneau « Défense d’entrer ».
Alors dans ce temps, si nous voulons être responsables sans être enchaînés à un destin inéluctable, j’ai envie d’en appeler à un autre grand penseur du 20e siècle, Levi-Strauss, qui faisait la distinction entre la mentalité de l’ingénieur (qui agit avec un projet préétabli, cherche les outils nécessaires et les matériaux utiles à ce qu’il veut réaliser, et veut extraire de l’environnement dont il dispose ce qui va lui servir sans évaluer ni maîtriser les conséquences) et celle du bricoleur qui, avec les moyens du bord, les objets qu’il a conservés parce que ça peut toujours servir, arrange au mieux ce qu’il a sous la main, à sa portée.
Paradoxalement, le monde de l’ingénieur est un monde clos parce que l’ingénieur est prisonnier de ce qu’il cherche. Le monde du bricoleur est lui constamment ouvert parce que le bricoleur est attentif et s’attarde sur ce qu’il trouve.
C’est très certainement ce qui est en train de nous arriver et ce à quoi il nous faut nous attacher puisque, saturés d’objets qui nous étouffent, de productions savantes qui obscurcissent notre entendement, de pouvoirs normatifs qui nous paralysent, il ne peut plus être question de prolonger cette fuite en avant. Il nous faut mettre un terme aux accélérations intempestives et sans but, il nous faut arrêter de produire, de rechercher des ressources nouvelles. Il nous faut, avec les moyens du bord, réarranger un monde nouveau, durable, équitable et acceptable pour tous. C’est d’ailleurs à un moratoire de tous les grands projets d’aménagement qu’il nous faut peut-être dès maintenant nous attacher.
Il nous faut mettre en œuvre sans délai, dans la justice, non pas cette nouvelle croissance envisagée par les ingénieurs du numérique et de l’algorithme dans l’illusion d’un ruissellement profitable à tous, mais un partage de ce qui est à notre disposition, ce qui, bien entendu, peut engendrer une décroissance des uns pour que d’autres vivent et survivent.
Cette décroissance, je vous propose d’en examiner quelques traits sous l’angle de trois réalités, trois mots : l’Avoir, le Pouvoir, le Savoir. Trois réalités autour desquelles peut se jouer notre avenir proche, des décroissances choisies pour nous épargner, s’il est encore temps, une régression subie, chaotique, fratricide et catastrophique.
Ne plus se focaliser sur l’avoir
Tout d’abord l’avoir, la possession, la production, la consommation, l’argent … Il est clair qu’il nous faut cesser de produire des biens dont l’obsolescence programmée engendre, on l’a déjà dit, des déchets qui font de certains peuples les poubelles de notre civilisation (sans omettre les océans et certaines contrées déjà très contaminées), d’autant plus que cette production intensive est un mépris de l’œuvre de l’homme, qu’il soit ouvrier, employé ou paysan, et qu’elle est aussi un mépris du produit de son travail, qu’il soit industriel ou agricole.
Il nous faut juguler par ailleurs drastiquement l’accentuation des écarts de revenus qui vont faire exploser toute cohésion sociale et engendrer des violences, des guerres civiles sanglantes. Gaël Giraud (prêtre jésuite, économiste en chef de l’Agence Française de Développement, bête noire des inspecteurs des finances de Bercy) a publié il y a quelques années une étude très argumentée dans laquelle il proposait que l’écart maximum de revenus nets soit de 1 à 12 (10), ce qui est évidemment très loin de la situation actuelle. Au-delà du calcul économique, c’est une référence symbolique forte : personne ne doit disposer en un mois de ce que quelqu’un ne peut obtenir qu’en un an.
Il nous faut limiter et peut-être abolir la propriété des moyens de production, favoriser les entreprises coopératives, les sociétés mutualistes et reprendre à notre compte les vues pertinentes et prophétiques de l’École de Nîmes (11) et de son animateur Charles Gide (l’oncle d’André).
Il nous faut, par une fiscalité complètement renouvelée et progressive (et ici on ne peut que regretter la pusillanimité de nos gouvernants en la matière), redonner, à l’encontre de la libéralisation et de la privatisation de l’économie, des moyens aux collectivités publiques, seules garantes d’une juste redistribution et d’une meilleure réponse aux besoins sociaux comme le soin, l’éducation, la culture, l’habitat …
Il nous faut réviser nos politiques monétaires qui, depuis la fin des accords de Bretton Woods et de la convertibilité du dollar en or prononcée par Nixon en 1971 (conséquence du financement de la guerre du Vietnam), ont provoqué une explosion de la masse monétaire internationale. L’économie mondiale est devenue une économie hors sol, soumise aux crises successives provoquées par des bulles financières irrationnelles qui peuvent imploser à tout moment, cette masse monétaire (qui représente environ 50 fois la réalité des biens échangés ou services rendus) étant constituée de dettes privées ou publiques tôt ou tard insolvables, assorties de taux d’intérêt qui, même faibles, condamnent à une fuite en avant dans une croissance ininterrompue destinée à la rembourser. Et on sait à quelles impasses cela nous mène. Nous pouvons mettre ici à profit les analyses de David Graeber, l’un des animateurs du mouvement Occupy Wall Street qui, dans son livre magistral sur l’histoire de la dette, propose un jubilé aux accents deutéronomiques, une annulation de toutes dettes comme outil de résilience en face de ce qui nous menace (12).
Nous devons confier nos échanges de biens et de services à des monnaies alternatives insérées, enchâssées dans des territoires en cohérence économique, énergétique, sociale, culturelle et géographique. Il nous faut donc retrouver la proximité des échanges, favoriser les circuits courts de consommation et de production. Pour ce faire, un peu de protectionnisme est nécessaire, protectionnisme qui, contrairement à ce que disent ceux qui le décrient, est une attention plus grande donnée à ce qui nous est proche, loin du surf superficiel des circuits mondialisés. Il y a plus de richesse dans l’ouverture à ce qui est à ma porte que dans la conquête des grands espaces.
S’il faut faciliter la circulation des personnes, il faut limiter la circulation des biens. Il faut redonner de la consistance à la souveraineté du local, tant sur le plan alimentaire que sur le plan énergétique.
Limiter le pouvoir
Après l’avoir, les biens et la propriété, il nous faut changer le cours des choses en ce qui concerne l’exercice du pouvoir. « Gouverner, c’est prévoir », a-t-on dit. On devrait dire plus pertinemment : « Gouverner, c’est servir ».
Nos états-nations et nos grandes institutions internationales ne sont plus le lieu de justes décisions mais le lieu où, loin de l’intérêt général, s’affrontent des bellicismes qui se réactivent dangereusement. Einstein disait à ce propos, peu avant sa mort et alors qu’il voyait s’installer la Guerre froide, que s’il ignorait quelles seraient les armes employées pour la 3e Guerre mondiale (nucléaires, bactériologiques, chimiques ou électroniques), il savait avec certitude que celles de la 4e seraient des lance-pierres et des gourdins, car tout le reste aurait été détruit … Ceux qui caricaturent le combat écologique en l’assimilant à un retour à la bougie méconnaissent qu’ils nous condamnent eux-mêmes à ce retour qui, de plus, ne serait pas choisi, mais subi.
La France dispose, dans ce contexte, d’une richesse qui fut longtemps considérée comme un handicap : ce sont ses 36 000 communes, héritières de territoires à taille humaine. Alors que la classe politique est décriée et que le tous pourris fait le lit de populismes nauséabonds, redonner aux communes, par une décentralisation renforcée, des compétences et des moyens (fussent-elles regroupées à leur gré en réseau et non pas soumises à un état impérial atteint lui aussi par la démesure intrusive de la toute puissance) est une garantie de démocratie et donc une percée vers une société plus acceptable pour tous et par tous. On ne peut que regretter à ce propos la suppression par nos gouvernants de la taxe d’habitation et sa compensation (promise) par une dotation d’État qui, au-delà de la péripétie politicienne, relève d’un passéisme notoire. Quelles que soient les adaptations nécessaires, la taxe d’habitation était l’une des ressources que pouvait maîtriser cette collectivité publique plus proche de sa population que les ministères centralisés et jacobins.
La commune devrait pouvoir redevenir ce lieu où, loin des écrans et des dossiers numérisés, l’administré peut redevenir un citoyen écouté, compris, épargné par les incivilités des grandes administrations ignorantes des réalités humaines. Des incivilités qui, en retour, provoquent des réactions agressives et violentes, nuisibles à un vivre ensemble apaisé. Par ailleurs, on le sait, le maire est la dernière fonction politique à jouir encore d’une certaine confiance, une confiance certainement enracinée dans sa longue histoire, incarnant symboliquement l’unité d’une communauté. Cette fonction, il faut non seulement la sauvegarder mais la promouvoir. N’incarne-t-elle pas d’ailleurs aujourd’hui la résistance (l’actualité le montre) face aux aveuglements meurtriers d’une société dominée par les intérêts de grands groupes industriels et chimiques qui polluent les territoires ?
Bien entendu, comme pour toutes les fonctions politiques, il faut revoir les modalités de désignation. L’élection ne peut plus être le seul critère. À l’élection, marquée par bien des abus (que ce soit l’investiture partisane, la surenchère démagogique flattée par des clivages médiatiques surdéterminés par la nécessité de créer un audimat rémunérateur, les soutiens financiers opaques …), il faudrait au moins adjoindre, sinon substituer, des modalités de tirage au sort bien attestées dans l’histoire des institutions publiques.
Il faut en tout cas déprofessionnaliser le mandat politique. Tout citoyen doit pouvoir, à un moment de sa vie, contribuer à la gouvernance d’une collectivité publique. N’est-ce-pas là d’ailleurs une des revendications des Gilets jaunes ?
Pour ce faire, il faut être rigoureux. La première marche, ce sont les exigences en matière de non-cumul et de durée d’exercice des mandats, assorties bien-sûr de garanties solides de retour à l’emploi lorsqu’ils arrivent à leur terme. C’est à ce prix que la confiance sera restaurée et que l’on mettra fin aux privilèges indus d’une caste qui, comme au temps des rois, se reproduit de manière étroite. Le débat est ouvert, il faut y participer et le faire aboutir.
Diversifier le savoir
Un troisième et dernier point concerne la construction du savoir, lui aussi habité par l’hybris auquel l’avoir et le pouvoir ont succombé. Le small is beautiful d’Ernst Friedrich Schumacher (13) s’applique aussi à ce champ de révisions nécessaires.
En contrepoint aux grandes synthèses théoriques qui peuplent le champ du savoir depuis que la révolution industrielle a accéléré la mathématisation du réel, il faut réactiver les savoirs traditionnels et locaux en voie de disparition (de manière tout à fait homothétique à la disparition de la diversité du vivant). Savoir que des peuples ont conservé, en particulier l’Afrique non urbaine à laquelle Serge Latouche a consacré une étude extrêmement riche. Et plutôt que de me livrer à un développement théorique, je voudrais ici livrer trois anecdotes significatives.
La première m’a été rapportée par une pédopsychiatre européenne travaillant en Afrique. Elle participait à un symposium de médecins africains et occidentaux où il s’agissait de vérifier des phénomènes de télépathie entre une mère et son enfant dans des situations émotionnelles variables. La mère passant d’un état de joie intense à des moments d’abattement sévère, des protocoles d’expérimentation très affinés permettaient de vérifier l’état émotionnel de l’enfant de plus en plus éloigné de sa mère, d’abord dans la pièce à côté, finalement à plusieurs kilomètres. Après de nombreux essais, on avait constaté que la communication se maintenait quelle que soit la distance : une causalité inconnue était à l’œuvre, qui laissait bien entendu perplexes les médecins européens mais ne surprenait en aucune manière les médecins africains puisque, tout imprégnés qu’ils étaient de la science médicale, ils n’avaient pas oblitéré les savoirs ancestraux de leur champ de travail.
Une amie congolaise inspectrice d’académie réfugiée politique en France m’a reproché, lors d’une émission à France Culture à laquelle il m’arrivait de participer autrefois, d’avoir balayé d’un revers de manche (dans mon protestantisme quelque peu rationalisant) le témoignage de personnes pensant souffrir d’envoûtement, de sortilèges divers qui empoisonnaient leur vie.
Au cours d’un repas à Valleraugue avec un chercheur africain attaché au Museum d’Histoire Naturelle, il m’a glissé soudainement en pleine conversation qu’il avait hérité des dons de sorcier de son grand-oncle.
Tous ces savoirs président à bien des pratiques que notre scientisme objectivant méprise et qu’un rationalisme réducteur ignore. Notre science devrait retrouver l’humilité des balbutiements. Souvenons-nous au passage que Newton était par ailleurs alchimiste et Kepler astrologue. Je ne suis pas spécialement attiré par l’astrologie mais je veux simplement souligner que la connaissance ne peut progresser que si elle laisse de la place au mystère, à l’incertain, au risque, et surtout à l’imaginaire et l’imprévisible. Toutes choses que nos savants séduits par les algorithmes veulent effacer.
Notre science devrait redonner de l’espace à cette culture non académique qui fut longtemps la compagne de bien des peuples que nous avons asservis. Et je pense aussi à ces cultures minoritaires qui ont fait la France et que la IIIe République, avec une certaine arrogance, a voulu extirper des mentalités au prétexte qu’elles ne répondaient pas aux normes du scientisme positiviste qui règne encore aujourd’hui. J’en veux pour preuve les propos récents de notre Premier ministre à l’égard de l’homéopathie, signes d’une culture bien étroite.
Peut-être faudra-t-il réévaluer la distinction trop simpliste entre savoir et croyance. Ne sont-ce pas des soldats français et allemands croyants qui ont su en 1914 célébrer Noël ensemble et arrêter, certes provisoirement, la boucherie des tranchées, résister à l’artificialité des frontières au cœur de l’absurdité des techniques meurtrières et des soi-disant rationalités politiques, industrielles et nationalistes ? N’est-ce pas aujourd’hui l’animisme des Indiens qui inspire la résistance à la folle rationalité économique qui veut construire un aéroport international au Machu Picchu ? Il y a des savoirs emprunts de dogmatisme religieux et des croyances démystificatrices, émancipatrices et libératrices.
Lorsque le rationnel devient déraisonnable, là où le savoir fait dire « On ne peut pas faire autrement » … la croyance, la foi, la confiance renversent des montagnes, suscitent des sursauts inattendus et d’impossibles possibilités qu’aucune raison ne peut envisager. L’humilité du croire se révèle parfois plus efficiente que l’arrogance du savoir.
Pour conclure : sortir de la peur
Je faisais allusion au début de cette intervention aux deux forces antagonistes qui nous habitent : la peur et la compassion. Il est temps de sortir de la peur, cette peur qui, cherchant la sécurité à tout prix, a provoqué notre délire occidental, foyer de toutes les hybris et démesures qui aujourd’hui nous plombent. On pourrait évoquer ces commissions dites de sécurité qui, à force de normes chargées de prévenir tous les risques, ont étouffé la gratuité, la bonne volonté de tous ceux qui (par souci de l’autre) créaient des espaces et des temps d’éducation populaire pour que chacun puisse se remettre sur la route de la dignité. À force de sécurité aujourd’hui, c’est l’insécurité qui s’est répandue. Il est temps de restaurer dans toute sa fécondité la compassion, le soin, le souci de l’autre, le care que mettait en avant Martine Aubry.
Au lieu de construire une société basée sur la peur de l’autre (que ce soit l’immigré, l’étranger, le différent), il est temps de prendre le risque de la rencontre, de l’accueil inconditionnel. L’autre n’est pas un ennemi qui me menace mais l’occasion d’un chemin partagé pour une création commune. Dans sa vulnérabilité, sa fragilité, l’autre est peut-être un ange, un envoyé qui m’appelle à sortir de mes peurs et à vivre. C’est peut-être d’ailleurs ce que les Gilets jaunes ont inconsciemment revendiqué sur leurs ronds-points lorsqu’ils voulaient que les voitures ralentissent dans leurs courses mortelles, lorsqu’ils retrouvaient une proximité, une famille, ont-ils dit, pour produire des solidarités nouvelles, loin de nos désespérants guichets kafkaïens.
Alors que faut-il faire ? Résister au pire et provoquer le meilleur. Les grandes révolutions violentes ont fait long feu, les réformes en mille-feuilles ont prouvé leur stérilité. Il ne reste plus que les initiatives modestes, exemplaires, qui peuvent faire tâche d’huile et construire des réseaux partagés féconds. Nous avons besoin de témoins plus que de pédagogues. De ci de là surgissent des oasis de sobriété joyeuse, de fraternité conviviale, de résistances fertiles, d’insurrections non violentes, de désobéissance pacifique où chacun et chacune peut trouver l’occasion d’imaginer un avenir, l’hospitalité dont il a besoin, et même parfois l’hospitalisation bienveillante lorsque les blessures sont profondes.
On le sait depuis longtemps, notre civilisation est mortelle. Nos empires sont des colosses totalitaires aux pieds d’argile, leur effondrement est en marche mais, comme le disait Luther, même si je savais que le monde doit disparaître demain, aujourd’hui encore je planterais un pommier. Il est temps de retrouver la ferveur des joies simples, se vêtir, se loger, se nourrir, s’éduquer et prendre soin de l’autre.
« Il est temps de vivre comme des frères, si nous ne voulons pas mourir comme des idiots », ajoutait Martin Luther King.
C’est là le socle de tous nos engagements pour aujourd’hui et pour demain. À nous (libres et responsables, sans préjugés), de faire de la catastrophe qui vient une Apocalypse, c’est-à-dire non pas un désastre mais le dévoilement, la révélation (c’est le mot grec) de ce qui, au plus profond de nous, demeure : le désir d’être accueilli et le souci de l’autre.
Ce sont là les « petites lucioles » si chères à Pasolini (14) qui, loin des lumières aveuglantes, nous permettent d’espérer.
Nota : Bien qu’il ne soit jamais cité ici, je veux souligner ma dépendance à l’égard de Jacques Ellul, qui avait « presque tout prévu ».
Conférence donnée le 3 août 2019 à Valleraugue dans le cadre du 5e festival des Chemins de Tolérance autour de la Pensée des Lumières (merci à Alain Bellet, à Anne Bayle et à leurs associations respectives Active et Arpoezi).
Illustration : lucioles à Shimonoseki, Japon (photo CC-Nanamori).
(1) Serge Latouche (1940), économiste, est l’un des théoriciens français de la décroissance.
(2) Citation extraite du deuxième livre de l’Émile où Rousseau rappelle : « Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de toute l’éducation ? ce n’est pas de gagner du temps, c’est d’en perdre. Lecteurs vulgaires, pardonnez-moi mes paradoxes : il en faut faire quand on réfléchit ; et, quoi que vous puissiez dire, j’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés. »
(3) Pour les Grecs de l’Antiquité, l’hybris (ὕϐρις) est la démesure dont font preuve les êtres humains qui ne se satisfont pas de leur sort et dont ils sont punis par les dieux.
(4) Jean-Pierre Dupuy (1941), longtemps enseignant à Stanford et à Polytechnique, est spécialiste des sciences cognitives et de la philosophie des sciences. Il vient de publier La guerre qui ne peut pas avoir lieu. Essai de métaphysique nucléaire.
(5) Genèse 3, 5.
(6) Comment les riches détruisent la planète, Hervé Kempf (Seuil, 2007).
(7) Nous devions le faire, nous l’avons fait, c’est tout. Cévennes, l’histoire d’une terre de refuge, 1940-1944, Patrick Cabanel (Alcide, 2018).
(8) Aux Presses de Sciences Po (2013), traduction de Requiem For A Species: Why We Resist The Truth About Climate Change publié en 2010 par l’universitaire australien Clive Hamilton (1953), spécialiste de l’éthique.
(9) « Vouloir comprendre le présent à l’aune du passé, c’est éluder la responsabilité qui nous incombe », tribune d’Eva Illouz, Le Monde , 17 juillet 2019.
(10) Lire ici son intervention en 2012, résumant le livre Facteur 12 : pourquoi il faut plafonner les revenus, écrit avec Cécile Renouard.
(11) Sur Charles Gide et l’École de Nîmes, lire (ou regarder) l’intervention de Frédéric Rognon à la 6e convention du Forum protestant : La solidarité selon Charles Gide.
(12) David Graeber (1961), activiste et anthropologue américain, auteur en 2011 de Debt: the First Five Thousand Years (Dette : 5000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent, 2013).
(13) Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977), économiste germano-britannique, auteur en 1973 de l’ouvrage de renommée mondiale Small is Beautiful – Economics as if People Mattered (Small is beautiful. Une société à la mesure de l’homme, Seuil, 1979).
(14) cf. La disparition des lucioles dans les Écrits Corsaires de Pier Paolo Pasolini, 1975.