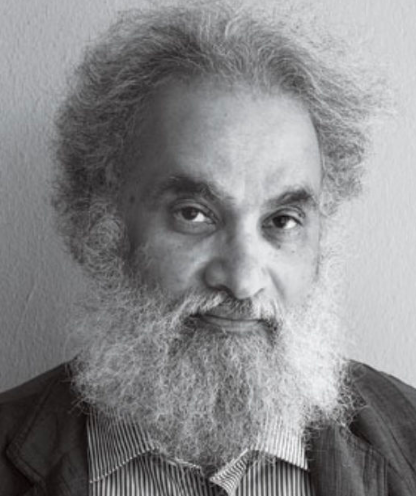Pour en finir avec le revenu universel
«Il est temps de sortir du piège du revenu universel, qui en dit long sur le niveau de réflexion actuel sur la redistribution de la richesse notamment à gauche. La crise actuelle appelle des mesures rapides et fortes, pas des spéculations sans fin sur de l’argent magique. Il faut que les partisans du revenu universel qui œuvrent sincèrement pour le progrès social comprennent que s’il est universel, c’est un revenu pour les riches. Le débat devrait porter sur le montant du minimum pour les plus modestes et sur la manière dont on redistribue la richesse dans la société, pour que chacun puisse vivre mieux et que soient offerts à tous des services publics modernes de qualité.»
Pour le directeur de l’Observatoire des inégalités Louis Maurin, «notre pays a vraiment mieux à faire» que perdre son temps à discuter du revenu universel ou de base «qui pollue le débat des idées depuis plusieurs décennies». Et qui repose sur une confusion: «La plupart des citoyens qui se disent favorables à ce concept pensent défendre un revenu minimum pour ceux qui manquent d’argent, alors que la proposition consiste à verser un revenu universel, donc à tout le monde. Donner de l’argent aux riches comme aux pauvres, sans distinction». Si c’est un revenu versé à tout le monde, «jamais l’État ne sera en capacité» de le financer. Et ce serait «une hérésie, d’autant que l’argent serait distribué à tout le monde et non à ceux qui en ont le plus besoin. L’urgence de notre société est de moderniser les services collectifs, de la santé à l’école, en passant par la police ou la justice, de financer la transition écologique, pas d’aligner des chèques chaque mois pour tout le monde sans distinction». Si ce «mirage» fascine les «jeunes diplômés» parce qu’ils «souffrent des conditions de travail actuelles et cherchent à tout prix une porte de sortie», il s’agit d’un piège «qui peut se refermer sur eux à la première occasion. C’est contre l’exploitation, la précarité, pour une juste rémunération et des conditions de travail dignes qu’il faut se battre, pas pour dépendre d’une aumône de la collectivité. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu’une fois que chacun sera doté de son revenu universel et que l’on aura alors collectivisé plus du tiers des revenus, les entreprises pourront offrir des salaires encore plus faibles». Or «la véritable urgence est de débattre du niveau de vie minimum que la société compte proposer aux plus pauvres». Si l’on garantissait un «un revenu minimum unique de 900 euros» aux 5 millions de personnes les plus pauvres, «cela coûterait une quarantaine de milliards d’euros au total soit sept milliards de plus que ce qui est actuellement dépensé. L’ordre de grandeur n’a rien à voir avec le revenu universel».
(2 juin 2020)


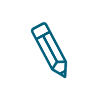 À noter
À noter  À lire
À lire  À consulter
À consulter