
Les Français se disent de moins en moins racistes
«L’élévation du niveau de diplôme et le renouvellement générationnel poussent plutôt à l’ouverture. La dégradation de la situation économique peut en revanche jouer en sens inverse, même si son impact n’est pas simple à mesurer. Le type de majorité politique a aussi un effet que les politologues qualifient de «thermostatique»: on déclare davantage de tolérance quand la droite gouverne et d’intolérance quand c’est le tour de la gauche, comme si les sondés voulaient éviter les excès dans un sens ou dans l’autre.»
Même si un sondage récent a montré qu’une très grande majorité des Français (76%) pensait qu’une «lutte vigoureuse contre le racisme» était nécessaire en France, l’environnement médiatique laisse plutôt penser qu’ils deviennent «de plus en plus racistes ou xénophobes». Or, l’historique des enquêtes va plutôt dans l’autre sens. Ainsi, depuis le début des années 2000, si la proportion de ceux qui pensent qu’il existe des races supérieures est restée à peu près constante («autour de 10%»), ceux qui se reconnaissent «un peu» ou «plutôt raciste», après être restés à 25-30% jusqu’en 2013, a subitement baissé depuis «pour atteindre 18% en 2019». Sur l’autre bord, ceux qui pensent que «toutes les races se valent» sont 56%, ceux qui pensent qu’elles «n’existent pas» ont «plus que doublé entre 2002 et 2019, passant de 16 % à 36 %». Il s’agit bien-sûr d’opinions, mais étant donné qu’il est très difficile d’interpréter les statistiques sur les «actes racistes» (qui ont plutôt tendance à diminuer mais aussi à être sous-déclarés), ces données indiquent en tout cas que «sur longue période, le racisme perd du terrain». Ainsi, l’indice de tolérance mis au point par le sociologue Vincent Tiberj à partir «d’un ensemble de questions autour du racisme ou du rejet de l’autre» oscille autour de 60% depuis le début des années 2000, plus haut que dans les années 1990, avec certes «un durcissement entre 2009 et 2013» mais «une remontée» depuis. Si la manière dont «les événements en tant que tels» sont ««cadrés » par les élites politiques, sociales et médiatiques» influe de fait sur l’opinion, «le plus étonnant est surtout le faible impact des discours de rejet des étrangers alors que la parole xénophobe s’affiche de plus en plus ouvertement».
(10 juillet 2020)


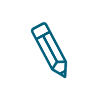 À noter
À noter  À lire
À lire  À consulter
À consulter 



