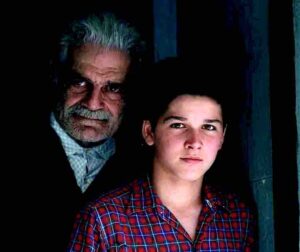Éric-Emmanuel Schmitt (4): « Comment habite-t-on le mystère ? »
«Je refuse tout prétendu savoir de la mort pour conserver à la mort sa dimension de mystère absolu, comme je tiens à maintenir la dimension de mystère de la vie.» Dans ce quatrième et dernier volet de l’entretien de Jean-Luc Gadreau avec Éric Emmanuel Schmitt pour Solaé, l’écrivain dialogue avec le pasteur Jonathan Hanley (qui a longtemps animé un groupe de parole de personnes touchées par le VIH) et Vincent Smetana, appellant à lutter «contre l’illusion de savoir, la fatigue de vivre, la lassitude du sentiment de déjà-vu» puisqu’il y a toujours un Dieu qui «attend derrière la porte».
Émission Solaé, le rendez-vous protestant L’avent avec Éric-Emmanuel Schmitt (4/4), La vie et la mort, du dimanche 22 décembre 2024 sur France Culture. Lire les transcriptions des premier («La foi demande qu’on plonge») deuxième (La littérature comme empathie) et troisième volet («La parabole ne se donne pas comme une vérité mais comme un dynamisme») de cet entretien.
Jean-Luc Gadreau: J’ai le grand bonheur de recevoir à nouveau Éric-Emmanuel Schmitt pour converser en compagnie d’autres invités de thématiques en lien avec son œuvre et la foi chrétienne. Les semaines passées ont été traitées les thématiques de la rencontre avec Dieu, de la tolérance et de l’art de la parabole. Pour ce quatrième et ultime rendez-vous, nous aborderons le thème de la vie et de la mort en compagnie de Jonathan Hanley, pasteur et auteur de plusieurs livres dont le parcours a été marqué par une expérience d’une quinzaine d’années d’engagement auprès des malades du sida avec l’association Signe de Vie-SIDA. Vincent Smetana, également à notre table, aiguillera des pistes possibles de réflexion dans sa chronique Toujours le mot pour dire.
Débutons avec l’exemple de la Nativité: à Bethléem où naît Jésus se joue déjà une sorte de drame où vie et mort se côtoient. Bien avant que Marie ne donne la vie, une mère, Rachel, meurt en donnant naissance à son fils que Jacob appellera Benjamin. Le récit de la nativité de Jésus n’est pas non plus une gentille fable pour enfants, il se déroule dans un lieu chargé d’histoire ou s’opère une nouvelle scène d’horreur, des enfants sont tués, dérobés à leurs mères. La Nativité à Bethléem entremêle ainsi la vie et la mort comme dans le récit de la Passion de Jésus où la vie nouvelle naît dans un contexte de mort. Ces deux moments de l’existence qui s’opposent, qui s’imbriquent l’un avec l’autre sont aussi souvent présents dans vos livres et vos pièces de théâtre, Éric-Emmanuel Schmitt. Comment abordez-vous personnellement ces deux faces d’une même pièce ?
«J’ai changé et me suis mis à habiter le mystère avec confiance»
Éric-Emmanuel Schmitt: Je pense effectivement que vie est mort sont les deux côtés du même tissu. On n’a pas l’un sans l’autre, le cadeau de la vie est le cadeau d’une vie mortelle. Et si on s’imagine l’immortalité – ce que je suis en train de faire dans un cycle romanesque, La Traversée des temps –, il faut bien se rendre compte que la fin de la mort, c’est la fin de la naissance. Dans notre amour pour la vie il faut aussi avoir un amour de la mort. Ce n’est pas du tout macabre. Les anciens nous disaient de penser chaque jour que nous sommes mortels. Pour ma part, je transforme cela en langage moderne (on est devenu un peu chochottes par rapport aux anciens !) en disant: penser chaque jour que nous sommes vivants. C’est exactement la même chose. La saisie de la fragilité de l’existence, de son éphémérité, c’est aussi la saisie de sa richesse, de sa valeur, de son unicité et c’est une façon de la savourer. L’idée que la vie ne dure pas me rend gourmand de la vie. Comme vous, j’ai accompagné des gens dans le sida dans les années 90, quand il n’y avait pas encore la trithérapie, et j’ai découvert auprès d’eux que vivre était un privilège odieux. Je me suis dit qu’il fallait que je finisse par mériter ce privilège, qu’il fallait mériter d’être en vie. J’espère qu’à mon dernier jour j’aurai suffisamment rempli ma vie et puis, peut-être, suffisamment donné pour me dire que ce bout de vie que j’ai eu, je l’ai bien employé. Je suis toujours en train de penser aux vies interrompues d’êtres que j’ai connus ou que j’ai pu aimer. La pensée de la mort n’est pas une chose qui me déprime, au contraire.
Jean-Luc Gadreau: Jonathan, cette idée des deux faces d’une même pièce ou d’un même tissu, qu’en pensez-vous ?
Jonathan Hanley: J’avoue que j’ai du mal ! Les deux m’étonnent, la naissance et la mort, les deux m’émeuvent. Je cherche à en respecter le mystère tout en étant tenté de les apprivoiser. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne tentation à laquelle céder. Souvent j’ai l’impression que nous cherchons à les apprivoiser, ces deux instants, à grand renfort de mots, à grands flots de mots, et quand je me suis retrouvé au chevet de personnes en train de vivre leurs derniers moments de vie, je me suis rendu compte que j’étais devant quelque chose qui restait très, très mystérieux. J’ai appris à respecter le mystère.
Jean-Luc Gadreau: Compliqué, donc…
Éric-Emmanuel Schmitt: Je crois que le mot mystère est la clé d’une façon d’habiter l’existence. Vivre dans le mystère. Je me méfie des gens qui prétendent avoir un savoir de la mort, ceux qui vous disent que la mort, c’est le néant, ou qui affirment que la première porte à droite, c’est le purgatoire, la cinquième à gauche, le paradis et que quand vous descendez les escaliers, c’est l’enfer… De quoi me parle-t-on ? J’ai vraiment l’impression d’un savoir usurpé parce que fondé sur rien. Je refuse tout prétendu savoir de la mort pour conserver à la mort sa dimension de mystère absolu, comme je tiens à maintenir la dimension de mystère de la vie. Mais comment habite-t-on le mystère ? On peut l’habiter avec angoisse, j’ai connu ça. Quand j’étais athée, j’habitais le mystère avec des sueurs qui me réveillaient au milieu de la nuit et quand la foi m’a fondu dessus, j’ai changé et me suis mis à habiter le mystère avec confiance. Ce que je ne comprends pas m’échappe. Ce n’est pas parce que je ne comprends pas qu’il n’y a rien à comprendre, ce n’est pas parce que je ne vois pas le sens que c’est absurde. Je ne vois pas les limites du monde ni les limites de l’expérience humaine, j’aperçois simplement les limites de mon esprit. C’est dans cette humilité qui consiste à dire «Je ne sais pas» et dans cette façon d’habiter le mystère que j’ai trouvé une façon d’avancer.
«Je ne sais rien d’elle mais j’ai confiance»
Jean-Luc Gadreau: Vincent, je me tourne vers vous: vivre ou laisser mourir ?
Vincent Smetana: Écoutez, imaginons que nous soyons transportés dans un lieu non identifié, une sorte d’entre-deux, un entre-vie-et-mort ressemblant au hall d’un grand hôtel, à l’accueil d’une clinique aseptisée – à moins qu’il ne s’agisse d’un asile de fous, je vous laisse choisir. Cet espace indéfini dont l’accueil est assuré par deux anges aux prénoms interchangeables ressemble à s’y méprendre à une salle d’attente qui s’avère être un coma dont l’issue est inconnue ou, pour les plus chanceux, un retour à la vie. Comment est-ce que vous avez imaginé un truc pareil, Éric-Emmanuel Schmitt ?!… Les passants-patients s’insurgent contre le sort qui leur est réservé, essayant de maintenir un vague contrôle sur leur vie ou d’user de leur influence sur l’ascenseur, personnage central rythmant les destinés de chacun, les renvoyant vers le haut ou vers le bas sans tenir compte de leurs qualités humaines, exploits, souffrances et encore moins de leurs doléances.
Nous voici dans ce hall d’hôtel, pris à la gorge dans cet insondable mystère. Peut-on apprivoiser la mort, oui ou non ? À moins qu’il ne s’agisse pour le mieux d’en apprivoiser l’idée comme on apprivoise un renard en lui donnant rendez-vous comme ça, fil à fil, dans la douceur et le ronronnement du compagnonnage d’affection afin que ce mystère devienne ami, devienne possible, devienne chemin.
Mystère, caché dans le dictionnaire entre myrtille et mysticète, mammifère cétacé mangeur de plancton et dépourvu de dents comme la baleine.
Mystère, du latin mysterium, «se dit de ce qui est incompréhensible et caché».
Ou encore Mystère, nom déposé, crème glacée fourrée de meringue et enrobée de praliné…
Voyez comme l’idée de la mort oscille toujours entre vie et trépas, entre farce et terreur, entre fracas et envol… Genre:
«Oui, ce soir de novembre, ton âme se rend, écrit la psychanalyste Catherine Ternynck. C’est l’heure de la chute, blême et grise. Dans le jardin une odeur de feuilles mortes et de mousse décomposée. Les oiseaux restent au sol, pour une raison inconnue ils refusent l’envol. Tu vas seul vers ton trou de terre, tu tombes et tu ne te relèves pas car il te faut pour quitter le monde retrouver l’humus, te rendre au plus bas, au plus humble».
Je ne sais pas… Dans le Phédon, Platon relate le dernier jour de Socrate, condamné à boire la cigüe, qui explique à ses amis peinés de le voir bientôt mourir:
«Est-ce autre chose que la séparation de l’âme avec le corps ?».
Mystère. Et pour le sonder, sans nul doute faut-il avoir «vu beaucoup de villes, d’hommes et de choses», écrit Rilke. Oui, pour s’en approcher il faut
«pouvoir repenser à des rencontres inattendues, à des départs que l’on voyait longtemps approcher, à des jours vécus dont le mystère ne s’est pas encore éclairci, à des maladies d’enfance qui commençaient si singulièrement par tant de profondes souffrances, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d’amour, de cris de femmes hurlant en mal d’enfant, il faut avoir été auprès des mourants, être resté assis auprès des morts dans la chambre avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups» (1).
Peut-être là… peut-être alors là seulement: lorsqu’il devient en nous cent regards, gestes, le mystère du vivant prend corps et sens et l’idée même de vie et de mort trouve sa fluidité, sa souplesse dans la foi, dans la confiance. Car, non, dites-vous, Éric-Emmanuel,
«Je n’ai pas vis-à-vis de la mort un rapport de peur mais de confiance. La mort est un mystère, je ne sais rien d’elle mais j’ai confiance dans le mystère. J’habite ce mystère avec confiance et non avec angoisse. Alors, quoi que ce soit, ce sera pour le mieux, et de là il n’y aura plus qu’une trace de pas ou un trait de plume pour imaginer de ne plus jamais mourir vraiment et ainsi toucher ‘in fine’, peut-être, à la lumière du bonheur».
Non, là vous ne me rassurez pas car cette idée d’hôtel des deux mondes, c’est génial, mais c’est quand même carrément flippant !… Je le redis: merci, car, oui, si je vous suis, faute d’ajouter encore plus de mystère à la vie, faisons au moins en sorte d’ajouter plus de vie à ce mystère.
«Ne méprisez pas la vie sous prétexte qu’elle est courte et qu’elle a une fin»
Jean-Luc Gadreau: Jolie proposition. Merci beaucoup, Vincent. Intéressant cette référence à ce livre et cette pièce de théâtre, Hôtel des deux mondes, avec ces occupants temporairement entre deux mondes, donc, pas encore morts mais dont la vie ne tient plus qu’à un fil. Éric-Emmanuel, n’est-on pas plongé là dans une forme de parabole ? Car vous n’expliquez absolument rien véritablement, vous n’imposez aucune interprétation, notamment sur ce personnage du Docteur S…
Éric-Emmanuel Schmitt: Docteur S, Docteur Schmitt, Docteur Science, Docteur Savoir… On ne sait pas !
Jean-Luc Gadreau: C’est important, justement, cette part de mystère, mystère qui devient possiblement ce que l’on veut y mettre en tant que lecteur ou spectateur.
Éric-Emmanuel Schmitt: Pour moi le mystère est assez pur. Il est profond, mais pur, il est cristallin. On ne sait pas. Et il ne faut pas remplir ce mystère d’un faux savoir, d’un savoir imaginé ou d’un pseudo-savoir scientifique puisque la science nous décrit un état de corps mort mais, s’il y a une âme, elle n’en parle pas. Les 21 grammes, là, on n’en parle pas !… Il faut donc s’en remettre totalement au mystère, accepter. Je me dis toujours que je ne sais pas ce qu’est la mort mais que, de toute façon, ce sera une bonne surprise. Le but de la pièce Hôtel des deux mondes, à travers le personnage principal, Julien Portal (il a un nom de porte puisqu’il est de passage), était de dire: ne méprisez pas la vie sous prétexte qu’elle est courte et qu’elle a une fin. Au contraire, c’est ce qui la rend savoureuse, riche et pleine. Il y a tout de même une maladie contemporaine qui consiste à déprécier la vie…
Jean-Luc Gadreau: C’est ce dont nous parlions avec Béatrice Cléro-Mazire à propos du respect, de la tolérance, ce Royaume à venir qui en fait est à vivre dès aujourd’hui, dès maintenant.
Éric-Emmanuel Schmitt: Voilà. L’éternité de l’instant, de l’affirmation et de l’amour qu’on vit, puis après on verra… Bonne surprise !
«C’est comme si les poissons se plaignaient que l’eau est mouillée»
Jean-Luc Gadreau: Jonathan Hanley, je disais en présentation que vous aviez travaillé pendant une quinzaine d’années auprès de malades du sida. Vincent parlait de ces moments assis auprès de mourants avec la fenêtre ouverte, les bruits qui venaient par à-coups… J’imagine que le rapport à la vie, et nécessairement aussi à la mort, se retrouve aussi transformé dans la confrontation à ces moments-là ?
Jonathan Hanley: Pendant une quinzaine d’années, j’ai eu le privilège d’animer un groupe de parole pour personnes touchées par le VIH et le sida: des malades mais aussi des proches, des accompagnants, des professionnels du domaine… Et j’ai vraiment constaté deux façons d’aborder cette proximité de la mort.
Tout d’abord, certains choisissaient de l’ignorer, de faire comme si elle ne les attendait pas. On occulte, on balaie sous le tapis, on vit comme si la réalité n’allait jamais nous rattraper.
Et puis l’autre approche, ceux qui choisissaient de la courtiser, de la draguer, de la défier.
Mais, pour les deux façons d’aborder la mort, tout passait par le prisme de cette proximité de la mort. Chaque fois que nous avions un groupe de parole (c’était mensuel), nous fixions un thème qui pouvait être l’amitié, les espoirs de demain, la vie professionnelle, l’argent et – le plus touchant pour moi – le désir de parentalité. Toutes ces thématiques étaient abordées en lien avec cette proximité de la mort. Il y avait une structure d’accompagnement du deuil pour les personnes qui avaient perdu un proche du sida appelée Nous sommes éternels, dont j’ai fait partie pendant un certain temps. Le nom de cette association m’avait beaucoup touché car, qu’on soit d’accord ou non avec cette affirmation n’était pas la question, ce qui m’intéressait est qu’il y avait cette espérance, cette idée que nous ne sommes pas faits pour nos quelques décennies sur Terre. Et là je fais référence à l’auteur, romancier, théologien et professeur de lettres classiques C.S. Lewis qui (dans un recueil de correspondances) parlait de cet inconfort que nous avons avec la mort comme étant un indice que nous ne sommes pas faits pour nos quelques décennies sur Terre. Selon lui, deux indices à cela:
notre inconfort avec le passage du temps auquel nous ne nous habituons pas – pourtant c’est une constante –
et notre inconfort avec la mort.
Si nous n’étions vraiment qu’un amas de molécules, nous aurions dû depuis des millénaires nous habituer à ces deux constantes absolues de la vie, et pourtant ce sont des choses qui continuent à nous déranger, voire nous révolter. Il ajoute: c’est comme si les poissons se plaignaient que l’eau est mouillée ! Si les poissons se mettaient à se plaindre que l’eau est mouillée, on se dirait peut-être qu’ils ne sont pas faits pour vivre dans l’eau. Si nous nous plaignons du passage du temps, de la proximité de la mort et du fait que nous n’arrivons pas à nous y habituer, c’est bien peut-être que nous ne sommes pas faits pour ça…
«C’est peut-être ma position dans la vie: Shéhérazade»
Jean-Luc Gadreau: La maladie, vous l’évoquez aussi, Éric-Emmanuel, notamment avec un enfant dans cette fameuse pièce, film et livre, au départ, Oscar et la Dame rose. Dans cette très belle histoire, vous abordez la question de la mort à travers les yeux d’un enfant. Comment est-ce que vous avez appréhendé cette thématique délicate, intime ?…
Éric-Emmanuel Schmitt: Comme je vous l’ai dit, j’ai accompagné des gens que j’aimais dans la mort et je me suis rendu compte qu’il fallait être Shéhérazade au bord du lit. Quand la vie se réduit à une salle d’hôpital, quand les jours sont comptés, c’est très important de raconter des histoires. Dans le livre, Oscar n’a plus que 10 jours à vivre et la Dame rose vient lui raconter des histoires et, surtout, lui donne un jeu: chaque jour sera 10 ans. Elle lui offre une vie entière en 10 jours; il va aller jusqu’à 100 ans.
Jean-Luc Gadreau: Et puis, il y a ces fameuses lettres à Dieu…
Éric-Emmanuel Schmitt: Oui, il écrit à Dieu, auquel (au départ) il ne croit pas. Et puis, un jour il a une révélation (il n’y a pas d’âge pour avoir une révélation, ce n’est pas réservé aux adultes agrégés de philo, les enfants aussi ont des expériences mystiques !). Cet enfant va à la fenêtre, voit le jour qui se lève et dit:
«J’ai compris. Dieu, toi, tu es le mec infatigable ! Et voilà du jour, et voilà de la nuit, et voilà de la lumière, et voilà de l’obscurité, et voilà les animaux, et voilà Oscar, et voilà Peggy Blue et voilà Mamie Rose !».
C’est la force de la Création qu’il ressent tout à la fois en lui et qui va lui permettre d’habiter totalement ses derniers jours et de les vivre avec intensité avec cette maxime: «Vivre chaque jour comme si c’était la première fois». C’est exactement le contraire de ce qu’a écrit Tolstoï: «Vivre chaque jour comme si c’était la dernière fois». Personnellement je ne peux pas vivre en pensant que je dis adieu perpétuellement au monde… En revanche, je vis en ouvrant les bras, en disant perpétuellement bonjour au monde et en n’ayant jamais l’impression d’avoir déjà vécu ce que j’ai vécu mais au contraire en luttant contre l’illusion de savoir, la fatigue de vivre, la lassitude du sentiment de déjà-vu. Je vis avec l’intensité accordée au présent qu’ont les enfants. Mais cet enfant-là va avoir du mal à vivre, forcément, dans ses derniers instants. Quand j’ai écrit ce livre, il y avait ce souvenir de mon rôle de Shéhérazade mais, de manière générale, c’est peut-être ma position dans la vie: Shéhérazade, raconter des histoires pour apprivoiser la vie et la mort…
Jean-Luc Gadreau: Et Shéhérazade est transformée dans l’histoire, aussi. Cette femme qui est croyante, puisqu’elle amène ses prières à Dieu, mais dont la dernière lettre est différente.
Éric-Emmanuel Schmitt: Sa dernière lettre qui n’est pas une lettre… Oui, je ne suis vraiment pas russe ! Et pourtant, comme j’aime la littérature russe, mon Dieu !… Ce n’est pas comme chez Dostoïevski et Tolstoï. Dostoïevski disait que la mort d’un enfant nous empêche de croire en Dieu mais dans mon livre, dans cette dernière lettre, elle ne se révolte pas contre Dieu, elle le remercie de lui avoir fait connaître cet enfant car, grâce à lui, elle est chargée d’amour pour toutes les années qui lui restent à vivre. L’expérience d’être auprès de l’autre vous enlève l’autre mais ces moments-là vous chargent aussi de plein de choses.
«Dieu est un agent qui veut se révéler»
Jean-Luc Gadreau: Jonathan, vous qui avez accompagné des personnes en fin de vie, peut-être avez-vous repéré la notion de Dieu dans ces moments où la mort approche ? Comment est-ce que cela se vit ?
Jonathan Hanley: Les gens découvrent soudain le besoin d’un pasteur ou d’un prêtre. La première personne que j’ai pu accompagner dans ses derniers moments et dont j’ai célébré les obsèques, la mémoire, c’était un combattant de la guerre d’Espagne. Un anticlérical fini, pour des raisons politiques que l’on connaît; il avait conduit les camions des Républicains pour apporter les vivres en Espagne et sortir les blessés. Sa fille était une de mes paroissiennes et il a donc accepté que je l’accompagne puisque j’étais pasteur. Quelqu’un qui avait passé sa vie à refuser tout contact avec la religion se découvrait dans ces moments-là – et c’est souvent ainsi.
Dans mon accompagnement des personnes touchées par le VIH, j’ai eu le privilège d’accompagner jusqu’à la fin des personnes que, généralement, j’ai appris à connaître, avec mon épouse Amanda et les autres membres de l’équipe de bénévoles. Je pense que ces gens, nous les avons aimés, en tout cas ils ont «habité notre cœur» (pour reprendre une expression d’Oscar et la Dame rose). C’était intéressant de constater à quel point des personnes qui prétendaient ne pas croire en Dieu étaient remplies de cette question: «Qu’est-ce que j’ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça ?». Et mon travail était un petit peu un travail de réconciliation: le bon Dieu, il te connaît, il t’a voulu. Si tu apprends à croire en Lui, si tu l’entends, si tu es prêt à entendre sa voix de différentes manières, Dieu se révèlera. Je suis de ces chrétiens convaincus que Dieu est un agent qui veut se révéler. Il a une force d’action, il n’attend pas de manière passive.
Éric-Emmanuel Schmitt: Il «attend derrière la porte», comme on dit dans l’évangile selon saint Marc.
Jean-Luc Gadreau: Et il est là pour venir manger avec nous !
Jonathan Hanley: Exactement…
Jean-Luc Gadreau: Éric-Emmanuel Schmitt, à l’issue de ces quatre rendez-vous, peut-être pouvez-vous nous donner le mot de la fin ?…
Éric-Emmanuel Schmitt: Le mot de la fin ?… Surtout pas ! Tout commence. En achevant mon livre La Nuit de feu (dans lequel je relatais ma révélation au cœur du désert), j’ai fini par assumer le poids de cette révélation et le travail alchimique de conversion intérieure qui me permet d’oser parler comme un homme de foi mais aussi comme un très mauvais chrétien. La barre est mise beaucoup trop haut pour moi: être chrétien, c’est une des choses les plus profondément difficiles ! Mais j’ai terminé mon livre en disant: «Tout commence»…
Jean-Luc Gadreau: Un grand merci à tous les trois, ce fut un vrai bonheur pour moi d’avoir pu prendre ce temps avec vous. D’ailleurs, Éric-Emmanuel Schmitt, y a-t-il quelque chose sur le feu ?
Éric-Emmanuel Schmitt: Oui, il y a une pièce sur le feu que j’ai portée pendant 20 ans et que j’ai enfin écrite. En fait, je suis un gros paresseux !… Dans ma tête, il y a beaucoup plus de romans, de pièces et de nouvelles que ce que j’ai encore écrit – pourtant je dois être à 45 volumes ! Je pense que je mourrai sans avoir vidé cette citrouille…
Jean-Luc Gadreau: C’est parce que ça n’est que le commencement, bien sûr !… Pour terminer, deux livres pour prolonger la réflexion sur vie et mort chez Labor & Fides:
La Naissance, qu’est-ce que ça change ? d’Olivier Abel;
La Vie, qu’est-ce que ça change ? d’un collègue de France Culture, Frédéric Worms.
Transcription réalisée par Pauline Dorémus.
Illustration: ascenseurs (photo Misiokk, CC BY-SA 3.0).
(1) Rainer Maria Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910).