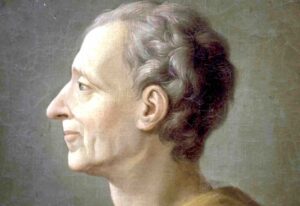La démocratie ou l’équilibre des pouvoirs
Pour éviter les abus, Montesquieu voulait que «le pouvoir arrête le pouvoir». Or, pour l’exécution sans appel de la condamnation de Marine Le Pen, ce sont les députés qui, par la loi, ont donné (contre eux-mêmes) «un pouvoir peut être excessif à la justice». Pour Jean-Paul Sanfourche, si le pouvoir judiciaire peut être ici «perçu comme exerçant une forme de domination sans possibilité de contrôle», le pouvoir législatif serait bien avisé d’y réfléchir à deux fois avant de priver «un acteur de la possibilité d’un recours».
La condamnation en première instance, avec exécution provisoire, du Front National (devenu Rassemblement National) crée un malaise évident dans notre pays. Il ne s’agit pas ici de prendre parti sur le fond. Il ne s’agit pas non plus ni de dénoncer abruptement un pseudo gouvernement des juges, encore moins de remettre en question la nécessaire égalité des citoyens devant la loi. Ni de nous inscrire dans le courant de telle ou telle doxa. Nous voudrions juste, avec recul, tenter de circonscrire rapidement et objectivement ce malaise (ou ce «trouble») à partir de ce qu’écrit Montesquieu:
«Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (1).
Un équilibre des pouvoirs
Pour éviter tout abus, la nécessité impérieuse d’une séparation et d’un équilibre des pouvoirs est ainsi rappelée. Selon Montesquieu, la concentration excessive d’un pouvoir entre les mains d’une seule entité conduit forcément, tôt ou tard, à des abus. La seule solution est d’organiser les pouvoirs (et non les répartir) de manière à ce qu’ils se limitent mutuellement. Pour analyser cette citation en lien avec la récente décision de justice concernant l’exécution provisoire sans droit d’appel à l’encontre du Rassemblement National, il est essentiel de mettre en lumière comment cette décision pourrait illustrer ou contredire l’idée de Montesquieu sur l’équilibre des pouvoirs et les risques d’abus.
Fragmentation des principes de la séparation des pouvoirs
Examinons la décision de justice et l’exécution provisoire sans appel. L’exécution provisoire est une décision judiciaire qui permet à une décision de justice d’être mise en application immédiatement, même en l’absence de recours possible par un appel dans l’attente d’une décision définitive. Dans le cadre de la décision concernant le Rassemblement National, l’exécution provisoire pourrait être perçue comme un acte qui fragmente les principes classiques de la séparation des pouvoirs et de l’équilibre nécessaire entre les différentes instances (législative, exécutive et judiciaire). N’oublions pas cependant que les juges ne font qu’appliquer la loi votée par le parlement et que les politiques ont une large responsabilité dans le jugement de la présidente Bénédicte de Pertuis. «Le bras du juge est armé par le législateur», prévient Jean-Eric Schoettl (2), même si le juge n’est pas obligé de s’en servir systématiquement.
Ainsi Montesquieu défend-il une forme de gouvernement dans lequel chaque pouvoir est limité par les autres. Aucun pouvoir n’a la possibilité d’exercer une domination totale. Dans le cas du jugement qui nous occupe, et l’utilisation des textes législatifs qui l’informe, la décision de justice qui empêche le recours immédiat à un appel pourrait sembler en contradiction avec ce principe d’équilibre des pouvoirs. Si la décision est appliquée sans qu’un autre pouvoir, comme le pouvoir législatif ou exécutif, puisse intervenir (par exemple, en modifiant la loi ou en révisant cette application), cela pourrait donner l’impression qu’un seul pouvoir, ici la justice, a la mainmise sur la situation, ce qui pourrait mener à un abus de pouvoir.
Un pouvoir excessif accordé à la justice ?
C’est ainsi que l’on peut comprendre la modification envisagée de la loi. Mais rappelons-le une fois de plus: les députés (dont Madame Le Pen !) ont attenté au droit d’appel, accordant un pouvoir peut être excessif à la justice. Ce qui, une fois de plus, est en contradiction avec la séparation des pouvoirs. L’exécution provisoire, combinée à l’absence de droit d’appel, pourrait alors être perçue comme l’exemple d’un pouvoir judiciaire qui agit sans contrepoids. La justice se trouverait alors dans une position d’arbitre unique, qu’il ne tient d’ailleurs qu’à elle d’adopter ou de refuser. Ce qu’elle aurait apparemment pu faire en ne retenant pas le risque de «récidive». Le principe de Montesquieu, selon lequel il doit y avoir une séparation entre les différentes branches du pouvoir, serait ainsi bien mis à mal. Reconnaissons qu’une telle situation pourrait amener à des abus si les décisions judiciaires étaient perçues comme non révisables ou non contrôlables par d’autres instances de pouvoir.
La vigilance démocratique
Or, le danger d’un abus de pouvoir existe particulièrement lorsque l’accès à des recours (comme le droit d’appel) est restreint ou pire impossible. En l’absence de possibilités de recours, un pouvoir judiciaire peut alors être perçu comme exerçant une forme de domination sans possibilité de contrôle. Or les juges ne sont pas infaillibles ! La décision d’exécution provisoire sans appel pourrait alors être interprétée comme une forme d’abus de pouvoir judiciaire. On mesure comment cela peut être (et va être) idéologiquement exploité à l’encontre des valeurs démocratiques par ceux qui s’en proclament les défenseurs ! Les députés, lors de l’affaire Cahuzac, n’ont pas fait preuve de cette vigilance à laquelle Montesquieu invite. Et Montesquieu n’inspire pas toujours l’hémicycle !
Les conséquences de cette décision de justice seront lourdes dans notre démocratie de plus en plus fragile. Est-il encore temps de rappeler au législateur que les pouvoirs se régulent mutuellement ? Et que toute décision qui prive un acteur de la possibilité d’un recours, même temporairement, pourrait gravement remettre en cause leur équilibre ?
Illustration: Marine Le Pen sur les bancs de l’Assemblée nationale le mardi 1er avril 2025.
(1) De l’esprit des lois, livre 11, chapitre 4.