Désobéissance civile et lutte environnementale (1)
Dans cette première partie d’entretien, Caroline Ingrand-Hoffet (interrogée par Jérémie Claeys pour Protestantes!) revient sur son parcours et ses racines, terreau de sa foi et de son militantisme environnemental. Celle que les médias ont surnommé, à son corps défendant, «la pasteure de la ZAD» rapporte les évènements qui, en 2017, ont précipité son engagement auprès des zadistes contre le GCO, Grand contournement ouest de Strasbourg.
Écouter ce podcast de la série Protestantes !
Jérémie Claeys: Issue d’une longue lignée de pasteurs de nationalité franco-suisse, Caroline Ingrand-Hoffet est la fille d’un ancien élu socialiste un temps directeur d’Amnesty International France, le pasteur Jean-Louis Hoffet. Dans une interview pour le média écologique Reporterre, elle dira d’ailleurs que son père l’emmenait autant à des réunions politiques qu’au culte le dimanche et qu’elle a grandi avec l’idée que l’Église pouvait être un lieu de vie politique au service de la communauté. Pasteure depuis 2010 à Kolbsheim, un petit village à 15 km de Strasbourg, Caroline utilisait autrefois des leviers liturgiques pour sensibiliser ses paroissiens à l’écologie.
Mais en 2017, son engagement en faveur de l’environnement a pris une tout autre tournure en s’engageant avec vigueur contre le GCO, le Grand contournement ouest de Strasbourg, un tronçon autoroutier payant qui a nécessité la destruction de 10 hectares de forêt. Pour ce faire, avec l’aide du maire et des habitants du village, elle a participé à l’installation d’une ZAD, une Zone à défendre, ainsi qu’à l’accueil des zadistes venus s’installer dans la forêt pour manifester leur mécontentement. Largement relayée par les médias, cette zone à défendre a fait grand bruit, notamment avec la présence et l’engagement de Caroline qui a ajouté à cette lutte un aspect un peu plus spirituel. Malheureusement, le 10 septembre 2018, à l’aube, la ZAD a été évacuée par plus de 500 gardes mobiles qui ont délogé la dizaine de zadistes qui avaient élu domicile dans la forêt, sans oublier les 200 villageois, militants et élus locaux présents sur place. Un évènement qui a marqué de manière indélébile ceux et celles qui ont participé à cette lutte et dont nous avons également discuté dans cet épisode. Aujourd’hui, celle que l’on surnomme parfois la pasteure des zadistes poursuit sa lutte de manière différente, notamment en se tournant vers la désobéissance civile. Par exemple, en novembre 2022, aux côtés d’autres représentants religieux, elle s’est positionnée en faveur du blocage lors de l’action de l’organisation interreligieuse américaine Green Faith contre TotalEnergies. Ensemble, nous avons discuté de lutte environnementale, de non-violence et de désobéissance civile.
Bonjour Caroline, merci de me recevoir chez toi, à Kolbsheim, dans ta base ! Pourrais-tu brièvement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore ?
Je m’appelle Caroline Ingrand-Hoffet, j’ai bientôt 50 ans et je suis franco-suisse. J’ai été pasteure en Suisse et j’exerce depuis 2010 à Kolbsheim, dans l’Union des Églises protestantes d’Alsace-Lorraine (UEPAL).
Pourrais-tu nous décrire ton arrière-plan personnel ? À quel moment la foi chrétienne et le protestantisme ont-ils fait leur entrée dans ta vie ?
Depuis toujours ! Comme je dis souvent: je suis tombée dedans quand j’étais petite ! Je n’ai que des ancêtres protestants et beaucoup d’ancêtres pasteurs avant moi, des deux côtés: du côté alsacien par mon père (la famille Hoffet), et du côté suisse par ma mère (la famille Biéler).
Cependant, cela a vraiment été un choix personnel. J’ai demandé le baptême à la fin du catéchisme – mes parents avaient donc fait le choix de ne pas nous baptiser, ma sœur et moi – et j’ai vraiment reçu un appel personnel à ce moment-là, du haut de mes 15 ans, que j’ai mis du temps à intérioriser, à accepter, à formaliser aussi. Je me souviens encore avoir été très impressionnée d’annoncer à mes parents que je voulais faire des études de théologie. Ce n’était pas du tout évident ! Il n’y avait aucune pression, au contraire, donc ça a été malgré (ou grâce à) un contexte personnel tout en restant vraiment un choix.
Puis j’ai décidé à 18 ans de quitter l’Alsace où j’avais grandi pour suivre des études à Genève. Mon père étant un pasteur assez connu sur la place alsacienne, avec lui-même un père pasteur et une mère pasteure, je ne voulais pas être la fille de et la petite-fille de. Je suis donc retournée du côté de ma famille maternelle, à Genève, où j’ai fait toutes mes études. J’ai ensuite choisi d’aller faire une année de stage dans l’ERF de l’époque (Église Réformée de France devenue ÉPUdF entretemps). J’étais dans une paroisse du centre-ville de Nîmes, au Grand temple; j’y ai fait la connaissance de la famille Ingrand, grande famille de pasteurs de cette paroisse dont j’ai rencontré l’un des enfants, à mon retour à Genève un an après, Jean-Sébastien, qui est devenu mon mari. La famille Ingrand est une famille originaire du Poitou également très présente dans le Midi et dans les Cévennes. De mon côté, j’ai par ma famille un peu d’Alsace et un peu de Suisse donc à nous deux nous couvrons à peu près les régions protestantes francophones ! Comme mon père l’a dit quand j’ai présenté mon futur mari à mes parents, je n’ai pas fait dans l’exotisme !
Depuis que mon père est mort, il y a deux ans, on me dit de nouveau que ça doit être pesant et compliqué, cet héritage… mais non, au contraire: cela me porte, ce sont des racines extrêmement fortes et bienfaisantes, pas du tout enfermantes. Enfin, je m’y retrouve bien et j’ai l’impression de pouvoir parfaitement faire mon chemin tout en étant portée par mes prédécesseurs. Je pense que c’est une chance pour vivre le ministère aujourd’hui car quand je vois certains jeunes collègues venus de milieux totalement différents, j’ai l’impression qu’il est compliqué de trouver sa place en tant que pasteur. J’ai plutôt l’impression que ça me donne une assise, une tranquillité dans le ministère que de pouvoir être portée par ceux qui m’ont précédée.
Tu t’inscris vraiment dans une grande histoire familiale et ton militantisme, tes engagements politiques et spirituels, y trouvent tous leur racine. En quoi l’exemple de ton père ou encore de ta grand-mère, pour ne citer qu’eux, ont-ils forgé la femme que tu es devenue ?
Effectivement, la particularité de ma famille ou de mes familles spirituelles et pastorales, c’est d’avoir toutes une conception du ministère et même de la foi chrétienne ou de la foi protestante, liée à la société. Pour elles, être chrétien c’est être au service de la société et pas seulement de l’Église et avoir une place à prendre dans la société, une parole à avoir en tant que chrétien pour la société, dans la société, et, pourquoi pas, une part critique. Cette idée, je l’ai vraiment reçue de plusieurs générations avant moi.
Du côté alsacien, c’était plutôt dans le domaine social que cela s’exprimait. Mon père, ma grand-mère, étaient au Parti Socialiste, donc vraiment inscrits à gauche. Du côté Biéler (du côté suisse, donc), on trouvait déjà la dimension tiers-mondiste (comme on disait à l’époque) mais également la dimension écologique. La notion d’engagement pour l’écologie me vient de mon grand-père André Biéler qui, en Suisse, faisait déjà, avec quelques autres et de manière très prophétique le lien entre la question du Tiers-monde et la question de la surconsommation occidentale. Il était professeur d’éthique, donc c’était pensé. Mais c’était aussi concret: avec mes grands-parents, nous nous déplacions toujours en train, ils recyclaient les emballages en aluminium, ils avaient un potager où ils laissaient pousser librement les fleurs au milieu des légumes… il y a 40 ans ! C’était déjà une conception particulière de la vie. J’ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents suisses quand j’étais enfant et adolescente, je m’y sentais bien et je pense qu’ils m’ont beaucoup transmis. Il y a donc eu cette complémentarité entre la dimension sociale politique et la dimension écologique. J’ai par ailleurs un oncle, qui est aussi mon parrain, qui a été le premier écologiste à être conseiller d’État (ministre) dans le canton de Vaud. Des fibres politiques écologistes sont donc également présentes dans cette famille Biéler. Je pense que c’est aujourd’hui l’évolution de la société que de ne plus séparer le social de l’écologie; il faut les penser ensemble. J’ai souvent dit ne pas avoir beaucoup de mérite puisque tout cela, quelque part, je l’ai reçu. Si j’ai tissé tous ces apports ensemble et si je porte ces idées avec conviction, cela m’a été donné, ce sont des graines qui ont été plantées en moi quand j’étais petite.
Ces apports t’ont donné une vocation, une longueur d’avance pour pouvoir penser ce combat écologique qui est le tien.
Oui, je pense qu’être relativement sécurisée dans le militantisme m’a certainement aidée.
Tu es arrivée à Kolbsheim en tant que pasteure en 2010, c’était alors un tout petit village de moins de 1000 habitants. Puis, en 2016, on a commencé à en entendre parler. Peux-tu nous rappeler brièvement ce qu’il s’y est passé ?
C’est à cause du projet d’autoroute de contournement de Strasbourg, une histoire très ancienne puisque c’est un projet aussi vieux que celui de Notre-Dame des Landes et qui, en 2016, est ressorti lorsqu’un financement a été trouvé. C’est quelque chose qui était latent. Quand je suis arrivée en 2010, on pouvait déjà voir l’écriteau «Kolbsheim dit non au GCO» sur la mairie. C’était donc présent mais encore assez discret.
Le maire avait déjà sensibilisé la population…
Oui, le maire, Dany Karcher, était déjà extrêmement sensibilisé, sensibilisant, et mobilisant sur le sujet auprès des gens du village. Mais quand je suis arrivée en 2010, ce n’était pas en première position des préoccupations des gens. C’est quand le projet est vraiment ressorti des cartons et qu’on a senti que ça allait probablement se faire (puisque le financement avait été trouvé) que je me suis officiellement positionnée contre, dans mon église, au moment du culte des récoltes en octobre 2016.
Juste avant cet évènement, je crois que des élus locaux sont venus vous chercher, ne te laissant en quelque sorte d’autre choix que de te positionner.
Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c’est qu’à la suite de la mobilisation des Églises dans le cadre de la COP21, un certain nombre de maires de villages mobilisés contre ce contournement sont allés voir des pasteurs à l’autre bout du GCO en leur demandant si, eux dont les Églises avaient signé de beaux papiers, étaient maintenant avec eux, ou pas (ça c’est vraiment le contexte alsacien où, dans les villages, les pasteurs – ou les curés, d’ailleurs – ont encore une certaine notoriété, aux côtés du maire, etc.). C’est ainsi qu’une collègue a été cherchée par le maire de son village et qu’à la suite de ça, le maire d’ici m’a dit qu’elle était intervenue dans les manifestations. Il y avait un clair appel du pied ! Je ne peux pas dire que j’ai été obligée mais disons que, comme je l’ai dit, je n’aurais plus été cohérente si je ne l’avais pas fait, dans la mesure où tout le monde savait probablement que cela correspondait à mes convictions. C’était pour moi une évidence d’être contre car c’était vraiment un projet absurde à un niveau global: davantage de routes, de bouchons, sans compter les terres, les zones humides et tout le reste. Mais entre le fait que les gens sachent que j’étais contre et le déclarer publiquement, il y avait évidemment un pas, que j’ai décidé de franchir au moment où vraiment je ne me suis plus sentie cohérente à l’idée d’encourager les gens à aller manifester pendant que moi je restais dans mon église.
Et que s’est-il passé à ce culte des récoltes ?
Ce culte avait ceci de particulier que j’avais réussi à mettre le curé dans le coup. À Kolbsheim, en effet – et c’est une autre spécificité alsacienne – nous avons une église simultanée, c’est-à-dire un édifice où célèbrent à la fois les catholiques et les protestants.
Trop bien !
Oui, c’est aussi ce que je me disais en arrivant à Kolbsheim mais malheureusement ça ne voulait pas dire œcuménisme. La messe est à 8h45, le culte à 10h… Ça ne veut donc pas encore dire qu’on fait ensemble. Nous avions en tout cas choisi le dimanche, un jour où il était possible pour tout le monde de célébrer cette fête des récoltes, comme cela se fait traditionnellement dans les villages. La fête ici a lieu début octobre: on remercie Dieu pour ce que la nature nous donne et on apporte des fruits des récoltes. Il se trouve qu’il y avait une messe avant, ce dimanche-là, et j’avais proposé au curé que nous fassions quelque chose ensemble sur le sujet, ce qu’il avait approuvé. Nous avons fait la messe à 8h45, le culte à 10h, et un petit-déjeuner entre les deux. Nous avons ainsi passé la matinée à l’église, c’était absolument génial ! J’aurais bien fait ça à volonté mais le curé de son côté n’a plus jamais voulu prendre position sur le sujet publiquement, probablement parce que, suite à cet évènement, l’archevêque de Strasbourg le lui a interdit. Donc c’était réglé, terminé.
Il faut dire aussi que tu as ouvert avec du Karl Marx !
Alors, lui a donné une messe qui est restée extrêmement sobre. Il n’a pas parlé du GCO mais a plutôt évoqué des choses comme la nature. Alors que moi, effectivement, j’en ai parlé de manière explicite; c’était pour moi l’objectif de cette matinée. J’avais invité un certain nombre de militants, des gens qui ne venant pas au culte d’habitude étaient là pour cette raison spécifiquement. Et oui, j’avais trouvé cette citation parmi d’autres sur le thème de la terre: «La terre n’appartient à personne et personne ne peut revendiquer la terre». Je trouvais que c’était une belle citation et un clin d’œil un peu rigolo. De plus, il semblerait – mon mari ayant vérifié entretemps – que ce ne soit peut-être pas de Karl Marx !… Toujours est-il que ça a fait tiquer car c’est évidemment ce qu’on a retenu dans le journal. C’est en quelque sorte ce qui a déclenché la notoriété autour de Kolbsheim, autour de moi, parce que la pasteure rejoignait le combat. C’est remonté jusqu’à l’inspecteur ecclésiastique (comme nous sommes dans une Église luthérienne, nous avons un inspecteur au-dessus de nous) et puis à la direction de l’Église…
Qu’est-ce qu’on t’a dit à ce moment-là ?
À moi, pas grand-chose… Mais c’est le président de l’Église qui a essuyé des remarques: «Tu ne tiens pas tes pasteurs !», «Qu’est-ce que c’est que ces pasteurs qui se mêlent de politique ?»… Ça a été assez compliqué à gérer pour le président de l’Église et pour les quelques collègues et inspecteurs qui nous soutenaient. Je n’ai jamais été toute seule, nous étions quelques collègues mobilisés, mais j’ai toujours été un peu mise en avant parce que j’étais à Kolbsheim. Heureusement que j’avais des collègues avec moi et que j’ai eu la grâce d’être relativement protégée des critiques… Relativement, parce que j’ai quand même reçu quelques courriers anonymes, des choses pas très sympathiques.
Dès le début ?
En 2017, plutôt. C’était le fait qu’un pasteur se positionne publiquement sur une question politique qui gênait.
Mais pour toi ce n’était pas un sujet, c’était normal au vu de tes croyances, de ton héritage, de tes convictions.
Oui, même le fait de me prononcer sur un sujet politique en soi ne me dérangeait pas.
Quel genre de critiques as-tu dû affronter ?
En Alsace, nous sommes assimilés fonctionnaires en tant que pasteurs (comme les curés et les rabbins) et dans le courrier de journaux comme les DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace, le journal local), des gens nous ont reproché de «cracher dans la soupe» parce qu’on se positionnait contre l’État (qui avait signé pour ce projet). On a pu lire également: «Qu’est-ce que c’est que ces pasteurs qui cherchent leur quart d’heure de gloire ?». Les attaques visaient assez peu des sujets de fond, finalement. C’est la fameuse critique qui dit que les pasteurs doivent s’occuper du ciel et laisser les politiques s’occuper de la terre. Christian Albecker, président de l’Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (EPCAAL, luthérienne et partie de l’UEPAL) est monté au front pour nous défendre et me défendre en particulier: il a répondu qu’un pasteur a aussi à s’occuper de ce qu’il se passe sur la terre en évoquant l’Évangile, le Christ… Ça a été compliqué à l’intérieur de l’Église avec des critiques assez dures, mais là aussi, j’ai été très préservée car elles ne sont pas directement remontées jusqu’à moi.
Tu as donc pris position en 2016, tu as subi ces premières critiques et, en 2017, un premier zadiste est venu s’installer dans la forêt de Kolbsheim pour s’opposer au projet.
Oui, et la particularité par rapport à d’autres ZAD est que c’est une petite association locale qui s’est créée sur place dans l’objectif de lutter contre ce contournement. La séance de création de l’association s’est faite dans la salle paroissiale, dans la cour du presbytère, avec un paroissien pour président ! Cette petite association a décidé de chercher des jeunes prêts à s’installer dans la forêt. C’est donc l’association locale qui s’est mise en recherche de zadistes ! Cela explique aussi le fait que, plus qu’ailleurs, ces jeunes étaient soutenus par le village et par les militants. En général, ce sont des jeunes qui entendent parler d’un projet, s’installent puis vont à la rencontre des locaux (et malheureusement ça ne se passe pas toujours très bien) alors qu’ici, c’était «Village cherche zadiste» !… Il était d’autant plus normal d’accueillir le premier zadiste qu’il avait été amené par l’association.
Il a ensuite été rejoint par d’autres puis par toi, ta famille, le maire. Toute une bande s’est mobilisée et le mouvement a pris de l’ampleur.
Oui, pour la partie Kolbsheim. Mais autour, il y a quand même un grand collectif, le GCO, non merci dans lequel Alsace Nature (l’association alsacienne de défense de la nature) jouait un rôle très important. Ce sont eux notamment qui ont couvert toute la dimension juridique de la lutte. Des choses se sont passées à Kolbsheim mais il faut tout de même resituer cela dans un contexte militant beaucoup plus large. Heureusement, car Kolbsheim seul n’aurait jamais pu aller aussi loin dans la lutte.
Pour les néophytes, peux-tu développer ce qu’était la bataille juridique atour du projet ?
Ça a été une très longue bataille, comme c’est le cas dans toutes les situations de grands chantiers, sur toutes les demandes d’autorisation. Quand ils ont commencé en 2017, ils n’avaient pas toutes les autorisations, et c’est là-dessus qu’on les a attaqués. Il y a eu une surveillance très importante de la part des juristes d’Alsace Nature sur la question (ça a été l’occasion pour moi de découvrir tout ce côté juridique essentiel de la lutte, extrêmement pointu et difficile à comprendre, et que je ne connaissais pas du tout). Vinci (l’entreprise chargée de mener à bien ce projet) a beaucoup dit qu’il y a eu un nombre de mesures compensatoires extrêmement important, des plantations notamment. Ils se sont beaucoup plaints en disant que ça faisait encore monter toutes les compensations pour d’autres projets, que ça allait faire jurisprudence et qu’ils n’allaient plus réussir à suivre (les pauvres)… Or on sait bien que, malheureusement, ces mesures compensatoires ne sont pas très utiles: en ce moment, tous les arbres qu’ils ont plantés sont en train de mourir.
Ce qui est aussi intéressant dans une lutte comme celle-là, c’est le nombre d’acteurs impliqués: moi j’avais ma petite place de pasteure, le maire avait sa place en tant que politique, il y avait les juristes, les militants des associations, les gens des villages, les jeunes venus à la ZAD… Nous avons réussi à créer une alchimie qui a priori ne devait pas forcément fonctionner entre tous ces publics ! Et c’est vrai que, par rapport à d’autres lieux, le fait qu’il y ait une dimension religieuse à travers la présence de pasteurs et de chrétiens revendiquant d’être là en tant que chrétiens, est assez étonnant et unique. À l’avenir, les chrétiens seront peut-être plus présents.
Nous chrétiens ne prétendons pas avoir plus de raisons d’être là, ni ne souhaitons évidemment convertir qui que ce soit. Mais nous sommes là au nom de ces convictions et cela nous intéresse de savoir au nom de quoi d’autres vont être présents. En réalité, on se rend compte qu’on a tous le même objectif et que tous, avec nos motivations différentes, sommes complémentaires et allons dans la même direction. Tout cela permet de vivre des choses très intéressantes et de très belles rencontres, surtout.
(Lire la suite de l’entretien)
Transcription: Pauline Dorémus
Illustration du podcast Protestantes! par Anna Wanda Gogusey et portrait de Caroline Ingrand-Hoffet.
Commentaires sur "Désobéissance civile et lutte environnementale (1)"
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.




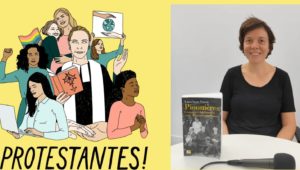




Je suis totalement en opposition à ce militantisme idéologiquement orienté en Église, utilisant soit les locaux d’une église – comme lors du simulacre de procès de Total instruit dans un des grands temples parisiens -, ce qui est contraire à un des articles de la Loi de 1905, soit en devenant – comme ici – « pasteur » aux côtés de zadistes, des hommes et des femmes transgressant régulièrement les lois de la République et s’attaquant à un droit inaliénable, celui de la propriété privée. On ne peut pas plus brandir aujourd’hui Marx et la Bible que du temps de la Théologie de la Libération qui, au final, a fait plus de mal que de bien en laissant se développer une violence contre les biens puis les personnes contraire à l’Évangile. En Démocratie, c’est dans et par les urnes que se font les choix et les lois, à travers le travail des élus, et pas dans la rue ou dans des mouvements comme les ZAD. Jésus lui-même nous a invité à « rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », et la place d’un pasteur comme d’un prêtre n’est pas de militer et de défiler avec des ultras de toutes sortes, de gauche, de droite, écologistes ou nationalistes. Méfions nous enfin de la montée de la violence au sein de l’écologie politique, des théories fumeuses – non bibliques – des antispécistes ou non-binaires, du mélange des genres entre combats écologistes, pro-palestiniens frisant parfois l’antisémitisme voilé, féministes frisant la haine contre « le mâle blanc de plus de 50 ans » devenant le bouc émissaire de tous les malheurs du monde… toutes choses contraires à l’Évangile et son message de Paix et du dépassement mais pas de l’effacement de nos différences en Christ : homme vs femme, homme libre vs homme asservi, autochtone vs étranger, jeune vs vieux, riche vs pauvre, patron vs employé, etc… Et puis, en ce qui concerne les conséquences du réchauffement climatique, il ne sert à rien de vouloir tout arrêter en Occident alors que le reste du monde fait exploser son activité industrielle et démographique : c’est du suicide civilisationnel ! Vivons plutôt sans trop nous inquiéter d’un lendemain qui n’appartient qu’au Créateur – comme nous l’enseigne le Christ dans son Sermon sur la Montagne ou le CARPE DIEM des stoïciens – : le « à chaque jour suffit sa peine » ! Luc S.