Progrès des choses, progrès des humains: ouverture
Abram «doit partir» et Ézéchiel annonce un «renversement de perspective». Le déplacement «qu’ils accomplissent reste totalement inattendu». Pour Philippe Kabongo-Mbaya qui ouvrait le 11 octobre la journée du Christianisme social Progrès technique, progrès humain, «le progrès est de marcher, sans le savoir, peut-être même sans le chercher, vers une espérance: rencontrer l’inattendu ou se laisser rencontrer», provoquant un «saisissement qui renouvelle aussi bien le sujet de cette connaissance que son objet même».
Intervention d’ouverture lors de la journée annuelle du Mouvement du Christianisme social (Commune théologique du Sud parisien) le 11 octobre 2025 à l’Institut protestant de théologie de Paris. Texte publié sur le site du Mouvement du Christianisme social.
![]() À l’appel de Dieu ou sur son ordre, Abram puis Ézéchiel agissent. Ce qu’ils accomplissent reste totalement inattendu. Dans chaque situation, une césure marquant un avant et un après dessine déplacement, mouvement, changement. Sommes-nous devant un progrès ? De quelle nature serait-il ? Il ne s’agit pas de superposer des notions hétérogènes, mais de suggérer ce que certaines situations bibliques, par leur étrangeté même, apportent un parallèle aux questionnements des modernes. Genèse 12,1-4 et Ézéchiel 36,24-25 sont ici plus que des simples références; ces versets repositionnent la portée de notre méditation. Initialement, Apocalypse 21,1-4 les prolongeait. La vision dont ce passage est témoin soutient l’ensemble de la réflexion. Entre l’impensable et l’inattendu, qui transparaissent dans ces récits, l’inouï ne concerne pas seulement la foi, mais toute intelligence humaine !
À l’appel de Dieu ou sur son ordre, Abram puis Ézéchiel agissent. Ce qu’ils accomplissent reste totalement inattendu. Dans chaque situation, une césure marquant un avant et un après dessine déplacement, mouvement, changement. Sommes-nous devant un progrès ? De quelle nature serait-il ? Il ne s’agit pas de superposer des notions hétérogènes, mais de suggérer ce que certaines situations bibliques, par leur étrangeté même, apportent un parallèle aux questionnements des modernes. Genèse 12,1-4 et Ézéchiel 36,24-25 sont ici plus que des simples références; ces versets repositionnent la portée de notre méditation. Initialement, Apocalypse 21,1-4 les prolongeait. La vision dont ce passage est témoin soutient l’ensemble de la réflexion. Entre l’impensable et l’inattendu, qui transparaissent dans ces récits, l’inouï ne concerne pas seulement la foi, mais toute intelligence humaine !
Confiance de Partir ou obéir par défi
Abram quitte donc son pays, ses origines, son père et sa patrie pour marcher derrière un Appel; clairement, il quitte sa zone de confort. Autant dire une forme d’exode. Convoite-t-il une découverte ? Car partir sans destination nous paraît inconcevable, à la limite suspect ! Le fait est là. Désormais, telle une obsession, l’appel a fait d’Abram une sorte d’otage ! Et la promesse du dieu inconnu l’unique horizon.
On pourrait également en parler de manière moins romantique. Car cette saga ressemble à un saut dans le vide. Elle est une mise en scène d’une conduite inouïe de prise de risque. Une parabole vivante de consentement. Le futur patriarche incarne cette aventure comme un homme possédé, cornaqué par ce qui en lui le surpasse. Seul ou accompagné, la seule certitude: il doit partir. Avec Saraï ou sans elle; avec Loth ou sans lui; muni de biens ou démuni: il doit partir.
Abram est-il un déséquilibré ? Il parait un peu fou, lui qui s’exécute à l’ordre d’un Dieu impromptu ! Kierkegaard le laisse entendre d’ailleurs dans Crainte et Tremblement. Une conduite qui ne semble pas avoir commencé au pied du mont Morija quand est demandée l’immolation d’Isaac. Coutumier du fait, le Chaldéen entendait déjà des voix…
«Va-t-en de ton pays… vers le pays que je te montrerai»; «Abram partit, comme le Seigneur le lui avait dit». Nous pouvons noter qu’à la prise de risques déjà mentionnée s’ajoute surtout ce déplacement, décrit volontairement comme un arrachement, une marche de soi vers un autre soi-même, une sorte de poétique existentielle assumée comme invention du destin personnel. Pour apprendre il faut désapprendre, et pour acquérir il faut se laisser surprendre.
Restauration inouïe
Ézéchiel, quant à lui, nous évoque les impasses et le dépassement de toute théologie pénale. Le peuple de Dieu a tourné le dos à l’Alliance, sa méconduite religieuse, sociale, politique le fige dans une culpabilité immobile. Livré aux puissances internationales de son temps, ce peuple porte son deuil comme un opprobre parmi les nations. Un peuple d’exilés, sans initiative souveraine. Sa condamnation serait-elle définitive ? On aurait ainsi un dieu inflexible qui aurait à son tour répudié son peuple ! Comme s’il avait été son miroir, son égal ou son binôme…
Quand l’inespéré et la nouveauté apparaissent, c’est pour révolutionner cette théologie de la rétribution. Ici, Dieu ne demande rien à personne. Le revirement de position, il se l’applique à lui-même ! «Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations…»
En même temps, l’engagement divin prend aussitôt la forme d’une grande promesse, au profit du peuple:
«Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair.»
Formidable restauration ! Non comme un retour en arrière, une sainte manière d’honorer la nostalgie d’un ordre moral, une réinstallation des tablettes de pierre; mais le relèvement, le redressement. Le don d’une création nouvelle, contre le désespoir, contre l’épuisement ou l’assèchement de la vie. Ce que Dieu déclare ressemble à un bond gigantesque pour l’histoire de sa révélation.
Le progrès ici, c’est que le Nom divin est sanctifié dans le mouvement même qui refonde un peuple et redessine sa loyauté. Ce qui est décrit là n’est pas une progression dans la révélation du Dieu biblique, mais un renversement de perspective. C’est par la fin, en son achèvement, que réside le secret du lien entre YHWH et son peuple. Ce peuple n’est pas le sujet du progrès; il ne peut le produire ni l’incarner. Comme le prophète, il ne peut qu’en être témoin. Cependant, du point de vue biblique, cette situation de témoin ne laisse pas indemne, puisqu’il est dit: «J’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair».
Que signifie cet oracle ?
L’annonce d’une réalité ouverte
Son socle théologique plus large est indéniablement dans l’enseignement du prophète Jérémie. Ce que déclare Ézéchiel ressemble à une adaptation, une variante littéraire:
«Les jours viennent – déclaration du Seigneur – où je conclurai avec la maison d’Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d’Égypte, alliance qu’ils ont rompue, bien que je sois leur maître – déclaration du Seigneur. Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël, après ces jours-là – déclaration du Seigneur: Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur; je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple» (Jérémie 31,31-33, NBS).
Pourtant, conserver la singularité du discours propre d’Ézéchiel exige que l’on se réfère à ce qu’il proclame à un autre moment de son livre, au chapitre 37:
«Il me dit: Parle en prophète sur le souffle, parle en prophète, humain ! Tu diras au souffle: Ainsi parle le Seigneur Dieu: Viens des quatre vents, ô souffle ! Souffle sur ces tués, et qu’ils revivent ! Je parlai en prophète, comme il me l’avait ordonné. Alors le souffle vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C’était une très grande armée, une armée immense» (Ézéchiel 37,9-10, NBS)
Toutes les prophéties relèvent d’une manière ou d’une autre du langage prédictif. «Celui qui dit ce qui va être, disait Daniel Sibony, contribue à faire être ce qu’il dit.» Le «cœur de chair» contre le «cœur de pierre» n’est donc pas simplement une promesse générale, mais l’annonce d’une réalité ouverte, l’advenue d’un possible qui n’était ni prévisible, ni attendu.
Dès lors, ce qu’on appelle progrès n’est-il pas, au fond, un aspect important de ce basculement ? Un saisissement qui renouvelle aussi bien le sujet de cette connaissance que son objet même ? À sa manière, l’Apôtre Paul le dira à la fois comme un désir et comme un aveu: «Je connaîtrai comme je suis connu».
Un aveu de ferme confiance: le progrès n’est pas la découverte de ce qui est là, qui a toujours été là, mais caché; le progrès est de marcher, sans le savoir, peut-être même sans le chercher, vers une espérance: rencontrer l’inattendu ou se laisser rencontrer. Abram !
Le progrès est le don ce que l’on ne peut se donner soi-même, qui réhabilite et réouvre l’existence à la manière d’une résurrection. Ézéchiel !
Alors, oui. Le regard critique sur le progrès comme idéologie reste légitime. L’enquête sur ses ambigüités, ses risques et ses dangers est plus que légitime. Le plus urgent cependant consiste à lutter afin que l’humain reste cet Humain, Promesse d’un Autre. Un Humain du fait de cette faiblesse de croire, et simultanément de l’audace qui la transcende. De cette audace transluit la vision du Possible: car «on n’arrête pas le ‘progrès’». Alors oui, dans ce sens, il ne peut s’agir que d’un don. Car inespéré.
Illustration: détail de la Rencontre d’Abraham avec Melchisédech (Dirk Bouts, 1464-1467, Louvain, Collégiale Saint-Pierre de Louvain).
Commentaires sur "Progrès des choses, progrès des humains: ouverture"
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.



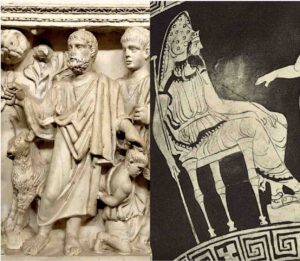


Une méditation profonde et vivifiante: le véritable progrès biblique n’est ni cumul ni idéologie, mais don. On pourrait mettre en perspective philosophique cette méditation (elle nous y invite) à partir de trois figures de la pensée contemporaine. Parce que votre analyse rejoint d’abord Heidegger. À travers le «Ruf» (appel) qui n’est qu’un arrachement à la banalité, la quotidienneté du monde, un appel à exister autrement (on sait quelle lecture malheureuse on peut en faire !). L’exode d’Abram n’est pas une fuite, mais la mise à nu de l’existence, qui s’ouvre à ce qu’elle n’a pas encore découvert. Le progrès n’est pas un mouvement temporel, mais dévoilement. Vous rejoignez aussi Levinas pour qui la transcendance ne vient pas du sujet mais de l’Autre. Votre lecture d’Ézéchiel est levinassienne. Le renversement ne vient ni du peuple ni de sa volonté morale. Il vient d’un Dieu qui rompt la logique rétributive. C’est ce que le philosophe appelle «un événement éthique». Le sujet est atteint par ce qui n’émane pas de lui. Le sujet ne se construit pas par maîtrise, mais en s’exposant. Enfin votre analyse d’Ézéchiel rejoint aussi l’intuition ricœurienne: pas de logique causaliste, mais dynamique de sens. La purification et le cœur nouveau ne sont pas une simple annulation du passé, mais une relecture: l’identité est recréée (identité par la promesse). La re-figuration du soi par une Histoire nouvelle. Certes on peut se passer de ces références, mais elles renforcent votre analyse qui les rejoint. Cela apparaît évident et c’est très intéressant.
La critique de l’idéologie moderne du progrès demeure aujourd’hui plus que jamais pleinement légitime. L’accroissement du pouvoir technique ne s’accompagne pas d’un accroissement du bien (ce que prêchent les prophètes de la Silicon Valley, style Peter Thiel). La Bible (évidemment) propose une autre conception du devenir humain, donc du progrès, en affirmant que l’humain est promesse d’un Autre, que la valeur de l’homme ne se mesure ni à sa puissance ni à ses performances, mais à sa réceptivité au possible de Dieu. Cela entre en résonance critique avec les analyses de Hans Jonas et Günther Anders. Jonas (Le Principe responsabilité) montre que le pouvoir technologique moderne excède les capacités morales de l’humanité: l’homme peut trop, et c’est précisément cette hypertrophie de sa compétence qui devient un péril. La tradition biblique, en situant l’humain dans une posture d’écoute plutôt que de maîtrise, offre un correctif anthropologique: le sujet n’est pas d’abord un agent omnipotent mais un être libre, responsable de ce qui lui a été confié, ouvert à un bien qui le dépasse. Quant à Anders, sa critique bien connue de «l’obsolescence de l’homme» révèle la disproportion entre les capacités techniques de l’humanité et ses capacités affectives, imaginatives et morales. L’homme devient inférieur à ses propres œuvres. Merci beaucoup.