Guerre: tout près du mur
Plus que le système politique (celui créé par de Gaulle et la Ve République, analysé par les historiens Frédéric Turpin et Éric Roussel), face à la guerre comptent peut-être surtout les attitudes individuelles que les mêmes Turpin et Roussel suivent tour à tour à propos de Messmer et Benoist-Méchin. À méditer alors que «la récréation s’achève».
Chroniques du Blog de Frédérick Casadesus les 24 février et 3 mars 2025.
La Ve République au péril de la guerre
L’ordre mondial est mort, le concert des nations n’est plus qu’un vieux souvenir. On ne fera pas l’économie d’une révision de nos programmes. La France est-elle armée pour faire face à la situation ? Nous ne parlons pas de l’arme atomique évidemment, mais des outils institutionnels permettant de rassembler nos concitoyens contre d’éventuels ennemis. Les leçons de la Débâcle devraient nous inspirer. Chacun sait ce que Charles de Gaulle écrivit, dans ses Mémoires de guerre au sujet d’Albert Lebrun, président de la République en juin 40:
«Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient manqué: qu’il fût un chef; qu’il y eût un État».
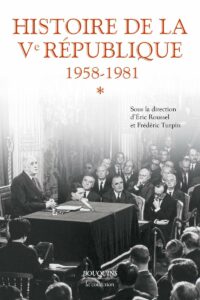 Nous n’en sommes pas là, fort heureusement. Voici quelques jours, Emmanuel Macron s’exprimant devant des internautes, a déclaré qu’il sonnait le tocsin. Lucide parole. Mais après ? Nos institutions nous garantissent-elles une solidité à toute épreuve ? Nous avons sollicité l’avis d’Éric Roussel, qui vient de diriger, en compagnie de Frédéric Turpin, la formidable Histoire de la Ve République (1), parue aux éditions Bouquins.
Nous n’en sommes pas là, fort heureusement. Voici quelques jours, Emmanuel Macron s’exprimant devant des internautes, a déclaré qu’il sonnait le tocsin. Lucide parole. Mais après ? Nos institutions nous garantissent-elles une solidité à toute épreuve ? Nous avons sollicité l’avis d’Éric Roussel, qui vient de diriger, en compagnie de Frédéric Turpin, la formidable Histoire de la Ve République (1), parue aux éditions Bouquins.
«La Troisième République a abordé la guerre de 39 avec des gouvernements divisés, souligne-t-il d’emblée. Les institutions avaient été construites de telle manière qu’il n’y eût pas d’autorité réunie dans les mains d’une seule personne. C’est au cours de la journée du 16 juin 40 que le général de Gaulle a réagi, et pensé les contours de la fonction présidentielle telle que nous la connaissons. C’est même de cette expérience tragique que l’idée de l’article 16, pièce maîtresse de notre constitution, lui est venue.»
Rappelons les termes exact de cet point clé:
«Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.»
Le concept de monarque républicain
N’allons pas imaginer que le chef de l’État puisse devenir, grâce à ce texte, un dictateur. Utilisé au lendemain de la tentative de putsch des généraux d’Alger le 22 avril 1961, ce dispositif est resté très encadré.
«Quand on entend des opposants dire qu’Emmanuel Macron pourrait se saisir de cet article pour gouverner seul, on ne peut que s’insurger, déclare Eric Roussel. Non seulement le Président ne peut en faire usage sous n’importe quel prétexte, mais encore doit-il rendre compte de son action au bout de six mois, tout abus de pouvoir de sa part l’entraînant devant la Haute Cour de Justice. En revanche, en cas de crise majeure, il pourrait s’en emparer pour sauver la République.»
Il faut bien le reconnaître, le monarque républicain voulu par les pères de la Constitution – n’oublions jamais le rôle important tenu par Michel Debré auprès du Général – a du plomb dans l’aile. Affaibli par le suffrage universel ? Certes. Mais ce n’est pas un drame en soi. Dans son ouvrage C’était de Gaulle, Alain Peyrefitte rapporte que le Général estimait que cette constitution a été conçue pour gouverner sans majorité.
La perte de puissance de la fonction présidentielle provient surtout de l’instauration du quinquennat.
«C’est l’élément principal qui a altéré ses pouvoirs, observe Eric Roussel. À la fin de sa vie, dans des conversations très sérieuses et rigoureuses, Valéry Giscard d’Estaing a reconnu devant son directeur de cabinet, devant mon ami Frédéric Turpin et moi-même, qu’il avait eu tort de faire renaître ce projet à l’orée des années 2000. En pratique, le raccourcissement de la durée du mandat présidentiel a certes renforcé les pouvoirs du chef de l’État, puisqu’il l’encourage à agir plus vite et plus fort. Mais en écrasant la fonction de premier ministre, en provoquant des interventions constantes dans le débat public, il expose le Président, et donc il l’abaisse du même coup.»
«La grandeur a besoin de mystère, on admire mal ce qu’on connaît bien»
Paradoxe ? Allons donc… À partir de 2007, sous l’impulsion d’un président plein d’énergie, de volonté, l’action présidentielle a pris les allures d’une véritable geste quotidienne. Et si François Hollande a promis d’être un président normal (formule qui lui fut beaucoup reprochée, mais qui traduisait son désir de revenir à une pratique traditionnelle de la fonction), force est de constater qu’il s’est mêlé des domaines les plus variés – jusques et y compris l’expulsion d’une jeune fille installée sur notre territoire en situation irrégulière. Mais chacun voit bien que ce comportement pose problème, parce qu’il retire au chef de l’État la hauteur de vue, le rôle d’arbitre que lui conféraient nos institutions. L’analyse que l’on prête à Charles de Gaulle («La grandeur a besoin de mystère, on admire mal ce qu’on connaît bien») nous fait comprendre l’impasse où, de nos jours, se trouve le chef de l’État. Cette impasse est d’autant plus préoccupante que, de par le monde, les pouvoirs autoritaires pullulent, y compris dans la patrie de l’équilibre des pouvoirs, les États-Unis.
Puiser dans le passé des raisons de croire en l’avenir n’est pas une lubie de nostalgique. Les portes de l’enfer ne sont pas encore ouvertes. N’abandonnons pas toute espérance.
Deux chemins face à la guerre
Vous souvenez-vous ? La semaine dernière – un monde, au rythme où vont les événements – nous vous recommandions l’ouvrage paru sous la direction d’Éric Roussel et Frédéric Turpin: L’histoire de la Ve République, volume 1 (1958-1981). Or, une association d’idée nous entraîne à vous parler de nouveau de ces deux historiens. Quoi ?, pensez-vous peut-être, encore eux ? Mais oui, encore eux. Duettistes et amis, Roussel et Turpin tâchent de comprendre le temps jadis. Or, deux ouvrages, qu’ils ont écrit chacun de son côté, peuvent éclairer la réflexion de nos contemporains.
Pierre Messmer et le gaullisme
 Frédéric Turpin publia chez Perrin Pierre Messmer (2), il y a cinq ans. Droiture et patriotisme, Pierre Messmer était aussi, par culture et conviction, favorable à la justice sociale. Oh bien sûr, homme de droite un brin rigide, on brocarda sa docilité quand il exerça les fonctions de Premier ministre, entre 1972 et 1974.
Frédéric Turpin publia chez Perrin Pierre Messmer (2), il y a cinq ans. Droiture et patriotisme, Pierre Messmer était aussi, par culture et conviction, favorable à la justice sociale. Oh bien sûr, homme de droite un brin rigide, on brocarda sa docilité quand il exerça les fonctions de Premier ministre, entre 1972 et 1974.
Mais derrière une manière d’être un peu distante, se trouvait d’abord un homme courageux, gaulliste plus qu’historique. Dès le mois de juillet 40, il avait pu gagner Londres, ayant pris connaissance de l’Appel du 18 juin au lendemain de sa radiodiffusion. Messmer tenait de ses ancêtres alsaciens la passion de la France et de la République. À l’hiver 40, il s’est lancé dans la fournaise des combats, parcourant l’Afrique afin de trouver le chemin de la revanche:
«Reste maintenant pour Pierre Messmer à combattre le véritable adversaire, celui à cause duquel il a tout quitté: les Alemands, écrit Frédéric Turpin. Cette quête personnelle et collective de réaffirmation des armes françaises à la face du monde, voire de rédemption d’une France humiliée et vaincue, se mène en deux temps…»
Lucide, cultivé, l’homme avait aussi la modestie véritable des gens qui en ont vu beaucoup, déclarant toujours qu’il lui avait été d’autant plus facile de s’engager dans la France libre qu’il était alors sans attaches familiales.
Jacques Benoist-Méchin et l’extrême droite
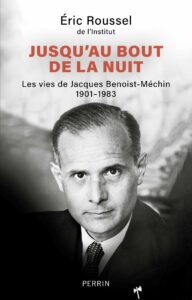
Biographe de Georges Pompidou, du général de Gaulle, de beaucoup d’autres, Eric Roussel publie cette semaine Jusqu’au bout de la nuit, les vies de Jacques Benoist-Méchin (3). Fasciné par le Troisième Reich, érudit capable de traduire James Joyce, DH Lawrence et Büchner, anticonformiste ami d’Adrienne Monnier, condamné à mort à la Libération mais gracié, conseiller pour les affaires arabes, on en passe… Benoist-Méchin, c’est à peu près tout cela. Éric Roussel, avec son talent coutumier, décrit le parcours, sans la moindre complaisance pour un type qui, tout de même, aima Hitler et Kadhafi. Mais il explique:
«À chaque fois que je prenais le chemin de l’avenue de Clichy [où vivait Benoist-Méchin NDLR], je me heurtais à la même lancinante question: par quelle aberration cet intelligent, raffiné, cultivé au plus haut point avait-il pu, par deux fois faire fausse route au risque de se perdre ?».
Interrogation cruciale dont l’historien finit par trouver la réponse:
«Benoist-Méchin montrait un autre visage: celui d’un homme fasciné par la force. Hitler, il le cachait à peine, avait exercé sur lui une sorte d’emprise, au moins au début de son aventure. Il ne dissimulait pas non plus son admiration pour les dirigeants les plus radicaux du monde arabe».
En lisant cet ouvrage passionnant de bout en bout, le lecteur est pris sans cesse dans les rets d’une histoire incroyable mais qui nous montre aussi comme il est facile de verser dans le ravin des horreurs. Attentif à trouver la juste note – c’est le cas de le dire puisque Benoist-Méchin fut également compositeur – Éric Roussel nous tend un miroir et dresse le tableau d’une époque dont on aurait tort de croire qu’elle est vraiment révolue.
«La République vacille quand elle s’ignore»
Le murmure médiatique et littéraire à chaque instant nous le confirme: la République vacille quand elle s’ignore, quand elle néglige de respecter ses principes et surtout quand ses enfants les mieux protégés se prosternent devant la toute-puissance présumée des dictateurs.
En France, aujourd’hui, jeunes et vieux mélangés, nombre de commentateurs ou supposés spécialistes pérorent à qui mieux-mieux sur les insuffisances de nos gouvernants (et Dieu sait s’il y a de quoi faire), dénigrent la technostructure de l’Union européenne (bis repetita…), se déchainent d’enthousiasme pour Poutine et Trump. On se prend chaque jour à trouver l’atmosphère étouffante. Où se trouvent-ils, ces ardents partisans de la fraternité que l’on entendait si fort autrefois ? Que font-ils, ces aînés qui naguère prétendaient, d’autant plus sûrs de leur fait, qu’ils ne risquaient pas grand-chose: «On ne nous y prendra jamais» ? Triste abandon.
Nous avions l’âme enfantine. Tout nous paraissait un jeu. La caserne Panthémont, dans le quartier Grenelle, avec ses sous-lieutenants, n’avait d’autre existence que dans les romans. Les anciens combattants nous faisaient rire. Les filles aux longues jupes fleuries, les Rolling Stones et Vladimir Cosma – tel était l’horizon. La récréation s’achève. Nous voici tout près du mur. Il est encore temps de se choisir un chemin.
Illustration: le colonel de Gaulle présentant au président Lebrun le 19e bataillon de chars de combat à Goetzenbruck en Lorraine le 23 octobre 1939 (Service Cinématographique des Armées).
(1) Éric Roussel et Frédéric Turpin (dir.), Histoire de la Ve République 1 (1958-1981), Bouquins, 1220 pages, 32€.
(2) Frédéric Turpin, Pierre Messmer, Le dernier gaulliste, Perrin/Ministère des Armées, 2020, 448 pages, 25€.
(3) Éric Roussel, Jusqu’au bout de la nuit, Les vies de Jacques Benoist-Méchin, 1901-1983, Perrin, 406 pages, 24,90€.





