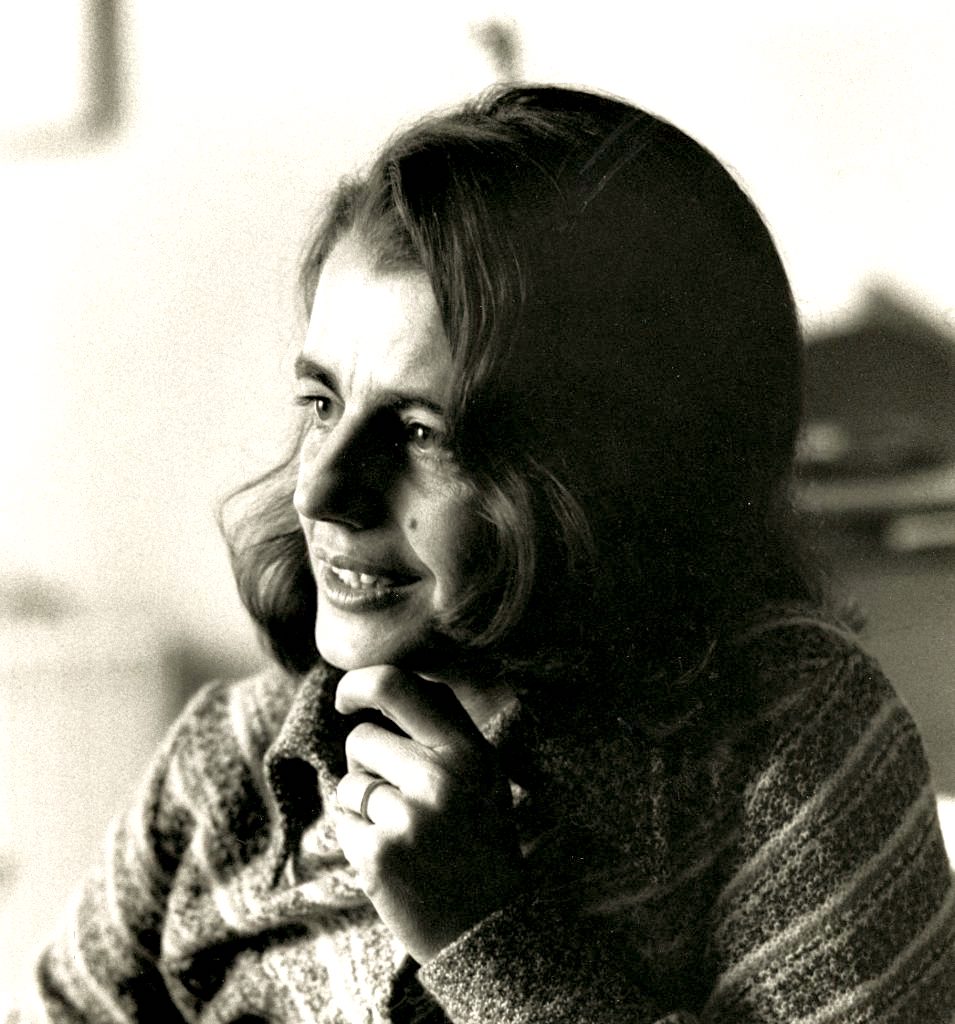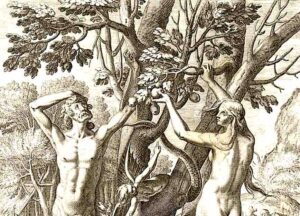L’éthique aimante de France Quéré
«L’amour comme motivation éthique, et peut-être même davantage comme fondement anthropologique» est «présent de façon constante, mais multiforme dans ses démonstrations». À l’occasion d’une journée d’études et en avant-première d’un numéro de Foi&Vie sur France Quéré, Caroline Bauer souligne la cohérence d’une entreprise de «refondation».
Journée 1995-2025, France Quéré aujourd’hui: une foi vive, une pensée libre, le 28 novembre 2025 à l’IPT Paris.
Introduction
Quelle force se dégage donc de la réflexion éthique de France Quéré ? Quel intérêt a-t-elle suscité auprès de groupes des plus divers pour être autant appelée pour des conférences sur des questions éthiques et bien d’autres encore ? Quelle pertinence lui a permis une telle longévité au Comité consultatif national d’éthique ? Et tant d’hommages respectueux sur la profondeur de sa pensée, après sa mort ? Ces questions nous habitent trente ans après sa mort. Elles sont à l’origine de notre engagement pour la constitution de ce dossier. Non pour s’accrocher à un passé révolu, mais dans le but de dégager les traits toujours pérennes de sa pensée, susceptibles de nourrir nos éthiques d’aujourd’hui. Un programme de travail s’ouvre pour les années à venir. Car ses écrits sont divers et éclatés, pour beaucoup plus journalistiques que systématiques. Volontiers elle laisse éclater la vivacité du trait d’inspiration. Elle questionne, remet en cause ce qu’elle décèle comme des enfermements dans des systèmes clos, à courte vue. Souvent elle puise dans un parcours historique le souffle qui fera éclater les cadres. Elle ouvre des champs et déplace les problématiques, les soumet au souffle de l’Évangile. Chaque thème traité est un parcours de questionnement cherchant à redire et à redéfinir nos réelles libertés et responsabilités.
À travers tous ces parcours, il y a plus qu’une cohérence de méthode. Son éthique est articulée sur des convictions qu’elle a rarement présentées sous forme systématique. Parmi celles-ci, une m’a toujours séduite: c’est l’amour comme motivation éthique, et peut-être même davantage comme fondement anthropologique. Le thème apparaît dans tous ses livres. N’ayant pas connu France Quéré, c’est par la lecture de quelques-uns de ses ouvrages que je l’ai découverte. L’amour est présent de façon constante, mais multiforme dans ses démonstrations. Il n’est pas seulement une raison d’agir, il est un socle pour ordonner ses choix, pour saisir le sens de sa vie. Quels autres auteurs permettent d’articuler une éthique rigoureuse sur le caractère originaire, fondateur, et créateur de l’amour, tout en conservant à l’amour son mystère, son caractère inclassable et insaisissable, et sa fragilité ?
Peut-être vais-je trop vite à une conclusion. Modestement, ce travail tente d’en dresser un premier tableau. Il est incomplet. Il s’appuie sur quelques ouvrages choisis parce que fondateurs pour une éthique universaliste : c’est une forte limite. Car si l’amour est partout chez France Quéré, il prend une place considérable dans son éthique familiale, dans son exégèse, dans sa lecture des Pères. L’angle ici privilégié est le rapport anthropologique à l’amour et ses implications pour l’élaboration de principes éthiques. Dans un travail ultérieur, il faudra encore laisser parler l’amour maternel, il a beaucoup à dire pour notre auteure. Et l’amour du Christ, bien sûr…
Dans son premier ouvrage, Le dénuement de l’espérance, publié en 1972, elle en appelle, à la suite d’un examen critique de la société de l’époque, à la définition d’une nouvelle anthropologie, et à une reformulation des raisons d’agir. L’amour y apparaît comme une condition de possibilité de la liberté. Nous commençons par une synthèse de son raisonnement.
Dans Au fil de l’autre, publié en 1979, elle définit l’amour dans les relations sociales ordinaires. Elle y développe l’impact fondateur de la reconnaissance de l’altérité. Ce sera notre seconde partie.
Enfin nous pourrons restituer la construction plus systématique d’une éthique aimante à laquelle elle aboutit au moment de ses travaux au CCNE. Trois ouvrages en rendent compte : L’éthique et la vie (1991), et deux recueils posthumes rassemblant diverses contributions : Conscience et Neurosciences et L’homme maître de l’homme, publiés en 2001.
La crise anthropologique: le dénuement de l’espérance, et le renouement de l’amour
L’objet du livre Le dénuement de l’espérance est d’analyser la crise de foi que traverse la société des années 1970 et d’interroger la corrélation avec ce que l’opinion nomme généralement , selon France Quéré, une «crise de civilisation».
Or cette crise est avant tout anthropologique pour notre auteure. Bien sûr la société a été transformée par l’avancée extraordinaire des sciences et des techniques. La donne en est changée. Le politique s’en saisit pour réduire l’indépendance des scientifiques. Ces nouveaux pouvoirs suscitent des peurs :
«Attila, dit-on, désherbait sous ses pas ; mais aujourd’hui l’État le plus innocent saccage, extermine, nivelle la nature, et dans les laboratoires, la matière se transmue en énergie et l’énergie en matière. Ces métamorphoses n’ont sans doute pas peu contribué à creuser le fossé entre les générations» (1).
Des mœurs nouvelles en sont nées. La société industrielle amène «ses lois, ses principes, ses structures et presque sa morale» (2). L’aliénation s’étend de l’économique au politique et au scientifique :
«Car avec ses outils, elle impose ses méthodes et sa finalité ultime, toutes réalités qu’un mot exprime : l’abstraction. Par abstraction, j’entends une perte des solidarités conjuguées au massacre de l’intime» (3).
La relation à soi, et la relation aux autres sont profondément abîmées par ce règne de la technique. L’être humain est changé, marqué, abîmé, fragilisé.
Notons qu’elle ne condamne pas la science en tant qu’avancée de la connaissance, ni même l’avancement des techniques en tant que tel. Dans L’éthique et la vie (4) elle s’attache à démontrer la nécessité de laisser la science avancer à son train. En revanche les progrès requièrent le débat éthique. Citant Jean Bernard, professeur de médecine et premier président du Comité consultatif national d’éthique, elle affirme: «Ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique» (5).
L’homme est abîmé. Ses critiques prennent alors des accents elluliens, sans se référer à lui pour autant: la pénétration de la technique dans la vie crée une dépendance, qui restreint la liberté et éloigne la conscience de la responsabilité. D’ailleurs la conscience du péché personnel s’efface, au profit d’un insaisissable péché historique.
Elle condamne le gigantisme technicien qui, agglutinant les personnes, les éloigne de leur voisin et les sépare les uns des autres: «Le prochain, on le souffre, à condition qu’il ne se fasse pas trop proche. Passée la borne, la sympathie se précipite en ignorance glacée ou en brûlante colère» (6).
Les masses, les flux organisent la vie de la cité: «Aime-t-on l’homme que l’on ne rencontre pas ? L’amour tolère-t-il l’abstraction ?» (7). C’est l’individu libre qui s’en trouve nié. Liberté et singularité sont «deux traits bannis de cette civilisation» (8).
Les moyens de communication, sensés rapprocher les hommes et favoriser les échanges, ont vu leurs effets détournés. Plutôt que de susciter la compassion, la violence et les catastrophes dévoilées massivement aux regards suscitent l’indifférence, et la nécessité d’oublier, «cuirassant les consciences» au lieu de les éveiller.
Elle critique enfin le caractère insatiable du désir soutenu par la société de consommation, qui n’a de perspective que de grandir sans limite, jusqu’au gaspillage… La technique est selon elle fille de la richesse, et engendre l’oisiveté, l’ennui, la recherche de nouveaux plaisirs. Un tableau qui ne porte aucune proposition de sens…
Pourtant France Quéré ne s’arrête pas à ce sombre diagnostic. Elle renverse le tableau. Sa critique sociale est dialectique. En effet, «le monde donne-t-il l’impression d’une tristesse profonde ?» (9).
Elle contrebalance son volet critique en détaillant ce qu’a apporté l’accroissement des richesses et le développement technique: santé, qualité de vie, travail, élévation du niveau des connaissances, plus grande égalité sociale, exigence accrue de la pensée scientifique. Elle cite en exemple la ville qui, critiquée pour son gigantisme et par l’anonymisation et l’indifférence qu’elle entraîne, n’en n’est pas moins fascinante de beauté, donne un sentiment de force et détient une capacité de cohésion: «La cité moderne offre, en vérité, un prodigieux spectacle où la beauté le dispute à la puissance» (10). Qu’est-ce qui permet ce puissant dynamisme ? pour France Quéré, c’est la foi, une foi athée, mais une foi. Cette foi est imagination, créativité, énergie qui projette vers l’avant. Nous avons-là un trait fondamental de la compréhension anthropologique proposée par notre éthicienne: l’humain est un être de liberté et de responsabilité, animé par la foi, qui le pousse en avant, le rend capable de sortir de lui-même… et cela est toujours vrai.
C’est même la foi chrétienne qui a historiquement donné l’impulsion à cette tension en avant vers un progrès toujours plus avancé. «La foi chrétienne a créé la verticalité ignorée du monde antique» (11). L’histoire se fait avec elle «mouvement et signification» (12). Mais la foi ancienne, orientée vers le passé, s’est laissée dépassée par une foi nouvelle tournée vers l’avenir, qui a emprunté cette dynamique du changement et du progrès et met toute son énergie à la métamorphose du monde. Or celle-ci n’a pas besoin de Dieu, tout y est fait de main d’hommes. «La technique a expulsé Dieu du circuit de l’efficacité» (13).
Elle se demande alors: d’où vient la véritable crise de foi ? de vérités anciennes devenues caduques ? ou bien de notre manière de l’appréhender, de façon plus libre et plus critique ? France Quéré opte pour la seconde option. Les Églises en effet ne se sont pas vidées. Le besoin est toujours là. Au fondement de la foi demeure l’angoisse qui habite l’humain devant la souffrance et la mort – et là elle parle en je:
«Tout en effet m’échappe et me le dit. Je suis un lieu de passage, le centre d’une débâcle. le battement du sang, la sourde rumeur de la vie, la fatigue des soirs, les variations d’humeur, d’appétits, les douleurs et les désirs qui me traversent, rien ne fixe mon sort, je suis l’enfant des sables et du vent.» (14).
Ce sont «des questions décisives qui ne laissent pas de harceler les hommes» (15). Complétons donc la description de l’anthropologie de notre auteure: la foi est la réponse de la liberté, libération d’une capacité d’imagination et de création face à la vulnérabilité fondamentale de l’être humain devant l’évanescence de la vie.
Face à cette angoisse, le Dieu que l’on cherche ne se découvre qu’incertain, insaisissable. La foi a un caractère dramatique qu’on ne peut plus écarter. C’est vrai depuis le début du christianisme, mais l’Église avait érigé des dogmes, des explications et une pensée morale qui permettait de tenir les croyants au dessus de cette angoisse en éliminant le tragique. Elle prenait cependant le pouvoir sur les âmes:
«La religion nous a offert ce que nous cherchions éperdument, la stabilité dans l’espace et le temps. Nous voilà au centre, nous voilà éternels. Bardés de sécurités, la vie redevient possible. Ce fantastique système de protection fit passer la finalité de l’Église d’un plan de création à un plan de conservation. Mortelle fixité» (16).
Constat d’une ossification de la parole.
Le Dieu ancien qui a été congédié par les scientifiques – mais aussi par les théologiens –, est le Dieu ordonnateur de la nature. Mais le Dieu que France Quéré appelle à redécouvrir est le Dieu qui jaillit comme «une liberté dans l’histoire» (17), qui provoque nos libertés et suscite la responsabilité (18). France Quéré reprend de Paul Ricœur l’idée d’une évolution saine d’un «croyable disponible» (19). Le Dieu de France Quéré est un Dieu continument créateur, grâce à cette liberté offerte:
«Maintenir au monde son statut de création, ce sera pour nous, comme ce l’est pour Dieu, accroître sa capacité de renouvellement. Un chrétien considère le monde comme une genèse jamais achevée. C’est ici qu’il faut s’entendre sur le mot de création. (…) Créer, pour nous, c’est manifester une opposition, introduire une nouveauté qui libère» (20).
La science a éliminé Dieu de toute explication de la vie ? Mais la foi s’accommode du dénuement, et résiste, elle seule, à la fascination de la puissance. Les ressources de la foi en Dieu ne sont pas perdues.
C’est selon France Quéré le travail de démythologisation réalisé par Rudolf Bultmann qui a permis de réveiller l’imagination indispensable à une traversée de l’épreuve de l’histoire. «L’Église redécouvre en effet une de ses tâches les plus urgentes, retrouver l’homme authentique c’est-à-dire devenir le lieu où l’humanité s’éveille à elle-même et prend conscience de ce qu’elle a de fondamentalement commun» (21): c’est là que l’amour prendra sa place comme un des fondements de l’agir.
Car il faut «retrouver le caractère événementiel de l’Évangile, avec son pouvoir de convertir l’homme et changer l’histoire» (22), accepter d’entrer dans la provocation, interroger la présence de Dieu au monde, redonner vie à l’Écriture, une place à la passion, supporter la subversion et l’entretenir, refuser le jugement qui fige et enferme, chercher «les signes prophétique d’une rupture» (23).
Elle écrit alors de belles pages sur la parole «qui dit, se dit et me dit», par laquelle la production du sens reste toujours imprévisible et singulière, sur l’écriture créatrice de sens multiples, décontextualisés, sur l’Écriture qui, nouant parole et écriture, est foyer d’invention et de renouvellement. Mais que l’Évangile soit Parole a pour elle une portée particulière. Car elle a un pouvoir d’interpellation qui me touche personnellement, me presse et m’engage. «La parole agit sur moi comme une personne, parce que l’être du Christ coïncide exactement avec son œuvre» (24).
Pourtant la parole de foi est toujours une parole fragile, multiple, contingente. Sur quoi peut-elle s’appuyer pour tenir dans la fidélité ?
L’amour entre là en jeu. La charité reconnaît la valeur inaliénable de l’autre, permet l’acceptation du don de soi et le renoncement à soi-même, parce qu’il sait sa dépendance à autrui, comme être de relations:
«L’Évangile m’enseigne que je suis en dépendance : créé d’abord, sauvé ensuite, interpellé toujours ; mon sort est totalement aux mains d’un autre, je ne puis disposer de mon être, me vouer à moi-même. Cette condition de dépendance me contraint à nouer mon existence à autrui ; elle me fait exister, multiple, dans une pure relation, qui est le signe de ma foi, du kérygme que je n’exprimerai jamais autrement. C’est pourquoi la foi peut être vécue dans le silence des pensées et des paroles ; des actes, jamais» (25).
On peut comprendre que l’amour seul permet de supporter dans la durée le dénuement de la foi, et le caractère impuissant de l’action humaine.
Et tout autant par l’espérance:
L’espérance répond à notre souffrance d’un monde en perte de sens, luttant contre la nécessité, les déterminismes et l’absurdité. Ce sont ces maux que nous nommons aujourd’hui le mal. Le chrétien confesse un Dieu de grâce, qui nous libère des déterminismes et ouvre à la liberté. Il nous libère du désespoir:
«Croire nous tire de l’étroite province du présent, autrement dit ‘des corps et des états de choses’ pour nous projeter dans le mouvement cosmique, briseur des catégories et des distinctions, qui nous fait exister comme pur devenir, dans une totalité heureuse» (26).
L’amour et l’espérance sont donc deux piliers de cette foi créatrice. Grâce à l’amour, accueillant la création dans sa diversité, sa richesse et ses potentialités, mais aussi sa vulnérabilité, grâce à l’espérance qui pousse à sortir des enfermements, du jugement et des catégories, la foi devient un langage créateur qui s’exprime de manière diverse, multiple, propre à chaque contexte. Cette première œuvre de France Quéré apporte un fondement anthropologique à l’amour, et donc universaliste, même si l’amour, dans ce texte, étaye la réponse chrétienne de la foi. L’amour est déjà la réponse à la découverte de l’altérité, un sillon qu’elle creusera tout au long de son activité d’écriture. Entrons maintenant plus précisément dans sa définition.
Une définition de l’amour dans Au fil de l’autre
Au fil de l’autre est le troisième ouvrage de France Quéré, après La femme avenir (27). Plutôt qu’un traitement systématique, il s’annonce comme une «traversée de l’humain» et de la plus grande de ses précarités: le lien d’amour «toujours prêt à se rompre»: «Je m’attacherai à cette vapeur, ce souffle, cette ombre», écrit-elle encore (28). Successivement, elle en traite dans différentes situations sociales. Nous retenons ici sa définition de l’amour dans les relations sociales ordinaires, sans spécifier le propre de l’amour familial. Pourtant plusieurs chapitres y sont consacrés, dont un à l’enfant, véritable ode à l’amour maternel. Par ailleurs, dans La femme avenir, elle a défendu la capacité aimante de la femme, par nature tournée vers l’accueil de la vie, le service et la réciprocité (29). France Quéré donnera dans toute son œuvre une valeur paradigmatique à l’amour féminin et familial. Nous savons donc faire un choix limitatif en nous concentrant sur l’attachement dans les relations sociales. Mais la manière dont ces deux amours, familiaux et sociaux, se conjuguent ou s’opposent ouvre un champ de questionnement trop large dans le cadre de ce premier travail. Restons donc sur l’amour universel.
Elle en donne d’emblée une définition générale, manifestement marquée par la pensée d’Emmanuel Levinas (même si elle ne le cite pas dans cet ouvrage). Entre l’autre et moi, il y a toujours une distance infranchissable, comme un «fond obscur» inatteignable en l’autre.
«L’amour connaît et respecte cette distance. Mais il en exorcise la malédiction. De cette misère, il tire le mystère. Et voilà sa puissance: il ne connaît, ni ne possède, mais de ce manque fait sa plénitude : il est la volonté de connaître et de posséder, et tient sa force de n’être que cette volonté.» (30)
Le succès de l’amour vient paradoxalement de son échec. Nourri de la passion de connaître et de posséder, il ne le peut pas, et sa frustration «augmente l’énergie, dilate l’imagination, affûte la joie, au fer de sa déception» (31). La force de l’amour vient de la puissance de l’imagination, qui vient combler les silences, et donner à l’amour sa créativité, nourrie de son incapacité à atteindre son but. On retrouve ici le lien qu’elle a institué précédemment entre amour et puissance créatrice, toujours dans le dénuement, dans le manque et frustration. Car notons que c’est un amour qui rejette toute prise de pouvoir sur l’autre et qui se forge dans l’impuissance assumée.
Si elle rappelle la stérilisation de la pensée opérée par la technique, elle refuse là encore une lecture critique unilatérale (32): l’amour se transforme mais ne disparaît pas.
Mais l’amour est combat. Elle en appelle à l’action de chacun, à son échelle, pour «conquérir les lentes dignités de l’homme» (33). Un regard jeté dans l’histoire montre que le monde n’a jamais été plus conscient de cette nécessité qu’aujourd’hui. Plus tard d’ailleurs, son action au Conseil consultatif national d’éthique sera une illustration de cette nécessité de se battre pied à pied, sur des questions complexes et ambivalentes, pour discerner dans chaque cas l’inaliénable dignité humaine.
Mais même très modestement, France Quéré invite à la prise de conscience individuelle des potentialités de rencontre avec la personne ordinaire, banale, médiocre que l’on côtoie et qu’on ne regarde pas, celle qui effectivement, généralement, nous est indifférente. Elle en appelle à une conversion personnelle, mot qu’elle n’emploie pas, mais qui résume l’analyse originale qu’elle propose de la parabole du bon samaritain. Elle écarte avec humour l’idée que cette parabole nous inviterait à aimer son seul proche (ce serait trop étroit), le souffrant (ce serait injuste et orgueilleux), tout le monde (l’amour se dilue à tenter d’aimer tous) ! Alors ce retournement bien connu de la question du prochain par Jésus (34) invite selon elle à prendre d’abord soin, non d’abord pas d’un blessé sur la route, mais de soi-même, pour apprendre à se faire le prochain de l’autre et à mettre sa liberté au service d’autrui. Ce qui signifie que l’amour ne relève pas d’émotions (elle ne relève pas l’émotion du samaritain mentionnée par Jésus en Luc 10,33), mais il est une conversion de la volonté. Aimer, c’est vouloir aimer, mais ce vouloir se construit, s’enracine dans un soin apporté à soi-même.
Naît ainsi la possibilité de la bienveillance, terme qu’elle préfère pour les relations sociales en général au mot amour «un mot trop emporté; et curieusement, il est absent de cette longue parabole» (35). Voici la définition qu’elle en donne:
«Consistant d’abord en une aptitude intérieure, elle ne se laisse pas démonter par le nombre. Elle a fait le tour des horizons ; elle a vu, entendu, voyagé. Elle est revenue de ses périples en ramenant une indulgence dépourvue d’illusion. Elle ne cède pas, comme l’amour, à l’envoûtement, et rêve assez peu. Elle se souvient : elle a pris la mesure de l’homme. Elle ne s’embarrasse pas de le juger, car le jugement est une activité arbitraire, esclave des préjugés ou des passions ; elle préfère se rendre utile. Comme elle garde sa tête, elle opère avec méthode ; elle prévoit et elle pourvoit» (36).
La bienveillance est donc une attention à autrui fondée sur l’expérience humaine. Elle est raisonnable, ne s’emballe pas dans l’illusion. Elle refuse le jugement, par expérience. Elle est sagesse, fondée sur la mémoire et la prudence. Elle est effectivement détachement de soi-même pour s’attacher aux pas de l’autre.
Mais, demande notre éthicienne, pourquoi faut-il cette bienveillance ? Comme souvent pour chercher un enracinement, elle revient aux Pères de l’Église. Ils n’évoquaient pas l’amour du prochain. À cette époque, les relations étaient de deux types : la famille ou les proches, des relations très codifiées, et l’étranger, figure qui devient fascinante. Car l’étranger est l’inconnu qui révèle un monde ignoré. Il est le voyageur (homo viator, disait saint Augustin) à l’image du chrétien voyageur sur la terre. L’étranger est alors porteur d’une vérité sur l’homme:
«Il incarne notre errance, l’incertitude de nos projets.(…) ce voyageur qui a frappé à la porte et que le matin effacera à l’horizon, c’est l’homme mis à nu. Et la question se pose: qu’ y-a-t-il entre deux hommes quand il n’y a rien ? Et la réponse vient : il y a tout» (37).
D’abord l’étranger venu d’ailleurs, c’est soi, dépouillé chacun de ses caractères particuliers. Mais c’est aussi le Christ, venu rencontrer l’homme, et en faire l’unité. C’est aussi celui dont je deviens solidaire dans l’accueil d’une commune humanité.
«Alors, l’autre n’est plus le seul voyageur. Il m’a donné l’occasion, venant chez moi, d’aller chez lui. Il m’invite à un autre voyage, qui est la symétrie spirituelle de sa marche sur les chemins de pierre. Le commandement s’éclaire encore “Tu aimeras ton prochain comme toi-même”. Comme s’il était toi : la métaphore indique ce déplacement auquel l’hôte est convié. Lui qui ne bouge pas, lui ne fait qu’ouvrir sa porte, lui l’homme de la stabilité, va se faire nomade. La métaphore du commandement est une invitation à la métamorphose. Elle fait monter l’hôte vers celui qu’il reçoit. Marche physique ici, démarche métaphysique là. Il a franchi les limites de l’apparence ; le voici au cœur de l’essence.» (38)
La bienveillance est cette reconnaissance d’une humanité commune qui accueille attentivement l’autre comme un autre soi, mais qui, conscient de l’altérité qui les sépare, accepte de se décentrer de soi pour aller vers l’autre. Il prendra indifféremment dans sa systématisation ultérieure d’autres noms : celui de compassion ou de sollicitude.
Le sujet pensant est un sujet aimant
Après sa nomination au Comité consultatif national d’éthique, à sa création, France Quéré s’est trouvée confrontée à l’exigence d’un dialogue interdisciplinaire sur les enjeux éthiques que posaient les progrès des sciences du vivant. Médecins, biologistes, juristes, philosophes, représentants des familles spirituelles, chacun apportait sa pierre à la proposition de limites acceptables aux pratiques médicales. Dans ce cadre, elle s’est particulièrement attachée à définir les repères nécessaires à la défense de la liberté du sujet, face à l’objet sur lequel opère la science, corps, cerveau, embryon… Comment rendre compte de la dignité d’une personne humaine si le cerveau, par exemple, n’est qu’un organe dont le fonctionnement est explicable par des lois physico-chimiques (39) ?
C’est ainsi qu’elle propose une définition du sujet en deux volets articulés, le premier est classique, kantien, auquel elle ajoutera de façon originale le volet de la sollicitude. Déroulons son raisonnement.
Elle s’attachera d’abord à défendre la dignité absolue de l’être humain, en tant que sujet capable de se distancer de l’objet qu’est le cerveau, de reconnaître à l’esprit sa capacité à s’élever au-dessus de l’objet pour en devenir principe de connaissance. Alors le sujet peut poser un je capable de se distancer de son moi (caractères observables de sa personnalité). Cette dignité est reconnue par tous au Comité et est exprimée par le second impératif kantien: «Agis de façon telle que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme fin, jamais simplement comme moyen» (40).
L’autoaffirmation de soi comme je est associée à une capacité d’établir la norme nécessaire pour choisir le préférable, toujours en rapport permanent avec autrui. Elle fonde une liberté, mais aussi le principe d’une moralité. La conscience est ainsi définie comme le cœur du sujet:
«Qu’est-ce que la conscience ? Une structure dialogale, où se continue la conversation intérieure de soi à soi. Nous sommes en nous-mêmes une multiplicité de voix qui s’échangent comme dans les jeux de l’orchestre. Ce qui est proprement la liberté. Mais une liberté au sens le plus haut du terme et qui change son nom en celui de moralité, ou forme normée de la liberté. Car la liberté est dans le pouvoir de faire quelque chose de soi et la moralité est de choisir entre ces possibilités, celle qui paraît préférable. Ce choix suppose la capacité de juger et de se juger, c’est-à-dire, j’y reviens, d’être à la fois soi-même le sujet et l’objet. Comme elle se fourvoient, les sciences qui réduisent toute la conscience à un pur objet, comme se fourvoie aussi l’erreur symétrique de l’idéalisme qui ne capte en elle qu’un pur sujet ! C’est, dans les deux cas, nier et la liberté qui repose sur la pluralité intérieure, et la moralité qui installe dans cette démocratie la législation magistrale» (41).
Une fois ce cadre posé, France Quéré introduit une dimension supplémentaire de croissance à travers le temps, en raison du caractère inchoactif de la vie humaine. Or c’est présupposer l’amour. L’être humain est en effet un être en constant devenir. Le processus d’apprentissage qu’il entame en naissant jamais ne cesse. L’être moral se construit à travers les expériences de la vie, se forge face aux nouveautés, à la nécessité d’adaptations et de dépassement. Le critère de respect de toute personne ne suffit alors plus. Car «il ne comble pas l’inquiétude native de l’esprit» (42). Il faut introduire l’exigence de l’amour:
«La morale qui s’ensuit est plus subtile qu’un impératif catégorique, et bien plus proche de l’amour que de la connaissance; un enfant ne peut parler si on ne lui parle pas, il ne peut aimer si on ne l’aime pas; il négligera son corps si sa mère par ses caresses ne le lui rend pas aimable; il n’appellera pas si lui-même n’est pas appelé. Il ne répondra pas s’il ne lui est pas fait réponse. Il ne sera pas mis au jour sans ce second enfantement de la culture. Et ce qui est dit de l’enfant peut être dit de la personnalité en tous ses âges, puisqu’en ce sens, elle est toujours dans des temps de croissance. Les vieilles sagesses déjà célébraient, par-delà tout respect, la puissance de la parole, du regard et du visage, où se signifie qu’une altérité précède toute identité et l’intronise» (43).
Il faut donc compléter l’humanisme classique, fondé, dit-elle, sur «l’Apollon du Belvédère et sur le cogito de Descartes» (44) et auquel manque la prise en compte de la vulnérabilité et de la souffrance. Les expériences des totalitarismes, les atrocités guerrières du 20e siècle, mais aussi l’extension des connaissances médicales qui permettent d’accompagner la vie de personnes inconscientes ou potentielles, obligent à repenser le sujet à partir du corps souffrant et dépendant:
«Exposé, fragile, dépendant, à la merci des autres, tel apparaît l’humain. Faible par nature, puisque mortel; faible historiquement, puisque livré aux moyens démesurés de la destruction; faible religieusement, puisque dépouillé de ses croyances; faible biologiquement, puisque longtemps soumis à l’inconscience et à la dépendance» (45).
Ainsi le premier tableau présentant la dignité du sujet est-il à compléter d’un second volet, dont France Quéré développe l’argumentation en 1991 dans un article publié dans la revue Autrement (46). L’a-t-elle exposée aussi au CCNE ? je ne sais, mais elle en reprendra la substance dans son livre de synthèse L’éthique et la vie (47).
Elle déploie une éthique de la sollicitude qui s’élève en quatre niveaux successifs jusqu’à la métaphysique:
• Au premier niveau, le soin matériel de la vie, car comme la pensée dépend de la santé du corps, la première exigence est de nourrir et de protéger ce dernier de ce qui le menace, le froid, la maladie, etc. «Toute éthique aujourd’hui est bioéthique.» (48)
• Puis la prise en compte de l’autre faible, comme la veuve, l’orphelin. Cette relation est asymétrique: je me vois au cœur du monde, l’autre est en périphérie, son visage me supplie de l’aider. Dans une référence explicite à Emmanuel Levinas, l’autre m’appelle à être son bienfaiteur. Je deviens son obligé.
• Mais ce premier rapport d’obligation ne peut se penser sans un troisième niveau. Car l’éthique n’est pas fondée seulement sur la miséricorde. Elle l’est aussi sur la découverte de la grandeur de l’autre. Nous nous reconnaissons aussi débiteurs de tous ceux qui nous ont aidés à grandir, à nous développer, à la société qui transmet sa culture.
«Ce n’est donc pas la seule faiblesse d’autrui qui inspire nos devoirs éthiques, c’est la grandeur d’une dette dont nous nous déclarons insolvables, puisque nous ne rembourserons jamais qu’une infime partie de ce qui nous a été alloué. Tel est le troisième volet éthique: la reconnaissance envers autrui nous fait obligeants, parce que nous vivrons toujours en obligés.» (49)
• Quatrième volet: L’autre me révèle aussi une qualité d’être encore supérieure à ce dont je peux moi-même me témoigner. La rencontre avec l’autre me dévoile la nouveauté et la beauté de la rencontre avec un être qui me provoque, me déplace et révèle l’être mieux que moi-même.
«L’autre paraît devant moi dans l’éclat d’une révélation, et je dirais presque d’une théophanie, en son mélange inexprimable de grâce et de secret entrebâillé: il surgit comme une liberté imprévue, sans complicité avec mes pensées, étranger à leurs efforts, brillant de la gratuité même de l’esprit. Bref, il me surprend.» (50)
France Quéré évoque la discrète apparition d’une transcendance dans ce mystère de l’autre, un dévoilement de l’être qui fait signe vers un infini ou un absolu. Il est vrai que dans la tradition judéo-chrétienne, l’amour pour Dieu et l’amour pour le prochain ne forment qu’un seul commandement. Elle en exprime ici la continuité tout laissant l’interprétation ouverte à la pluralité.
Les trois principes de la délibération éthique: la prudence, l’obligation, et la compassion
La dignité du sujet est ainsi redéfinie en associant sa capacité de conscience et sa nature aimante. L’une et l’autre sont indissociables. On retrouve plus clairement structurés les fondements posés dès 1972. Mais reconnaître cette dignité ne donne pas encore de moyen de bâtir un consensus sur le préférable dans une société pluraliste et pluridisciplinaire. Car au CCNE revenait d’effectuer ce travail d’évaluation subtile, pas à pas, au gré des cas rencontrés, souvent complexes, et quelquefois ambivalents. Il reste donc encore à proposer des principes qui puissent régir la délibération commune. Selon l’expérience qu’elle relate d’ailleurs, la délibération ne consistait pas à discerner entre les membres du CCNE celui ou celle dont l’avis devait l’emporter. La scission et le doute sont internes à chacun: «La bioéthique n’est pas simple et rarement il lui échoit de combler l’esprit» (51).
Dans L’éthique et la vie, elle propose une trilogie de critères dont l’amour est le troisième terme. Ces trois principes lui paraissent nécessaires et suffisants pour l’élaboration pas à pas d’avis ou d’actions respectant la dignité humaine. Elle les développe dans cet ordre:
• Un principe de prudence: comme le cadre de la décision est toujours changeant, complexe et incertain, il faut d’abord s’attacher à la prudence aristotélicienne, une excellence qu’elle qualifie d’«attention au réel», de «délibération savante», d’«habileté au service du bien» (52).
• Un principe d’obligation: La loi est fondatrice d’une humanité commune. Elle modère la violence et s’impose à tous de façon égale. Elle est impersonnelle et a-contextuelle. Pourtant, France Quéré préconisera toujours de légiférer le moins possible, seulement pour éviter les abus, la bioéthique étant toujours fluctuante et les situations toujours singulières.
• Enfin un principe de sollicitude ou de compassion. En effet, la démarche prudentielle et la loi doivent être complétées par le regard sur l’homme réel, et donc par un principe de compassion.
Nous ne développons pas ici leur articulation, seule la compassion intéresse notre enquête. Mais il faut noter leur complémentarité:
«Sans la loi, la morale est aveugle; sans la pitié, elle est rigide; sans le calcul, elle est impuissante ou nocive. Les trois éléments sont toujours en tension; ils assurent justesse, justice et ajustement devant la maladie et la douleur. Dans cette structure dialogale, qui fait entrer l’intelligence, le jugement et la miséricorde, s’accomplit le grand travail de patience et de compromis où se reconnaît modestement le souci de l’homme» (53).
Après le jugement prudentiel, après le jugement normatif, vient donc l’évaluation compassionnelle, c’est à dire la confrontation à la singularité de la personne souffrante. Le médecin est l’incarnation de cette sollicitude, Hippocrate le modèle. Le médecin se trouve face à la douleur, il n’apporte pas d’explication, il ne juge personne. Il est interpellé par tout corps souffrant, sans distinction. «Sa compassion se veut foncièrement opératoire» (54). Il est seul face à son patient. «Le prochain est [son] décalogue, (…) il n’en a pas besoin d’autre» (55). Il s’ajuste aux personnes, toutes reçues dans leur situation singulière:
«Il y a, dans la sollicitude, une éternelle première fois, comme dans l’amour: elle en est proche. L’attention est la même, qui s’arrête soudain sur un seul être, également inaugural et conclusif d’un monde» (56).
Chaque situation étant singulière, le discernement éthique est relancé à chaque rencontre. Et l’on sait que le rôle du médecin peut aller au-delà même de la pratique opératoire. France Quéré cite l’exemple de la décision d’un éventuel avortement suite à un diagnostic prénatal. L’information technique donnée au couple ne suffit pas à la décision. Les gynécologues témoignent d’une question qui leur est souvent retournée: «Docteur, que feriez-vous à notre place ?», preuve pour France Quéré qu’il faut encore accompagner la décision jusqu’à l’élaboration du moins déraisonnable, pour ne pas que la culpabilité pèse d’un poids insupportable.
Cette dimension de compassion de l’éthique n’est jamais suffisante, mais elle en est pour France Quéré «le plus beau visage» (57). Sa proposition, là encore, est universelle, mais en conclusion de L’éthique et la vie, elle évoquera la responsabilité particulière des croyants d’appuyer ces principes éthiques tant qu’ils assurent le respect de la liberté et de la solidarité. Car pour eux ces critères sont enracinés dans un projet plus vaste, celui d’un Dieu de miséricorde qui accompagne l’humain et suscite des espaces de liberté au sein même de ses enfermements.
Conclusion
Charles Blanchet (58), prêtre cordelier et ami de France Quéré, écrit quelques mois après sa mort:
«Vous a-ton assez remerciée d’avoir publié L’éthique et la vie ? Ce n’est pas sûr. Pourtant les derniers chapitres peuvent être considérés comme une sorte de Bible pouvant inspirer les membres du Comité d’éthique, des Églises et tous ceux qui réfléchissent à l’élaboration et l’exercice de la loi morale» (59).
Il est donc reconnu une nouveauté à sa proposition éthique, telle qu’elle est reprise dans L’éthique et la vie. Paul Ricœur la qualifiera de participation, dans une société aux croyances plurielles, à une entreprise de refondation, nécessairement aussi «co-fondation», d’un discours de la sollicitude (60).
Mais l’ensemble du chemin que nous avons parcouru nous montre qu’il ne s’est pas agi seulement pour elle d’ajouter à l’éthique une dimension de bienveillance ou de compassion, comme une sorte de supplément d’âme qu’il faudrait adjoindre à une éthique rationnelle. Elle invite plutôt, ce me semble, à une révolution, au sens propre et radicalement pacifique : au lieu de penser la personne solidement ancrée à un impératif de justice, en position de jugement, elle oppose la condition humaine de faiblesse et de dépendance. L’autre, lui-même faible, apparaît pourtant comme celui grâce à qui s’ouvriront des chemins de vie, des déplacements, des remises en cause. Cette anthropologie est toute relationnelle, et l’interrogation éthique est son moteur. La liberté morale du sujet et l’amour se répondent et s’entrainent mutuellement pour reconnaître l’effectivité d’une gratuité : une capacité à imaginer, à créer, à nommer, à débattre, à défendre la vie et ce qu’elle exige. Cette éthique est aimante en ce sens que l’amour, en tant qu’attention à autrui, nourri de sagesse, de respect et octroyant sa place au mystère de la vie singulière, est présent à l’origine, en chemin et à l’aboutissement du discernement. En rien l’amour ne s’oppose, dans cette pensée, à l’exercice de la raison. La foi est elle-même un engagement tout entier au cœur du monde, à l’écoute de ses affirmations et de ses doutes. Elle les questionne, les creuse, les déplace.
Le combat spirituel est un caractère de ce discernement. L’amour n’est pas dupe des enfermements suscités par la société scientifique et technique, mais il cherche des brèches à ouvrir. Il appelle à la responsabilité individuelle, à l’intelligence que chacun peut mobiliser dans les situations qu’il rencontre : en ce sens, l’éthique élève l’humain, tout en le prenant tel qu’il est. Cette éthique est une éthique de la non-puissance dans tous les cas. Elle peut traverser des déserts sans sombrer. Pour France Quéré, elle est enracinée dans la lecture des évangiles mais s’offre aussi, dans une société pluraliste, comme proposition pour tous. Cette éthique elle-même s’offre au débat comme une proposition de sens.
Illustration: France Quéré (photo Réforme).
(1) France Quéré, Dénuement de l’espérance, Seuil, 1972, p.27.
(4) France Quéré, L’éthique et la vie, Odile Jacob, 1991.
(6) Dénuement de l’espérance, op.cit., p.29.
(18) «La foi apparaît alors comme la jonction d’une liberté et d’une responsabilité, d’une pensée et d’une décision: elle nous jette dans ce ‘devant nous’ où rien n’est fait encore, où rien n’est à laisser faire.» (Ibid.)
(19) «Il faut enfin reconnaître que chaque époque dispose d’un segment de conviction qui lui est propre et dans lequel l’époque qui précède ou celle qui suit ne peut se retrouver: Chaque temps apporte ses réponses singulières, qui montrent que ses questions elles aussi étaient uniques.» (Ibid., p.138)
(27) France Quéré, La femme avenir, Seuil, 1976.
(28) France Quéré, Au fil de l’autre, Seuil, 1979, p.11.
(29) Cf. les belles pages sur l’accueil de l’enfant et la maternité dans La femme avenir, op.cit., pp.148s.
(30) Au fil de l’autre, op.cit., p.8.
(32) Elle critique en particulier vivement le soupçon systématique qui voit «le mal (…) partout embusqué» (ibid.,p.28), en particulier dans le développement des techniques qui instrumentalise les gens, mais sans rappeler quelle amélioration elles ont apporté. Par exemple, la critique d’Ivan Illich qui déplorait «que la répartition des compétences ait tué le secours spontané que l’on portait aux accidentés». Elle demande: «Faut-il applaudir ? la bonne volonté peut être catastrophique» (p.29). «Il n’est pas dit que la spécialisation ait malmené l’esprit d’entraide, sans doute peu florissant dans les temps révolus. (…) Et pourquoi faudrait-il imaginer que la progression des savoirs ait desséché le cœur ? Il semble plutôt que l’immense effort de la médecine émane lui-même d’une attitude de la pitié» (p.29). «La solidarité humaine, dans le réseau de ses spécialisations, a pris une autre face. Elle peut aller plus loin qu’elle n’est jamais allée» (p.30).
(34) Lorsque Jésus demande finalement au légiste: «Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ?» (Luc 10,36).
(35) Au fil de l’autre, op.cit., p.52.
(39) «Étudier le cerveau, c’est aborder la personne dans le secret de sa vie intérieure comme dans la manifestation de sa liberté. Aussi, les neurosciences, qui depuis quelques décennies examinent cet organe, semblent poser en termes nouveaux les questions éternelles: Qui sommes nous ? Matière ? Esprit ? Déterminismes neuronaux et sociaux ? Libre volonté ? Faut-il opposer le corps et l’âme, les confondre, appeler l’un réalité, l’autre illusion ou réciproquement ?» Rapport au CCNE consacré aux neurosciences, cité par Jean Bernard, Hommage à France Quéré, Médecine/Sciences 5/11 (mai 1995).
(40) Et de façon plus générique encore, la dignité de l’humain est fondée sur «sa qualité de sujet, origine, principe irréductible, réalité par soi et avant toute expression de soi», Conscience et neurosciences, Bayard, 2001, p.57.
(43) Ibid. Elle cite à l’appui de cette affirmation l’expression de Virgile, et Ésaïe 49,1 («Dès le sein de ta mère, je t’ai appelé»), ou Jean 4,10.
(46) Republié dans Ibid., pp.107‑116.
(47) Cf. L’éthique et la vie, op.cit., pp.230‑231.
(48) Conscience et neurosciences, op.cit., p.112.
(51) L’éthique et la vie, op.cit., p.278.
(58) Charles Blanchet, prêtre cordelier, né en 1923, décédé en 2003. Professeur de philosophie au collège des Cordeliers de Dinan de 1953 à 1972. Formateur à l’IFOCAP de 1972 à 1983. Collaborateur de la revue Esprit de 1963 à 1972. Collaborateur de la revue Paysans. Ami de France Quéré, il a correspondu avec elle et l’a invitée à intervenir à plusieurs reprises à l’IFOCAP.
(59) Charles Blanchet, Le visage de France Quéré, Paysans 233 (septembre-octobre 1995), p.73.
(60) Préface de Paul Ricœur dans Conscience et neurosciences, op.cit., p.11.