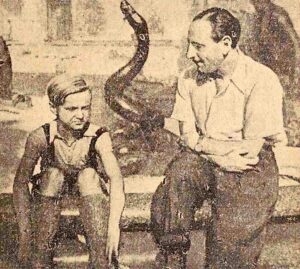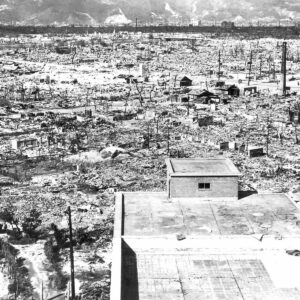Espérance pour les temps de crise: théologie du seuil (2) et « Deus absconditus »
«Le monde semble en bascule» et «le croyant n’échappe pas à cette secousse». Dans une société où «il ne s’agit plus de démontrer Dieu comme un objet de discours», comment «créer un espace où Dieu peut se donner à percevoir selon son mode propre de Présence ?». Peut-être, entre le dépouillement du Christ («kénose positive» il y a bientôt 2000 ans) et le dépouillement du sens («kénose négative» actuelle), en faisant place à une théologie du Seuil «où la manifestation divine se conjugue avec le retrait, là où la Parole se fait discrète et pourtant plus vive que jamais».
Texte publié sur Des mots en phase.
Introduction
Aujourd’hui, face aux pogroms modernes, aux guerres, aux visages de la cruauté et de l’indifférence, deux facettes de l’inhumanité, la plainte d’Ézéchias, semblable à celle des psaumes, porte nos inquiétudes et monte encore:
«Je disais: Je ne verrai plus le Seigneur (Yah), le Seigneur (Yah), sur la terre des vivants; je ne contemplerai plus aucun être parmi les habitants du monde !» (Isaïe 38,11)
C’est dans ce contexte que la Théologie du Seuil cherche à penser un espace spirituel de veille intérieure où se rencontrent la Parole, l’expérience humaine et la transformation silencieuse.
I. Le Seuil en temps de crise
Nous vivons des temps où de multiples seuils s’effritent ou se déplacent. Le monde semble en bascule. Crise écologique, bouleversements géopolitiques, mutations sociales et technologiques, effondrement des repères symboliques, fractures ecclésiales: tout concourt à faire vaciller nos manières héritées d’habiter le réel et de croire. Ce ne sont pas seulement les structures extérieures qui se défont; c’est l’intériorité même de la foi qui se trouve interrogée, comme mise à nu.
Le croyant n’échappe pas à cette secousse. Les anciennes certitudes se fissurent, les langages communs se perdent, les médiations religieuses s’affaiblissent. Les grandes réponses apologétiques paraissent souvent inopérantes face aux nouvelles formes d’incrédulité ou d’indifférence. À bien des égards, nous faisons nôtre la plainte du psalmiste :
«Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, tandis qu’on me dit sans cesse: « Où est-il ton Dieu ? »» (Psaume 42,4).
Cette question n’est pas d’abord celle de l’adversaire extérieur; elle monte du cœur même de la foi éprouvée. Elle résonne au moment précis où les signes visibles semblent s’être effacés, où Dieu se dérobe aux évidences religieuses d’autrefois. Le Psaume 42 ne propose pas une démonstration en retour, mais un déplacement: il invite à chercher la Présence non dans les signes de puissance ou de succès, mais dans la soif intérieure, dans ce lieu nu et ardent où l’âme «a soif du Dieu vivant» (Psaume 42,3).
La théologie du Seuil cherche à «rendre raison de l’espérance» (1 Pierre 3,15) (1) tout en assumant les contradictions du monde. Elle accueille le doute comme un lieu de passage fécond, moteur de transformation, d’un recalibrage du regard intérieur, dans l’esprit de Paul Ricœur et Jean-Luc Marion (2).
II. Mutation théologique: de l’apologétique à l’apophanique
Face aux bouleversements culturels et spirituels de notre époque, la théologie se trouve confrontée à une question décisive: comment dire Dieu dans un monde qui ne partage plus ses langages, ses évidences ni ses repères symboliques ? Pendant longtemps, l’apologétique a cherché à répondre à cette question en défendant rationnellement la foi, en s’appuyant sur des structures argumentatives solides et sur une culture religieuse commune. Cette démarche a eu sa fécondité: elle a permis à la pensée chrétienne de dialoguer avec la raison, de clarifier sa cohérence interne, et d’affirmer sa légitimité dans l’espace public.
Mais aujourd’hui, le terrain a changé. La fragmentation culturelle, la méfiance envers les institutions, la pluralité des convictions et l’expérience diffuse du tragique font que les discours démonstratifs peinent à rejoindre les consciences. Ce n’est pas seulement la force des arguments qui est en jeu, mais la possibilité même d’un lieu commun d’écoute et d’intelligence partagée.
Dans ce contexte, la posture apologétique classique atteint ses limites. Non qu’il faille renoncer à toute raison ou à tout témoignage, mais parce que la Vérité ne se laisse pas enfermer dans un dispositif de preuve. Elle se manifeste souvent autrement: dans la fragilité, le retrait, le silence, la soif. C’est précisément là qu’intervient la perspective apophanique.
Le mot vient du grec apophainô: faire paraître, laisser se manifester. Il ne s’agit plus de démontrer Dieu comme un objet de discours, mais de créer un espace où Dieu peut se donner à percevoir selon son mode propre de Présence. La théologie apophanique s’efforce de se tenir au Seuil, là où la manifestation divine se conjugue avec le retrait, là où la Parole se fait discrète et pourtant plus vive que jamais.
Dans cette perspective, la kénose offre une clé interprétative des temps de crise.
III. La kénose contemporaine
Le terme kénose (du grec kenoô, se vider) désigne dans la tradition chrétienne l’abaissement volontaire du Christ :
«Lui qui était dans la condition de Dieu… s’est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur» (Philippiens 2,6-7).
Cet abaissement n’est pas une perte d’identité, c’est la modalité paradoxale de la révélation divine dans l’histoire : une gloire qui se manifeste dans l’humilité et le don de soi. Cette kénose positive ouvre un espace de rencontre: Dieu se donne dans le retrait, et non dans la domination.
Mais notre époque connaît aussi une kénose négative: une défiguration de ce vide, subie et non choisie. Les guerres, les génocides, les violences médiatisées, la perte des repères collectifs ou le désert intérieur des consciences en sont des expressions. Ce n’est plus seulement la blessure de l’humain: c’est son effondrement intérieur, une vacance de sens où la parole et la dignité sont souvent confisquées.
C’est précisément dans ces espaces de vacance et de fracture que la théologie du Seuil prend tout son sens. Elle ne cherche pas à combler immédiatement le vide: elle y dresse une tente (Isaïe 54,2), c’est-à-dire un lieu d’accueil, une disponibilité à la Présence. Là où l’époque moderne ne perçoit que silence ou absence, elle invite à reconnaître un possible lieu théophanique.
Cette intuition rejoint la grande tradition biblique du Deus absconditus. Le prophète Isaïe proclame:
«Vraiment, tu es un Dieu qui te caches, Dieu d’Israël, Sauveur !» (Isaïe 45,15).
Le Dieu vivant ne se laisse pas réduire aux logiques visibles: il agit autrement, à contre-attente. Il n’invite pas à le chercher «dans le chaos» (Isaïe 45,19), mais dans une parole intérieure, juste et droite. La dissimulation divine n’est pas une carence, mais une pédagogie spirituelle: un Seuil où la foi se purifie et se creuse.
Le croyant, comme l’exilé, est confronté à l’absence apparente de Dieu et à la dérision du monde. Mais le psalmiste indique une direction:
«Pourquoi te désoler, mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu ! Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu» (Psaume 42,6).
Cette invitation à «espérer en Dieu» au cœur de la désolation marque l’entrée dans le Seuil: là où la foi n’a plus d’appuis extérieurs, elle se tourne vers une Présence cachée mais agissante. Isaïe 45 et le Psaume 42 décrivent un entre-deux spirituel où la relation avec Dieu se reconfigure dans la profondeur intérieure.
En ce sens, la kénose n’est pas seulement un concept christologique: elle devient une catégorie herméneutique pour lire les temps de crise.
La kénose négative révèle la vacance tragique de l’histoire humaine.
La kénose positive ouvre la possibilité d’une habitation divine au cœur même de ce vide.
Le Seuil est alors ce lieu existentiel où ces deux dynamiques se rencontrent, non pour s’annuler, mais pour permettre une transformation silencieuse.
Penser la Présence dans l’épaisseur tragique de l’histoire humaine, c’est déjà participer au mouvement du Salut. Là où l’absence semble régner, la foi découvre une Voix qui appelle, discrète mais tenace, ouvrant un espace de veille et d’espérance lucide.
Conclusion
Dans La Pesanteur et la grâce (3), Simone Weil écrivait avec justesse:
«L’extrême grandeur du christianisme vient de ce qu’il ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance» (p.86).
Cet «usage surnaturel» est une transformation du regard. C’est là que peut s’opérer une métamorphose silencieuse: la crise, au lieu d’être un pur effondrement, devient un lieu d’accueil, une porte entrouverte sur une espérance lucide.
Cette intuition rejoint profondément la pensée du Seuil qui cherche comment consentir à habiter les zones de vulnérabilité où le sens se dérobe. La théologie du Seuil invite à observer et à accueillir ce qui dérange l’intellect et heurte les émotions, tout en restant lucide face aux actions historiques ou individuelles. Ce n’est ni une neutralité ni une fuite. Il s’agit d’une ouverture intérieure, d’un sursaut éthique né de la veille, d’un renoncement à l’illusion de maîtrise et au jugement absolu.
Alors là où toute maîtrise échoue, une autre possibilité s’ouvre: celle d’un discernement silencieux de la Présence qui demeure quand tout le reste faillit.
Illustration: le Ras es-Safsafeh (mont Horeb ?) au dessus du monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï (photo Esben Stenfeldt, CC BY 3.0).
(1) «Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, le Christ, étant toujours prêts à rendre raison de l’espérance qui est en vous, devant quiconque vous en demande compte» (1 Pierre 3,15 LSG).
(2) Paul Ricœur a souvent insisté sur la fécondité herméneutique du doute, notamment dans Le Conflit des interprétations et La Symbolique du mal, où la foi n’est pas l’opposé de la fragilité mais son dépassement narratif. Jean-Luc Marion, de son côté, a développé l’idée d’un excès de sens irréductible à la maîtrise conceptuelle, en particulier dans Dieu sans l’être et Étant donné.
(3) Simone Weil, La Pesanteur et la grâce, Plon, 1962.