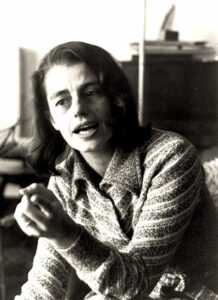L’aventure chrétienne / homme et femme
«Cette idée folle que l’autre qui est le plus loin de moi est aussi le plus près»: dans cette conférence de la fin 1981, France Quéré relit «l’aventure chrétienne» sous l’angle du couple et de ses faux-semblants (vus d’ici). Après avoir examiné ce que l’on en peut savoir dans la Bible où «homme et femme représentent deux mondes, étroitement séparés, qui incarnent les deux modalités de la vie», elle ébauche à partir de la dualité différence/similitude posée par Jésus une «éthique du vis-à-vis» dont les «trois articles» sont «l’équité, la responsabilité, le mystère. L’amour ne joint-il pas ces trois exigences?».
Conférence prononcée au temple d’Auteuil lors du cycle L’aventure chrétienne organisé en novembre-décembre 1981 par Michel Leplay et publié dans Foi&Vie 1983/1 (et avec aussi des conférences d’André Mandouze, André Dumas et Jean Delumeau).
Le couple, comme les grands événements qui rythment ou brisent le cours des civilisations, traverse l’histoire sur le mode d’une aventure perpétuelle. Il n’est pas seulement l’humble refuge nous maintenant à l’abri des tempêtes qui fouettent la grand rue. Il ne représente pas l’éternelle paix de la vie privée et l’unique amour de l’homme et de la femme.
Il est le reflet de la vie publique, qui lui impose ses codes, ses mœurs et jusqu’à ses conflits. Il est, en un sens, la miniaturisation de la société entière et regarder le couple d’Isaac et Rebecca c’est considérer la nation juive elle-même. Regarder Tristan et Iseut c’est apercevoir l’exigence et la foi du Moyen Age. Aujourd’hui, comment se nommerait le couple symbolique de notre société ? La plupart sont des couples si éphémères que les deux prénoms ne restent pas longtemps accolés ensemble. J’en forge donc un qui me semble expressif des revendications de notre temps; cela n’évoque en rien Roméo et Juliette. Ce serait le couple formé par Chirac et Laguiller. Rien, en somme, qui suggère un art poussé de la galanterie.
Or je voudrais montrer ici qu’il y a en réalité deux histoires du couple et qui ne sont pas, quoi qu’elles s’opposent fort, sans connexions souterraines, sans se rejoindre par d’épais filaments. Il y a la tradition visible, sociologique qui fait qu’une famille du 4e siècle ne ressemble pas à une du 18e et puis en dessous il y a une autre logique qui court et qui plonge dans une réalité différente, touchant à l’être lui-même, entendez qu’elle se déroule sur le mode philosophique et spirituel, qu’elle échappe ainsi partiellement aux influences circonstancielles de l’histoire et poursuit un autre récit que nous essaierons d’élucider.
Injustice et tradition du couple
Mais revenons à la surface, et fixons deux points dans le temps: l’époque du Christ et la nôtre. Peu de ressemblances.
Le couple du 1er siècle nous apparaît comme fort peu enviable. Historiens et exégètes nous décrivent dans la cellule familiale un chef d’œuvre d’injustices. L’homme détient tous les pouvoirs. La femme n’en dispose pratiquement d’aucun. Lui règne dans la cité, où il est seul acteur; dans la religion, dont il est seul gestionnaire, et même dans la vie privée, où l’intégralité des droits lui revient (se marier, divorcer pour n’importe quel motif, avoir des enfants, prendre des concubines, pratiquer la polygamie). La femme est exclue de toute vie publique. Le récit de la Genèse voit en elle une créature seconde, faite pour servir l’homme et une nature coupable, dont découle le malheur de l’humanité. Deux raisons de la dispenser de toute autorité. Sa dépendance est totale, et son humiliation se poursuit jusque sur les bancs de la synagogue, où elle est tenue à l’écart de plusieurs commandements. Dans son foyer, elle n’est qu’une servante soumise, recluse, séparée des appartements de son mari; du reste mariée à qui son père a voulu, sans possibilité de choix ou de connaissance préalable.
Son mari attend d’elle des fils en abondance. La stérilité est un opprobre, l’enfantement des filles une insuffisance. Elle ne sort pas, sinon dûment voilée et accompagnée et n’a bien entendu aucun rôle dans la vie politique de sa nation.
Telle est la situation de la Juive, dont il reste encore aujourd’hui des résidus dans des droits non reconnus ou des prières misogynes. À quelques détails près, ce tableau n’est pas foncièrement différent de celui que nous dressons pour nos propres sociétés, celle du siècle dernier en particulier, avant le grand assaut féministe.
Cependant, ces descriptions pessimistes semblent entachées de militantismes. Quand je dis militantisme, je veux dire que le souci de la vérité historique passe à l’arrière-plan. La réalité est déformée pour les besoins de la lutte actuelle. Or cette réalité dérive de l’autre tradition, dont je parlais tout à l’heure, et qui est l’âme invisible du couple, ou si l’on veut, cette extraordinaire santé que le couple oppose aux rigidités des coutumes sociales. Je me méfie en effet de ce ménage qui serait un tel scandale de contraintes, d’abus, de sentiments meurtris. Je crois qu’il n’existe que pour une fraction de la société, qui, hélas, est sous-développée, grossière, mal dégagée du primate. Mais qu’il représente la vérité moyenne de la conjugalité, j’en doute fort, et avant de dire pourquoi, je détourne mon soupçon sur ceux qui professent ces opinions sévères. Un certain nombre d’entre eux sont remplis soit de pieuses pensées soit de zèle révolutionnaire, soit les deux à la fois. Ils veulent nous démontrer que Jésus a jeté la révolution parmi les usages iniques, ce qui augure bien de sa qualité de fils de Dieu. On scrute l’évangile et on s’émerveille que dans cette société dont on a décrit l’impitoyable rigidité, il se soit fait accompagner de femmes, qu’il ait parlé à la Samaritaine, qu’il ait brisé tous les tabous de son temps, introduisant principalement la mixité des sexes, et l’émancipation des femmes.
Sa vérité est autre
C’est tout de même réduire étrangement son message et surtout en dégager l’éclat sur un fond très suspect de malveillance. Se rend-on compte de l’antisémitisme profond de telles descriptions ? Misérable apologétique en vérité, et qui ne résiste pas à l’examen ! Car la société juive, le couple juif ne vivaient pas, malgré la rigueur des codes, selon cette inhumanité. On voit, dans le Nouveau Testament, évoluer librement des femmes, que Jésus n’a pas appelées, à commencer par sa mère Marie, avant qu’il existe. La loi est sévère, la vie est souple. Jésus n’est pas si révolutionnaire, et la société pas si horrible. Jésus en est conscient, puisque sur le plan du couple, il se contente de réprimer l’abus du divorce, qui en effet était un usage plein d’iniquité sous sa forme pharisienne. Même ailleurs ses paraboles saisissent les femmes dans leur rôle traditionnel, sans s’en formaliser. On les voit balayer la maison, fabriquer le pain, tandis que l’homme est dans la vigne, commande à ses troupeaux et à ses ouvriers, exerce un métier dans la cité. D’autre part Jésus n’envoie pas de femmes comme apôtres, et l’on ne voit pas dans saint Luc que le nouveau-né soit emmaillotté par Joseph. Si les mœurs dont le Christ est le témoin ne le révoltent pas, c’est que pour sa conscience d’homme du premier siècle qui est une conscience comme une autre ces mœurs ne sont pas révoltantes. La configuration traditionnelle du couple offre même sa légitimité et voici pourquoi.
Aucun couple, dès lors qu’il s’établit dans un projet de famille, ne peut subsister dans un statut conscient d’iniquité. Hormis les cas de déchéance, les familles sont des lieux où s’éduquent le jugement et la vertu. Elles ne sauraient donc se proposer en monstrueux exemples d’injustice. li existe, partout et toujours, une rectitude de la famille, qui s’érige en paradigme de la société moins parfaite qu’elle, et elle se présente à cette société comme le modèle à atteindre: c’est ainsi que les mots de frère, de père, de mère émigrent dans l’espace social pour désigner des rapports améliorés entre les hommes.
Ensuite, dans un couple, quel que soit son mode d’institution et les préjugés en vigueur, une sorte d’égalité tend à s’établir, et une estime réciproque. La vie est vécue ensemble, avec ses difficultés, ses épreuves, qui instaurent le partage des réflexions et une solidarité évidente. Tel est d’ailleurs le témoignage qui nous vient des textes eux-mêmes: les deux parents sont également honorables. Leur respect est mutuel. J’ajouterai que l’amour lui-même peut s’épanouir dans des unions pourtant décidées sans lui, et sans connaissance préalable des jeunes gens.
On peut aller plus loin : le pouvoir se trouve rapidement partagé, et il n’est pas exceptionnel qu’il se renverse dans l’autre sens, sous la pression d’un caractère un peu pimenté, ou en vertu du grand nombre de femmes vivant au foyer. L’homme rentrant chez lui, attendu par épouse(s), mères, belles-mères n’a pas toujours à faire tellement le faraud !
Les textes, certes, donnent les droits à l’homme. Mais ne nous laissons pas abuser par cette proposition: c’est que l’homme est dans l’orbite des lois. La femme, dispensée de certains de ses articles, appartient à une autre législation que celle des lois. Elle est du côté des puissances de la biologie. L’homme commande sa femme avec ses prescriptions institutionnelles, mais cela n’empêche nullement qu’elle le tienne à sa merci, tandis qu’elle lui assure la vie élémentaire, qu’elle peut fort malmener. La biologie est aussi puissante que l’institution raisonnée. L’épouse peut faire la grève, comme dans la comédie d’Aristophane, elle-même, disposant de tous les registres de la puissance nourricière, empoisonner son époux. Le droit écrit accorde le divorce à l’homme, la puissance ineffable de la vie accorde à la femme des ruptures non moins définitives, par des expédients secrets dont l’Ancien Testament porte témoignage, pro maxima Dei gloria. Elle peut le tromper, et ne s’en prive guère. Si l’on prend la peine de compter les femmes de l’Ancien Testament qui, d’une façon ou d’une autre, n’ont pas trompé l’homme dont elles étaient la femme, la sujette, l’amante ou l’ennemie, on en trouvera fort peu.
Or la ruse l’emporte sur la force, en ce qu’elle est cachée et insoupçonnable, et par là, inévitable. Dans ce couple ancien, la dissymétrie des pouvoirs s’inverse presque nécessairement: celle qui est rivée au foyer, toujours présente en sa demeure et dans le travail de sa demeure, a tout naturellement plus de pouvoirs que celui qui n’y vient qu’au titre de visiteur intermittent, et se trouve chez elle plus exactement que chez lui.
Enfin, comment le mépris de la femme serait-il compatible avec une telle sacralisation des événements de la vie biologique dont la femme est le centre, et qu’accompagnaient de plus profondes et plus durables cérémonies qu’aujourd’hui ? Comment, en régime de mépris, la maison, royaume féminin, serait-elle cet espace sacré dont l’étranger ne franchit pas le seuil sans effectuer des rites appropriés (le cadeau de l’invité) ? Comment le simple regard de l’étranger sur la femme atteindrait-il avec cette susceptibilité l’honneur du mari, si sa femme était tenue pour vil objet, et comment l’intégrité de la maison privée aurait-elle cette capitale importance sur la dignité du personnage civil ?
Sens du masculin et du féminin
La femme est vouée aux tâches biologiques. À l’homme appartient la sphère juridique et politique. Pourquoi cette répartition ? On peut toujours dire que c’est une discrimination choquante et lui trouver des raisons abjectes, sans prendre garde que l’imagination ancienne des juifs estimait très haut le biologique, si voisin du sacré.
On peut donc imputer cette discrimination à la simple oppression masculine: le fort impose sa loi au faible. Mais alors, pourquoi ces poches de vénération de la femme? Pourquoi l’oppression ne va-t-elle pas jusqu’au bout d’elle-même, comme elle le fait des esclaves ?
On peut aussi, et plus finement, voir dans cette discrimination la nécessité d’un strict partage des rôles, imposé par les conditions précaires des familles anciennes. Le couple contemporain de Jésus est tributaire d’une sévère organisation qui tend à assurer la survie du groupe menacé, car on est en régime de carence: aucun secours d’ordre technologique, biologique, économique ou politique n’est attendu de l’environnement. À la limite, on n’est pas environné du tout. La famille fait face avec ses seules ressources. Les enjeux difficiles de la continuation de l’espèce commandent cette réglementation des tâches qui ne peut être autre que ce qu’elle est.
Ces rôles séparés sont donc vitalement liés l’un à l’autre. La complémentarité des sexes dont nous rions aujourd’hui était alors une nécessité vitale, sans laquelle il n’y aurait plus eu ni homme ni femme. Aujourd’hui encore, est-il facile de la négliger entièrement ? Que servait à l’homme de conquérir la gloire dans la cité, d’être un soldat valeureux, un créateur brillant, un politique plein d’autorité, s’il ne trouvait chez lui la femme qui lui assurât le repos, la nourriture, le réconfort, le maintien de son honneur, lui fît le don de la paix, lui permît de recueillir ses forces et de prendre de nouveaux départs ? Sans la femme, génie du foyer. la vie publique de l’homme est nulle. Et sans l’homme, protecteur de la maison, la femme eût été livrée aux intempéries. à la convoitise des voisins, au contact abrupt du monde extérieur. Sans la carrière publique de l’homme, il n’y a plus d’intériorité possible, et sans l’intériorité, c’en est fait de l’effort de l’homme pour vaincre le monde.
Mais il y a plus encore que cette utilité réciproque et générale. Une symbolique profonde, aujourd’hui encore d’un renoncement difficile, maintient cette tradition. Homme et femme, dans le monde antique, juif ou païen, représentent les deux pôles du mystère de la vie. Leur condition opposée réjouit le dualisme fondamental de la conscience, qui sépare le jour et la nuit, le céleste et le terrestre, le spirituel et le charnel. L’homme revêt l’aspect solaire, spirituel, conquérant, rationnel, organisateur de l’espace, mais sa part n’est pas en tout la meilleure, car il s’expose à l’accident, à l’aventure, aux aléas du monde extérieur. La femme représente l’élément interne, la vie cachée, souterraine, avec ses œuvres lentes de germination, de maturation des semences. Elle gère le monde clos du jardin et de la maison et son rapport au temps n’est pas comme celui de l’homme, bondissement, heurt et risque, il est un accompagnement lent et régulier.
La plus ancienne perception du féminin nous renvoie au monde opaque du dedans, à la vie close sur elle-même, aux puissances douces et invincibles qui fabriquent la vie. «La maison. c’est la femme», dit le Talmud. Elle demeure en la demeure, elle est elle-même demeure dans la maternité, elle est l’enceinte. La plus ancienne conception du masculin nous renvoie aux audaces de l’aventurier, à l’affrontement des intempéries, aux groupes inconnus, peut-être hostiles, peut-être favorables, à la rencontre des choses par la technique, et à celle des êtres par la politique, bref à la protection du monde intérieur par une panoplie de défenses qui tiennent en échec la barbarie du monde extérieur. Homme et femme représentent deux mondes, étroitement séparés, si j’ose dire, qui incarnent les deux modalités de la vie, la germination et l’aventure.
La conjugalité selon l’Ancien Testament
Catégories ontologiques, non accidentelles. Elles définissent des substances irréfutables avec lesquelles on ne peut badiner. L’être humain n’est pas neutre. Son sexe est toujours déterminant, même lorsqu’il ne s’occupe pas d’amour ou de procréation. Sa dignité est sexuée. C’est pourquoi il n’y a pas d’échange possible des rôles. Une femme dans la cité serait incongrue, l’homme dans la maternité serait ridicule. Le sexe fait partie de la définition constante de la personne, et tout le champ de l’activité humaine subit un partage sexuel qui délimitent les divers travaux de la vie entre homme et femme, et l’empiètement de ces rôles est jugé de mauvais aloi. Il implique une incompréhensible confusion, que les croyants interprètent comme une révolte devant l’ordre du Créateur. Ainsi voit-on les Proverbes dénoncer la femme séductrice et perfide. Mais n’en tirons pas trop vite l’opinion que l’Ancien Testament est misogyne. On relève simultanément l’éloge de l’épouse en Proverbes 31 et de l’amante dont les mérites sont vantés dans le Cantique. La femme qui excite le mépris dans l’Ancien Testament est celle qui est sortie de l’orbite propre à son sexe, et s’est aventurée sur le terrain des hommes: la chanteuse ou la prostituée. Elle n’a que faire d’être là où elle est. On ne parlera pas ainsi de la bonne épouse, qui attire sur elle une pluie de louanges.
Le mépris survient si l’on sort de ses frontières. De la même façon, l’homme perd sa dignité s’il pénètre dans l’orbite féminine. Un homme au foyer, qui n’est pas capable de faire un soldat, un paysan, un orateur, c’est la honte. Avons-nous du reste tellement changé là-dessus, comme l’illustre tristement le désastre que représente, pour un homme, le chômage ?
Selon le Nouveau Testament: saint Paul
Dans ce monde antique, les géographies sont d’une merveilleuse simplicité. La prédication chrétienne qui s’ébauche à la fin du premier siècle, se garde bien d’y toucher. Elle ne discute pas cet ordre indiscutable. Elle veille au contraire à ce que la toujours imparfaite pratique soit remise au pas. Saint-Paul et la Didachê commandent donc l’obéissance aux femmes. Leur puissance, on l’a vu, est grande et elles sont tentées d’en abuser. Saint Paul reste dans l’esprit de son temps, et il est clair. Le christianisme, qui donne des occasions de mixité publique entre les sexes, rares dans le monde antique, ne doit pas être le prétexte à la confusion des vocations. La dignité reste sexuée. Donc pas d’équivoque. Les femmes se tairont dans les assemblées, ne seront pas apôtres, resteront séparées des hommes et voilées. La mixité des chrétiens n’aura rien à voir avec celle des païens, lamentable spectacle où hommes et femmes se mêlent imprudemment. Mais la vie privée n’est pas oubliée. Et saint Paul de traiter avec minutie cette ligne délicate où le pouvoir juridique de l’homme interfère avec le pouvoir biologique de la femme. C’est sur cette ligne de démarcation que les anciens ne cessent de moraliser, car évidemment, il se produit des incidents aux frontières!
«Maris, aimez vos femmes.» Il ne faut pas abîmer par excès de juridisme viril le monde tendre des sentiments. Le mari ne doit pas faire déborder la loi politique dans l’intimité familiale. S’il entre dans la sphère féminine, il doit se conformer à la loi qui y règne, celle de la tendresse.
«Femmes, respectez vos maris.» Il ne faut pas que la femme s’appuie sur son privilège biologique pour altérer l’intégrité publique du mari. Quand elle traite avec lui, elle doit en respecter la loi qui est d’essence juridique. Ainsi chacun est invité dans son approche d’autrui à adopter au sein de la rencontre la règle adverse, faute de quoi il y a non-reconnaissance mutuelle et explosion des conflits. Hommes et femmes sont priés de ne pas dénaturer leur deux moralités. Ils ne doivent pas contester le monde masculin et le monde féminin.
… Jésus
Le Nouveau Testament entretient le respect des deux conditions, dont la légitimité n’entre jamais en discussion dans le monde antique. Cette séparation des sexes est l’un des grands axiomes de la société antique. Il serait faux de dire que Jésus a occidentalisé le couple. Il s’efforce de rétablir la justice là où régnait l’iniquité, principalement à propos du divorce. Mais il ne moleste pas les mœurs en usage.
Le couple moderne n’a jamais jusqu’à notre époque rejeté ce modèle ancien qui demeure l’une de ses configurations les plus générales. Mais nos traditions occidentales ont dès les origines inclus une forme de mixité dans le monde professionnel, culturel et même politique. On peut suivre la carrière de cette mixité aux diverses étapes de nos évolutions sociales, la vie de cour, les salons philosophiques, les codes de galanterie, l’instruction obligatoire des filles et les conquêtes sociales qui ont conféré en moins de cent ans une égalité de droits avec les hommes. Cependant, cette émancipation a toujours revêtu la forme d’une lutte, car il y a toujours eu résistance de l’homme, effrayé par ce dé- placement du site féminin et redoutant qu’en changeant de lieu elle ne change aussi de sexe !
Que de fois n’entend-on pas: ces femmes qui se précipitent sur des métiers d’hommes et qui veulent l’égalité vont perdre leur différence ! D’abord rappelons qu’est «métier d’homme» tout métier exercé ailleurs que dans la clôture du domicile, en sorte que leur incongruité est quasiment inévitable. Et d’autre part qui, devant une femme juge, médecin, n’identifie immédiatement une femme? Sa différence est-elle altérée? Enfin qu’est-ce que la revendication de droits égaux a à voir avec la substance et le style de la personne? C’est l’aliénation plutôt qui est réductrice des différences, puisqu’elle abîme l’être et empêche son épanouissement.
Et d’autre part faut-il obsessionnellement considérer dans l’individu son appartenance sexuelle ? Y a-t-il à se souvenir dans le travail que l’on est homme ou femme? Et, comme dit Marguerite Yourcenar à propos d’Hadrien, se souvient-on seulement, dans l’élan de son effort, que l’on est un être humain?
La relativisation du sexe qui n’est plus la caractéristique despotique de l’être et réglementant sévèrement sa liberté; la mixité croissante d’un monde qui associe homme et femme dans les mêmes impératifs de la vie socio-économique, le libéralisme culturel, tous ces facteurs ont-ils rendu le couple plus évangélique, plus conforme aux intentions de Jésus ?
Il serait vain de voir en Jésus le prophète des sociétés modernes et de dire que dès l’an 30, il préparait l’égalité des sexes telle qu’elle est comprise à la fin du 20e siècle. Tout au plus peut-on dire que l’affinement de la notion de justice a été favorisé par des influences chrétiennes, mais les transformations des données socio-économiques qui ont inventé le monde nouveau et ont rendu possibles de telles évolutions ne sont que lointainement de provenance chrétienne. D’autre part, on ne saurait borner l’action du Christ à la constitution du couple moderne, où chaque personne reste elle-même, sans que l’une opprime l’autre. Un tel couple se signale aussi par quelques infirmités et l’on ne saurait réduire l’action du Christ à ce bilan somme toute morose: fragilité des unions, caractère individualiste des familles, développement de l’anxiété, relâchement de l’intimité domestique, étroitesse du noyau familial. Et dans ce couple la question des femmes n’est nullement réglée, puisque celles qui échappent au carcan de la tradition ont la plupart du temps d’extrêmes difficultés à concilier leur double existence, extérieure et intérieure. Je préfère ne pas voir là toutes les ambitions d’un Dieu.
Ne croyons pas que Jésus n’ait cherché qu’à occidentaliser le couple. Ce serait commettre une erreur sur les textes et lui prêter ensuite de modestes visées. Et que dire de cet étrange prophétisme que nous lui attribuons: nous le faisons prophète de nos changements, nous rejetons notre présent vers son passé. Il cautionne nos usages.
Singulière audace qui renvoie le présent vers le passé et l’appelle prophétisme ! Réduire Jésus à des acquisitions aussi circonstancielles nous dispense d’entendre des exigences plus radicales qui ne flattent nullement nos désirs de l’heure, et comme au temps où elles furent énoncées, continuent à nous arracher au faisceau de pulsions, d’instincts, de justifications, en un mot, à cet énorme entêtement à être soi et rien que soi. La radicalité de Jésus sur le couple est celle déployée sur le sermon sur la montagne. Elle ne laisse rien en nous en dehors de son commandement.
Que dit donc Jésus sur le couple? Il n’en parle qu’une fois et produit deux citations de la Genèse, en amalgamant des éléments du premier et du second récit: «Au commencement, Dieu créa l’homme; homme et femme il les créa. C’est pourquoi l’homme s’attachera à sa femme et ils ne seront qu’une chair».
La première parole pose le couple dans sa dualité. Elle annonce la différence. La seconde évoque la similitude, l’identité de cette chair unique qui revient vers elle-même. Regardons la première citation. Et notons qu’il n’y a non pas un mais deux couples. Avant de produire une humanité en double, dont le premier caractère est la non-ressemblance avec elle-même (les mots de mâle et femelle en hébreu ont des racines différentes), Dieu a produit un couple antérieur qui est formé de lui-même en face de l’homme. En sorte que dans cette citation, il y a un terme qui a toujours un partenaire, c’est l’homme. Dans le premier récit, l’homme ne connaît pas la solitude. Il a toujours devant lui le visage de quelqu’un: Dieu ou une femme. Mais on peut dire aussi: Dieu ou un homme. Ce qui me constitue humanité, c’est la non-solitude, la présence d’un autre. L’homme est un être d’alliance. Il a toujours en face de lui un visage. Ce trait est fondamental. Car le visage fait advenir la moralité. L’éthique naît du visage. Ce qui est spécifiquement humain dérive de cette situation de vis-à-vis.
Éthique du vis-à-vis
Devant autrui se dégagent les prescriptions éthiques. En voici trois articles: l’équité, la responsabilité, le mystère. L’amour ne joint-il pas ces trois exigences?
L’équité
La seule existence de l’autre, avant l’inauguration de tout rapport, pose ma limite, dissipe la prétention la plus tenace et la plus illusoire: la pensée d’être seul au monde et d’exercer sur lui une puissance illimitée. Le sentiment dès lors qu’il est porté par d’autres aiguille les rapports humains vers le conflit, chacun essayant de réaliser aux dépens de l’autre sa prétention. L’autre est à la fois le menacé et le menaçant.
Or ce visage en face de moi, vecteur d’une conscience vive, arrête l’irréaliste démesure du moi. Le face à face pose l’autre en sujet irréductible, comme «moi» doté d’un visage, c’est-à-dire derrière le visage d’une pensée inconnue, d’une capacité de souffrance imprévisible et impartageable, d’une liberté sur laquelle je n’ai pas de prise. Je ne puis donc le réduire à mon besoin de dominer, d’exploiter, de le faire servir au moi solitaire. Il est campé en face de moi, dans la puissance du réalisme et la radicalité de la métaphysique. Il est l’être.
Aussi pose-t-il la loi. La loi est l’existence de l’autre. Son essence est l’hétéronomie. Il me contraint à composer avec lui, puisqu’il donne la preuve que je ne suis pas seul. Il m’ouvre donc au monde de l’équité. Celui qui ne m’appartient pas comme un objet, ne peut me donner droit à la possession, mais il me fait entrer dans la négociation. L’interdit est ce qui est défendu au moi solitaire et illimité, la borne imposée au désir, mais c’est aussi ce qui est dit entre deux sujets. L’interdit est la parole entre nous deux qui évite la violence. L’interdit instaure la paix.
Cette mutuelle sécurité ne va pas sans sacrifice. Le désir se heurte à l’irréductibilité d’autrui, qui balise mes ambitions et m’installe dans le renoncement. Autrui implique une certaine mort à moi-même, ou du moins à ces illusions d’infini que l’être est toujours porté à entretenir.
La responsabilité
Cette reconnaissance mutuelle établit les relations de la justice. Or la perfection de la justice, curieusement, n’est pas l’équilibre parfait de la justice. Dans les couples de la Genèse, il y a toujours un premier-nommé. Dieu, puis l’homme. Or le rang ne dispose pas à la hiérarchie. Il crée au contraire la perfection de l’équité.
On sait que le secret des chefs d’œuvre architecturaux consiste en d’imperceptibles trahisons de la géométrie. Le Parthénon est légèrement surélevé en son axe, et ses assises ne forment pas une ligne droite mais présentent une fine courbure. Pour donner à l’œil l’impression de la parfaite égalité de ses colonnes, les deux placées aux extrémités ont un diamètre un peu supérieur. De même en musique, la reprise d’un thème n’est jamais son identique répétition. Une nuance, une liaison ont suffi à changer l’intelligence du thème initial, à offrir comme un dénouement à son récit.
Ce n’est pas différent dans le couple. Il y a un aîné. Qui est-ce? L’homme ou la femme? Peu importe. En réalité, c’est les deux. Chacun est l’aîné de l’autre, chacun s’estime né avant. Je veux dire que l’équité véritable passe par la légère dissymétrie de la responsabilité. Car être l’aîné ne donne pas de privilèges, il donne du travail et des préoccupations en plus. Moi, l’aîné, je n’ai pas plus de droits que l’autre, mais je me connais plus de devoirs. La foi ne peut inspirer d’autre pensée. Tout autre est mon obligé. Je lui dois plus qu’il ne me doit. Si j’essaie de définir un partage totalement symétrique, je crée les rapports d’un équilibre qui se maintient par l’égale poussée de forces contraires. Je puis à cette égalité donner un autre nom qui la définit tout aussi bien, je puis l’appeler intimidation. Car elle ressemble autant à une belle utopie qu’au réalisme de deux puissances se faisant échec.
La grâce de la relation reconnaît à la conscience un surplus de devoirs, que l’un n’est pas en droit d’exiger de l’autre. Le léger surplomb sur lui, c’est l’équilibre de l’amour. Je vois le visage de mon vis-à-vis, et voyant le visage, je vois la faiblesse et la fragilité. Je vois la marque de la mort. Le visage est visé, la figure peut être défigurée. L’autre m’est vulnérabilité. Et moi, dont les yeux voient le visage, j’ai mission de le protéger. Je dois le défendre des coups, des larmes, des rides. Le visage d’autrui appelle l’éthique, dans une responsabilité inévitable. Je le reçois comme l’étranger issu du désert. Il est faible; je suis devant lui, fort. De cette dissymétrie supposée découle ma justice, sciemment injuste.
L’amour, – mais je dirai aussi la foi – supporte le poids des autres. ll est d’abord, avant d’être élan vers autrui, exigence à l’égard de soi. L’aîné se qualifie comme aîné, non par sa puissance, mais par son humilité de serviteur. Le problème entre l’homme et la femme n’est pas un problème d’autorité. Qui commande ? Car le plus fort est le serviteur. La foi chrétienne procède de cette inéluctable prescription: Dieu s’anéantit en Jésus-Christ (Philippiens 3). Dans l’évangile, Jésus est le seul à «parler avec autorité» ou à ressusciter des morts et aussi le seul que l’on voit mourir avec toutes les marques de l’échec. Quand saint Paul dit aux maris d’aimer leur femme comme le Christ a aimé l’Église, c’est-à-dire jusqu’au sacrifice inclus, il énonce un principe universel selon lequel le plus fort doit user sa force à fortifier le faible, dût-il en mourir. Et quand saint Paul ajoute: «Femmes, soumettez-vous à vos maris», il colore un propos bien traditionnel d’une idée nouvelle qui le subvertit: faites-vous les servantes de votre serviteur. Car s’il vous sert, vous revoilà en position de force et devant incliner votre force à sa faiblesse. Du reste. l’apôtre a fait précéder toute son exhortation aux époux d’un préambule que l’on s’abstient régulièrement de lire, car on ne comprend plus grand chose à cette obéissance invoquée: «soumettez-vous les uns aux autres», dit-il d’abord. Estimez-vous responsables les uns des autres, suffit-il de traduire en français moderne. Tout pouvoir est injuste s’il ne se traduit en devoirs.
Le mystère de la différence et de la similitude
Enfin, l’autre est une brèche de transcendance. ll n’est ni moi, ni à moi; je suis séparé de sa pensée, que je ne connais pas et sur laquelle je peux porter mes erreurs ou mes soupçons ou mes adorations. L’autre est mon semblable, peut-être mais chargé de mystère. ll se distingue de moi par ce halo de brume autour de lui qui entretient la crainte ou l’amour. L’autre est un être caché, que l’on ne finit pas de découvrir. Beaucoup d’amours s’épuisent parce qu’ils ont perdu conscience de tout l’inconnu encore disponible derrière l’habitude et le visible. En somme l’amour disparaît lorsqu’il a perdu la foi en cette liberté d’autrui.
L’autre est également l’événement d’une rencontre à nulle autre pareille. Mon vis-à-vis est un être unique, à qui nul n’a jamais ressemblé et que personne ne remplacera. ll n’y a pas interchangeabilité des êtres. Chacun est une totalité indivise, qui ne se mesure ni ne se compare à un autre, ni même à la somme des autres. Un proverbe arabe dit admirablement que tuer un homme c’est tuer le monde entier, ce qui rejoint la parabole de la brebis perdue. Une seule est à elle seule comme le monde: sa perte serait irréparable, ce serait pis que la perte du troupeau entier.
La similitude inhérente à l’amour se raconte mieux dans le simple récit de la création. Adam est l’auteur du premier commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier, il conçoit cette idée folle que l’autre qui est le plus loin de moi est aussi le plus près. Car il reconnaît d’instinct son intime substance en celle que Dieu lui «amena» et qui semble venir de loin. Dieu en effet a tout fait pour cacher à Adam qu’Eve procède de sa chair. Il endort Adam d’un profond sommeil, travaille clandestinement, prenant soin de prélever un organe invisible, dont la suppression ne sera aucunement sensible à Adam, et il referme la chair à sa place. Puis il s’en va ouvrager Eve hors du regard d’Adam.
Mais quand la femme est présentée devant le premier homme, celui-ci ne se trompe pas: il reconnaît d’emblée qu’elle est sa chair, et qu’elle est même tirée de l’os invisible, et il reconstitue tout le scénario de l’opération, comme s’il y avait assisté, et le récit pointe vers cette idée que l’amour déborde tout, dans sa connaissance et sa justesse, et déjoue jusqu’aux desseins d’un Dieu !
Le récit de la Genèse nous livre le dernier mot: cette étrangère mystérieusement amenée par Dieu est bien à la fois la même et l’autre, la proche et la lointaine; en cette double qualité d’étrangeté et de similitude consiste la promesse de l’amour, liée au mot couple.
Illustration: Adam et Ève (gravure de Théodore de Bry, 1590).