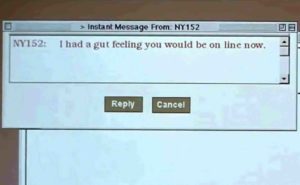L’amante religieuse, À propos de « La mante religieuse » de Natalie Saracco
«Les passions ne sont pas ‘divinement neutres’»: dans ce film où une réalisatrice (convertie au catholicisme) met en scène l’attirance entre un prêtre et une artiste, s’il s’agit de désidéologiser la foi chrétienne, c’est en montrant que «s’il y a un Dieu et que ce Dieu existe pour l’homme, alors ce Dieu ne serait pas que du côté du ‘bien moral’ de la morale de surplomb mais aussi dans le mouvement passionnel même, en tant que force de vie agissant dans l’histoire des personnes contre un obstacle mortifère à détruire».
Texte publié dans Foi&Vie 2024/1.
Tant a été écrit sur la passion charnelle et ses effets nocifs ou merveilleux, ses mouvements extrêmes ou emportés, ses impacts sur la vie de ceux qui étaient pris dans ces maelstroms, vortex, tourbillons émotionnels avec leur lot de souffrance et de joie, qu’on hésite à rouvrir le dossier à propos d’un film passé inaperçu dans le paysage cinématographique français au moment de sa sortie en juin 2014, La mante religieuse, réalisé par Natalie Saracco. Pourtant les récents scandales sexuels dans l’Église catholique et plus généralement les problèmes posés par la sexualité à des hommes à qui la fonction de prêtre catholique impose une abstinence sexuelle avec toutes les difficultés que cela comporte, problématique que l’on peut étendre à la notion de fidélité conjugale pour les pasteurs mariés de l’Église protestante, mais encore au-delà pour les couples sans engagement religieux explicite, incitent à revoir ce film pour faire réfléchir sur certains enjeux éthiques de la gestion de la sexualité.
Ce film, qui fut complètement inattendu au moment de sa sortie, aborde en effet cette question de manière à la fois radicale et subversive. Il présente d’une façon presque stylisée une intrigue somme tout classique, l’attirance charnelle entre une femme et un prêtre, ici une femme artiste peintre en révolte contre elle-même, et un prêtre qui va s’affronter au désir qu’elle a pour lui et qu’il ressent – malgré lui – pour elle. Mais ce film touche au-delà des classiques catégories sociales ou religieuses, car Natalie Saracco en fait une histoire autre: celle d’un chemin d’humanisation qui traverse sans la nier la force du désir sexuel du prêtre et de la femme. Ce chemin aura une double issue: il conduira la femme d’une posture de conflit violent à une attitude apaisée à la suite de la rencontre qu’elle fera avec le prêtre qui, lui, en mourra.
Un film insaisissable et paradoxal
Rien n’est conventionnel dans ce film, à commencer par les catégories religieuses. L’Église catholique est représentée à la fois sous des aspects risibles ou pitoyables (scène de la chorale paroissiale dirigée par une cheffe de chœur qui confond liturgie et protocole et qui se réjouira – à la fin du film – de ce que le prêtre meure sans avoir eu le temps de se confesser) et sous des merveilles de charité (très belle scène où le prêtre s’occupe d’un transsexuel prostitué qu’il va aider à conserver son logement face à une famille de catholiques pratiquants qui lui refusent de continuer à habiter là). Tout le film est ainsi: présentation de postures religieuses inscrites socialement dans un ordre établi qui transforme le bien en mal, et d’attitudes spirituelles non inscrites dans cet ordre mais qui transmuent le mal en bien. Pas de dualisme facile dans la qualification morale des actes des différents personnages.
Le prêtre s’appelle David (Marc Ruchmann). Il rencontre Jézabel de Courcy (Mylène Jampanoï), artiste peintre en vue mais en rupture familiale, dont les œuvres sont particulièrement fortes (il s’agit des tableaux de l’artiste Philippe Pasqua), au moment de la mort du père de celle-ci dont il a célébré la messe d’enterrement.
David plaît à Jézabel, et lui plaît même beaucoup. Accoutumée à des aventures sexuelles multiples (elle se présente comme lesbienne bisexuelle), Jézabel est attirée par David dans une passion charnelle forte qui se révèle progressivement mais inexorablement: à un moment, elle lui dira qu’elle a, toute sa vie, rêvé de rencontrer un homme comme lui. Elle décide alors de le conquérir: «Je ne vais en faire qu’une bouchée». Pour cela, elle conçoit une manipulation en faisant croire à David qu’Erika (Mathilde Bisson), son amie et compagne sexuelle (fortes scènes où Jézabel et Erika s’enlacent, corps contre corps), désire se faire baptiser après une conversion et un catéchuménat, et qu’elle voudrait la lui présenter. David accepte et commence à ressentir à son tour les effets de l’attraction de Jézabel. Il se trouve – progressivement – confronté à une attirance charnelle pour Jézabel. Si la passion charnelle de Jézabel pour David ne lui pose pas de problème autre que la résistance de David, il n’en est pas de même pour David. Cette attraction vient heurter son état de prêtre : il va chercher à la vaincre.
Dans ce parcours de vie traversé par des rencontres qui donnent lieu à des scènes imprévisibles mais qui progressivement transforment Jézabel, l’une est selon nous centrale pour éclairer l’ensemble du film et lui donner sa tonalité paradoxale qu’elle incarne parfaitement en la compactant en très peu de mots, celle de la rencontre entre Jézabel et la mère supérieure (extraordinaire Geneviève Casile de la Comédie française) d’un couvent de carmélites en Normandie où David va faire sa retraite annuelle. Comme toujours avec Jézabel, le premier contact est violent. Elle apporte à David un tableau qu’il lui a commandé pour la vente de charité de sa paroisse, et lui montre ce tableau en présence de la mère supérieure. S’il fallait résumer le film à un seul échange dont on pourrait dire en risquant un jeu de mot qu’il est crucial, ce serait celui-ci: « royez-vous en Dieu ?», demande la mère supérieure à Jézabel. «Non», lui répond-elle. «Lui, pourtant, il croit en vous», lui dit-elle.
La phrase touche. Par une mystérieuse alchimie performative, ces mots vont progressivement pénétrer la passion charnelle de Jézabel pour David et sa révolte tout aussi passionnée contre elle-même et le monde. La fin du film laisse supposer que ces passions pourront être retournées de l’intérieur pour – peut-être un jour – être transformées en sources de bonheur. Pour autant qu’on laisse du temps au temps.
Une polémique entre catholiques à propos de la morale sexuelle
Le film a été peu reçu: dans l’ensemble, les critiques spécialisées ont été assez négatives, mettant en avant des faiblesses sur le scénario ou l’interprétation des acteurs. Au-delà des opinions positives ou négatives sur ce film, nous voudrions ici revenir sur un phénomène qui n’a pas été commenté dans les médias mais qui paraît intéressant à relever pour les enjeux qu’il dévoile en matière de morale sexuelle: la controverse entre catholiques qu’il a suscitée. Natalie Saracco n’a pas caché sa conversion à la foi catholique après une expérience de mort imminente dans un terrible accident de voiture, ni le fait qu’elle avait réalisé ce film comme un témoignage qu’elle devait rendre «au cœur de Jésus» qu’elle disait avoir rencontré. Pour cela, ce film était une réponse de foi à ce qu’elle avait vécu, et devait contribuer à l’évangélisation, par le canal du cinéma. Elle chercha des financements auprès de catholiques engagés, et elle en trouva, en particulier dans les milieux financiers. Le film fut donc financé par des catholiques. Financé par des catholiques, porté par des catholiques dans un objectif de témoignage de la foi, présenté dans une soirée au Collège des Bernardins en présence des financeurs et de Natalie Saracco elle-même. Mais ensuite apparut quelque chose d’étrange, d’imprévu. Des voix catholiques s’élevèrent pour le déconseiller à un public catholique. À titre d’exemple, le site de la communauté charismatique catholique de l’Emmanuel, Il est vivant. Mensuel de la nouvelle évangélisation, publia un avis très net de l’un de ses responsables:
«Ce film m’a heurté dans ma capacité à unir mes forces, y compris pulsionnelles, pour mieux aimer. Était-ce utile que je le voie ? Je réponds non. Je prie pourtant afin que ce film porte le plus grand fruit».
Relevons au passage le paradoxe de cet étrange avis: cela n’est pas souhaitable de voir ce film, mais espérons que beaucoup iront le voir ! Quoiqu’il en soit, ceux-là mêmes qui avaient soutenu et porté le projet s’en désistèrent et cessèrent de promouvoir le film.
La controverse se déploya autour de la position morale à adopter sur le traitement de la passion charnelle de Jézabel pour David d’abord, suivie par la réponse de David et des images qui la représentaient. David devait-il céder à sa passion naissante pour Jézabel ? Fallait-il le montrer en image si directement ? La morale catholique sortait-elle indemne de cette confrontation ? Ainsi, à défaut de susciter un intérêt dans le grand public, ce film déclencha des polémiques parmi ceux qui auraient dû en être les porteurs et les promoteurs. Il fut abandonné par ceux-là même qui l’avaient au départ soutenu. Pourquoi ?
Notre première hypothèse est la suivante. Ce film se présente au départ comme une proposition de foi catholique pour les non-croyants, recevant l’appui des catholiques. Mais il présente une subversion d’une certaine morale sexuelle catholique traditionnelle que l’on pourrait qualifier de morale de surplomb. Par morale de surplomb, on peut entendre une morale surplombante ou une morale qui tombe tout droit du ciel, c’est à dire une morale qui ne prend pas en compte la temporalité, l’historicité des situations humaines concrètes, avec leurs errances et leur incertitude narrative, d’une certaine manière une morale sans histoire. Dans le double sens du nombre, au singulier, qui ne fait pas d’histoire (pas de prise en compte du temps) et au pluriel qui ne fait pas d’histoires (qui ne cherche pas des problèmes). D’où le double rejet du film: par un public non catholique qu’il a heurté par ce qui était perçu comme une tentative de prosélytisme naïvement mise en scène (voir les avis des critiques spécialisées), et par un public catholique qu’il a dérouté par l’éloignement de ses repères moraux traditionnels.
Notre seconde hypothèse est la suivante. Par la subversion de cette morale sexuelle de surplomb, ce film se propose de débarrasser le christianisme d’une «moraline chrétienne» (Nietzsche) issue d’une réduction positiviste et déterministe de la morale chrétienne, réduction idéologique qui produit la morale de surplomb et à laquelle est associée une forme de bienpensance catholique, un conformisme moral qui empêche de penser l’Évangile dans une dynamique situationnelle, transformant la vie chrétienne en morale détemporalisée.
À ce titre, comme plusieurs autres réalisations sur le phénomène de la croyance religieuse de cette période parmi lesquelles Ida de Pawel Pawlikowski (2013), L’Apôtre de Cheyenne Carron (2014), Marie Heurtin de Jean-Pierre Améris (2014), Chemin de croix de Dietrich Brüggemann (2014), Calvary de John McDonagh (2014), La Confession de Nicolas Boukhrief (2015), La Prière de Cédric Kahn (2018), ou L’Apparition de Xavier Giannoli (2018), on peut considérer que ce film participe d’une désidéologisation de la foi chrétienne. Aussi, l’analyse de la controverse entre catholiques à propos de ce film pourrait mettre en lumière ou représenter le reflet d’un processus de transformation à l’œuvre dans le christianisme occidental contemporain. Plus précisément, notre hypothèse est que la polémique qui a surgi autour du film apparaît comme un révélateur des tensions qui agitent le débat actuel entre christianisme et postmodernité, et dont un terrain d’expression privilégié est celui de la morale sexuelle. C’est à dire justement des situations comme celle que décrit l’histoire du film : une femme et un prêtre sont attirés l’un par l’autre, que faire ?
Passion et patience: l’oxymore chrétien
Commençons par revenir à l’étymologie du mot passion. Passion vient du latin passio qui est un mot à plusieurs sens. Il signifie tout d’abord mouvement, agitation de l’âme en général, un mouvement impétueux de l’âme, une affection de l’âme, comme dans la passion amoureuse. Un deuxième sens l’éclaire, relié au verbe patior, qui se traduit par souffrir, mot qui est issu du verbe grec pascho, signifiant éprouver une affection, d’où vient le nom grec pathos, mot bien connu puisqu’il entre dans la racine de nombreux mots français comme pathétique (qui émeut fortement) mais aussi homéopathie (souffrance semblable, d’où la méthode de guérison par similitude) ou télépathie (éprouver, sentir telle affection à distance). Le verbe grec pascho signifie littéralement être agi et porte une idée de passivité: une passion est subie mais n’est pas librement choisie. Ce qu’exprime aussi le verbe patior, d’où vient le latin passivus à l’origine d’un autre mot français, le mot passif. De ce point de vue étymologique, la passion du Christ apparaît paradoxale puisque le texte de la liturgie catholique énonce: «entrant librement dans sa passion, il fut mis au tombeau». L’entrée est ici libre (active) dans la passion, alors qu’elle est décrite partout comme un mouvement subi (passif) et en tout cas non libre.
Ce paradoxe est ce que nous proposons d’appeler l’oxymore chrétien. L’oxymore chrétien fait surgir les contradictions et les apories des positions morales catholiques objectivistes, et ruine la morale de surplomb de la bienpensance catholique. Qu’apporte cette proposition à la compréhension de la polémique entre catholiques qu’a déclenchée le film ? De supposer que ce film cherche à se situer sur l’oxymore chrétien comme une tentative pour dépasser la fausse alternative entre compréhension subjectiviste et compréhension objectiviste de la morale. Sans prétendre que le film ait pleinement réussi dans cette tentative, on peut cependant penser que c’est l’une des raisons pour lesquelles les polémiques sont apparues.
Un autre groupe lexical issu de cette famille de mots semble intéressant à rapprocher du premier. Le verbe latin patior a produit l’adjectif patiens, qui signifie endurant, et qui a donné en français le mot patience, capacité à endurer. En remontant aux sources étymologiques des mots français, on trouve donc qu’il y aurait comme une mystérieuse relation entre passion et patience. Soit que l’on considère que pour lutter contre les passions, il faut de la patience, soit que l’on prenne la relation dans l’autre sens en imaginant que l’impatience construit peut-être en l’être humain un terreau fertile au déclenchement de la passion. La relation entre l’impatience et les passions a été par exemple mise en musique dans un célèbre ballet de cour, Le ballet royal de l’impatience (1661) de Lully. Le livret du ballet développe l’idée selon laquelle la violence passionnelle semble la conséquence inéluctable de l’impatience.
Dans le roman d’Umberto Eco Le nom de la rose, le jeune novice Adso de Melk interroge son maître l’inquisiteur franciscain Guillaume de Baskerville à propos de l’hérésie cathare. Les cathares se dénommaient eux-mêmes les purs (en grec, catharos veut dire pur). Adso demande à Guillaume ce qui l’effraye le plus chez les purs. Guillaume répond «la hâte». Les purs (les cathares) recherchaient une absolue pureté de mœurs, en particulier les mœurs sexuelles. Ils avaient rejeté la chair qu’ils considéraient comme impure. Sans l’obstacle matériel de la chair, l’instantanéité devient possible, comme dans les échanges contemporains sur Internet. C’est un mirage fascinant qui laisse miroiter que le temps dans toute son épaisseur, le temps qui caractérise l’être de chair, ne compte plus. L’impatience devant les passions serait-elle une trace lointaine de la quête d’une instantanéité détemporalisée car décorporée ? Être comme des anges de purs esprits sans corps, sans temporalité, sans incertitude ? En un sens, il faudrait avoir la patience de la passion, ou la passion de la patience. C’est à dire réhabiliter la narration de soi selon la notion de Paul Ricœur. Sans patience dans la passion (ou sans la passion de la patience), pas d’accès à l’identité narrative. La trajectoire passionnelle de David dans le film de Natalie Saracco doit s’appréhender à partir de l’espace laissé libre entre décrire et prescrire, précisément l’espace narratif que permet la patience.
Utilisons à présent cette proximité lexicale entre passion et patience pour revenir au film en posant la question de manière directe: n’est-ce pas l’impatience de David (il aime rouler vite à moto), c’est-à-dire une mauvaise manière de lutter contre sa passion, qui cause sa mort ?
Les lois de la passion: le diable l’emporte ?
Avançons dans le film. Comment David aurait-il dû lutter contre sa passion ? En physique, on apprend à tout étudiant qu’on ne vainc pas la nature en violant ses lois. Le film nous montre que ce principe élémentaire pourrait s’appliquer aussi dans l’ordre humain, et que l’on pourrait enseigner dans les séminaires catholiques et plus généralement dans la formation des futurs prêtres ou responsables religieux, qu’on ne vainc pas la passion charnelle en violant ses lois, c’est à dire en refusant l’épaisseur du temps. De la même manière qu’on parle de lois de la nature, on devrait parler de lois de la passion.
Cela fait longtemps que la littérature a exploré et décrit ces lois, mais elles sont aujourd’hui mieux connues par la biologie et la psychologie. Le surgissement de la passion charnelle s’accompagne toujours d’une série de phénomènes nettement recensés par la clinique psychothérapeutique: passivité devant l’attraction, difficulté à y résister, dépendance affective, etc. Et depuis une trentaine d’années, la connaissance de la dimension physiologique de la passion charnelle, mise en évidence par les avancées technologiques de l’imagerie cérébrale (l’IRM fonctionnelle) a également établi des caractéristiques physiques précises des mouvements passionnels. Dans Pourquoi nous aimons (1), l’anthropologue Helen Fisher, professeure à l’université Rutgers (New Jersey), propose une réflexion issue de la synthèse de l’examen de l’image du cerveau de 2500 personnes amoureuses ou en rupture amoureuse. L’imagerie cérébrale fait découvrir la trace hormonale de la biologie des passions charnelles (ocytocine, sérotonine, noradrénaline, etc.). Par exemple, le démarrage d’une passion est clairement visible dans la production d’ocytocine. Ceci n’explique pas évidemment (et heureusement) la raison pour laquelle c’est tel homme ou telle femme qui devient l’objet exclusif de la passion, mais montre la trace hormonale que ce mouvement passionnel imprime physiologiquement dans le cerveau, à l’instar d’une comète qui laisse visible sa trajectoire dans le ciel nocturne. On voit la comète sans savoir pourquoi elle suit cette trajectoire, il s’agit seulement d’un repérage visuel de sa présence. Ainsi l’imagerie cérébrale repère visuellement la trace des passions charnelles, sans qu’il soit possible d’expliquer la trajectoire de la passion. Quel est alors l’intérêt de cette technologie puisqu’elle n’explique rien ? De visualiser, comme la fin des trajectoires des comètes, la fin des mouvements passionnels. Helen Fisher montre ainsi que, si la passion démarre inexorablement, elle s’éteint ensuite tout aussi inexorablement, par reflux biologique naturel. À l’amour (passionnel) succède le désamour (la dépassion).
Quelle pourrait être l’implication morale de cette observation ? Selon cette représentation qui fait droit aux mécanismes biologiques de la passion, tel un radeau embarqué dans une descente de rapides en montagne et balloté sur un torrent impétueux, il semblerait que l’individu emporté dans une passion et qui cherche à s’en libérer devrait donc surtout veiller à ne pas ralentir son embarcation au risque de se fracasser sur les rochers qui bordent les eaux en furie et de mourir noyé. Tout au contraire, il s’agirait de parvenir à arriver au plus vite en bas du passage dangereux. Quittons la métaphore. Dans l’hypothèse où l’on cherche à garder un cap initial (ici, pour David, sa vocation de prêtre) pendant la phase torrentielle de la passion, il serait dangereux de chercher à modérer le mouvement passionnel, et encore plus de vouloir l’étouffer par une dénégation des pulsions sexuelles qui habitent ce mouvement. C’est à dire que, dans le contexte présenté par le film, qui est celui d’un combat spirituel (il ne s’agit pas de situations dans lesquelles on ne cherche qu’à suivre des satisfactions égoïstes), le traitement adéquat des passions serait, non pas de les modérer, mais de les fatiguer.
Cette analyse analogique permet de mieux comprendre une scène très forte du film qui a été à la fois mal acceptée dans certains milieux catholiques et tournée en dérision dans la réception du film. Il s’agit du moment où la recherche désespérée d’une libération de la passion charnelle par la prière semble ne pas fonctionner. David se prosterne devant un crucifix en suppliant Dieu de le libérer de cette passion pour Jézabel mais, quelque temps plus tard, il revient chez elle et leurs corps nus se rencontrent. Cette scène a choqué les catholiques. David, peut-on lire ou entendre, a cédé à sa passion alors qu’il aurait dû résister. Mais la suite du film est encore plus intéressante car, à nouveau, il a plongé les catholiques dans la perplexité.
Dans le mouvement de la passion des corps qui s’enlacent, Jézabel arrache par mégarde la croix que David porte autour du cou, et ce geste fait déclic. David s’arrache tout à coup du torrent passionnel et s’en extrait avec violence (trop tôt ?). Il brise son casque de moto contre un mur du salon de Jézabel sur lequel il se frappe ensuite la tête à plusieurs reprises, puis fuit (après un excès de naïveté, un excès de fuite ?). Ce geste lui sera fatal: il mourra d’un accident de moto en roulant ensuite (trop vite ?) sans visibilité. Il ne restera plus à Jézabel que le sang de David qui macule le mur de son salon. Beaucoup de commentaires catholiques ont vu dans la mort de David, qui aboutira à la fin du film pour Jézabel à retrouver apparemment un sens à sa vie, un parallèle christique sur le thème de la parabole «si le grain ne meurt». Cette interprétation est contestable. En effet, dans l’évangile de Jean, Jésus dit: «Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne». Or dans le film, David ne donne pas sa vie, elle lui est prise. Donc le parallélisme ne fonctionne pas. Une autre interprétation est possible, qui prend en compte la patience de la temporalité.
Dans Repères éthiques pour un monde nouveau (2), le théologien moraliste Xavier Thévenot rappelait que toute vraie morale est obligée de tenir compte du facteur temps. Que le tout, tout de suite est profondément immoral. Et que la visée d’un idéal (comme ici l’idéal de la continence sexuelle pour David) supposait parfois des passages longs par la transgression. Thévenot ajoutait que les errances (comme celle de David avec Jézabel), même si elles présentaient des côtés aliénants, faisaient partie de la construction de la personne. L’importance de l’errance dans la construction réflexive du soi a par exemple été soulignée par Anthony Giddens dans La transformation de l’intimité (3). C’est la raison pour laquelle la patience, qui s’accorde de l’imperfection des conduites et (dans le film) de la présence des pulsions sexuelles, est centrale dans la lutte contre la passion.
Une méditation du pape François (4) fait écho à cette idée: «Nous ne devons pas nous laisser gagner par l’impatience» car «si nous décidons de descendre de la croix, nous le faisons toujours cinq minutes avant la révélation». Ne pas descendre de la croix signifie rester avec le Christ dans la passion. Dans le film, David aurait-il dû avoir la patience de passer par la passion jusqu’au bout ? Pour le dire autrement: pour rendre David patient, fallait-il qu’il éprouve la passion jusqu’à son terme ? Notre proposition ici est donc de relire cette scène du film en considérant la possibilité provocatrice que David ait voulu descendre de la croix cinq minutes trop tôt. Qu’apporte cette proposition à l’analyse du film ? De s’apercevoir que David, voulant lutter contre sa passion, ne respecte pas – par impatience – les lois de la passion. Autrement dit, quand on veut s’extirper d’un mouvement passionnel, il y a peut-être mieux à faire que rouler trop vite au péril de sa vie pour contrer l’afflux d’ocytocine.
Un ancien adage de l’humour chrétien énonce que seul le diable est pressé car pour lui, le temps est compté. Si l’on admet que, par impatience ou impétuosité, David cherche à quitter le torrent passionnel trop tôt; que par tempérament trop pressé, il cherche à fuir Jézabel trop vite, alors le titre d’un roman de René Barjavel semble rejoindre le commentaire de la cheffe de chœur qui se réjouissait de ce que David soit mort sans avoir pu se confesser: le diable l’emporte. Ce serait la raison pour laquelle «le diable est pressé»: il lui faut agir vite (avant la révélation) pour que David se tue (et meure sans s’être confessé). Et ceci pourrait expliquer la gêne de nombreux catholiques devant ce film. Les mêmes qui refusent la temporalité dans la morale (tout, tout de suite) refusent la chute dans la vie pratique. Une attitude diabolique ?
Identité narrative, passions et morale de l’histoire
Il est temps de revenir à la question initiale. De quoi ce film serait-il le messager ? Et quelle serait la place des passions – qui prennent du temps – dans l’identité narrative ? On fera d’abord remarquer que la réponse faite dans le film par la mère supérieure à Jézabel fait écho aux propos tenus en 1972 par le théologien suisse Maurice Zundel (1897-1975) qui, lors d’une retraite prêchée au Vatican sur le thème «Quel homme, quel Dieu ?», avait développé une méditation autour de la question-réponse: «Croyez-vous en Dieu ? – Et vous, croyez-vous en l’homme ?».
La pensée de Zundel prend comme point de départ les passions humaines. Faisant contrepoint à Hegel qui énonçait que «Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion» (La raison dans l’histoire), Zundel affirme qu’on ne peut aller à Dieu sans mouvement axé sur ses passions les plus personnelles, fussent-elles, au départ, orientées sur des objets apparemment très éloignés du religieux, comme le sont par exemple les thèmes tourmentés des toiles de Jézabel. Pour Zundel, aucune grandeur ne peut se réaliser sans s’appuyer sur ce fond passionnel dont il loge la source dans notre inconscient, «l’océan d’impulsions d’où émergent nos passions essentielles». S’appuyant sur les pensées de scientifiques (Rostand, Einstein), d’écrivains (Huysmans, Flaubert, Shelley, Keats), d’artistes (Van Gogh, Isadora Duncan) ou de sportifs de haut niveau, Zundel veut montrer que les passions sont indispensables à l’accès à notre identité profonde. Car les mouvements violents qu’elles procurent nous rendent, par leur force même, capables de briser les obstacles qui nous retiennent à l’extérieur de nous-mêmes. Francesco Alberoni présente cette idée audacieuse d’une manière métaphorique dans Le choc amoureux. Recherches sur l’état naissant de l’amour (5), essai qui assigne à l’amour naissant une tâche révolutionnaire: le mouvement passionnel survient dans la vie d’un individu quand il ne reste plus que cette force impétueuse pour l’extraire de l’environnement dans lequel il s’enlise en dehors de ce qu’il est réellement. À ce moment, raconte Alberoni, l’homme arrache leur épée de feu aux chérubins qui gardent le jardin d’Éden pour pouvoir pénétrer, ne serait-ce que peu de temps (le temps qu’il suffit), dans le jardin. Une surrection contre le risque de perdre la vie en étant empêché de s’atteindre en profondeur (entrer dans le jardin). Ainsi pour Zundel, sans passion, impossible d’accéder à Dieu: «C’est notre passion fondamentale qui deviendra le tremplin de l’élan de plus haut». Toute passion est un mouvement incarné, donc temporalisé (et a fortiori une passion charnelle) qui mérite donc, pour cette raison précise, de ne pas être évacuée a priori.
Considérons l’approche de la morale par le cinéma. Les approches morales traditionnelles du cinéma analysaient les films en situant leur moralité, c’est à dire la présence du bien moral et du mal moral dans l’histoire du film, à partir d’une morale de surplomb. Cette approche considérait que le mouvement de caméra, la technique de prise de vue, était éthiquement neutre, se situait en dehors du champ de la morale. On connaît la célèbre réponse de Jean-Luc Godard avec la formule «Les travellings sont affaire de morale» et l’analyse de Serge Daney du texte de Jacques Rivette sur le film Kapò (1960), dans lequel est critiquée la mise en scène de Gillo Pontecorvo pour une question de travelling (6). Ce que veut dire Godard, comme les critiques-cinéastes de la Nouvelle Vague, c’est que la neutralité morale de la technique est une illusion, d’où le fait que la mise en scène était aussi une question morale, et donc le choix d’un travelling, ou non. La théorie morale du cinéma proposée par la Nouvelle Vague déloge ainsi l’éthique d’un film des seules analyses morales des comportements des personnages pour l’insérer aussi dans la technique de prise de vue.
Ce déplacement du lieu de la morale cinématographique qui prend en compte la construction narrative par la mise en scène pourrait servir de métaphore à l’analyse du film de Natalie Saracco en considérant Dieu comme un metteur en scène. Décidant a priori ce qui est de l’ordre du bien moral ou du mal moral, la morale de surplomb (se mettant à la place de Dieu ?) oppose frontalement vocation religieuse et passion charnelle. Mais le film nous propose une autre hypothèse, dont l’audace même a pu effrayer les catholiques qui l’ont financé. Cette hypothèse, il est possible de la reformuler en adoptant une posture agnostique. S’il y a un Dieu et que ce Dieu existe pour l’homme, alors ce Dieu ne serait pas que du côté du bien moral de la morale de surplomb mais aussi dans le mouvement passionnel même, en tant que force de vie agissant dans l’histoire des personnes contre un obstacle mortifère à détruire, ici l’impatience de David.
Précisons cela. Il ne s’agit évidemment pas de prétendre qu’il n’existe pas de bien moral. Ni qu’il ne faille pas chercher à tendre vers une vie bonne, quelle que soit l’école de pensée philosophique à laquelle se rattache cet objectif. Ni même que toutes les passions représentent des manières d’atteindre ce bien: la haine de l’autre est une passion de détruire selon la terminologie d’Erich Fromm et le terrorisme nous rappelle que le nihilisme existe. Il s’agit seulement de considérer que Dieu puisse se situer aussi dans le mouvement passionnel dans lequel chance et risques sont très profondément intriqués, tels le bon grain et l’ivraie, c’est à dire dans l’histoire narrative de la vie de l’individu avec son incertitude et ses errances, et non pas uniquement dans une position extérieure à cette histoire passionnelle, comme le veut la morale de surplomb. En ce sens, on pourrait dire que les passions ne sont pas divinement neutres.
Cette transposition de la morale de la mise en scène de l’école critique des Cahiers du cinéma à l’action de Dieu dans la vie passionnelle des hommes (et ici dans les vies de David et de Jézabel) pulvérise les catégories morales religieuses objectivistes qui évacuent toute idée d’identité narrative avec l’incertitude qui lui est coextensive, et ruine la morale anhistorique de surplomb qui ne prend pas en compte la temporalité de l’existence humaine, anhistoricité dans laquelle s’ancre une forme de bienpensance religieuse. En cela, si la morale religieuse anhistorique qui étouffe l’oxymore chrétien avait pu encore (quoique mal) survivre dans la modernité tardive des sociétés occidentales, la postmodernité la fait littéralement exploser. Et c’est là-dessus, selon nous, que s’est développée la controverse entre catholiques à propos de ce film.
En ce sens Jézabel, dont ses détracteurs disent tous au cours du film qu’elle n’aime pas, par sa passion est peut-être déjà en train d’aimer mais elle-même ne le sait pas encore (elle ne le saura qu’à la fin de l’histoire). Et le titre du film pourrait ainsi s’écrire: L’amante religieuse.
Christian Walter est membre du Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne.
Illustration: captures d’écran de la bande-annonce du film.
(1) Helen Fisher, Pourquoi nous aimons, traduction par Anatole Muchnik (Why We Love, The Nature and Chemistry of Romantic Love, Henry Holt & Co., 2005), Robert Laffont (Réponses), 2006.
(2) Xavier Thévenot, Repères éthiques pour un monde nouveau, Salvator, 1982. Réédition en 2005 dans le recueil Éthique pour un monde nouveau, Salvator (Références éthiques).
(3) Anthony Giddens, La transformation de l’intimité, Sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes, traduction par Jean Mouchard (The Transformation of Intimacy, Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Polity, 1992), Hachette/Pluriel (Sociologie), 2006.
(4) Pape François, Le mystère de la patience de Dieu, 28 juin 2013 (site du Vatican).
(5) Francesco Alberoni, Le choc amoureux, Recherches sur l’état naissant de l’amour, traduction par Jacqueline Raoul-Duval (Innamoramento e amore, Garzanti, 1979), Ramsay, 1983. Réédition chez Pocket en 1993.
(6) En juin 1961, Jacques Rivette réagit à la sortie française du film Kapò (avec l’actrice Emmanuelle Riva) par De l’abjection (Les Cahiers du cinéma 120, pp.54-55): «Voyez cependant, dans Kapò, le plan où Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés, l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond mépris».Rivette fait référence dans son texte à deux interventions récentes de collègues de la revue dans le débat d’alors sur la morale du cinéma: «La morale est affaire de travelling» (Luc Moullet, Sur les brisées de Marlowe, Les Cahiers du cinéma 93, mars 1959) et «Les travellings sont affaire de morale» (Jean-Luc Godard, table ronde sur Hiroshima mon amour, Les Cahiers du cinéma 97, juillet 1959). Lire à ce propos: Antoine de Baecque, Le cas Kapo, «De l’abjection», ou comment Jacques Rivette forge une morale de la représentation des camps de la mort, Revue d’histoire de la Shoah 2011/2, pp.211-238. Dans Le travelling de Kapò, un texte posthume publié dans Trafic en 1992, Serge Daney analysera l’importance du texte de Rivette pour sa vision du cinéma.