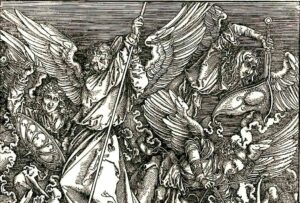André Gounelle !
«Une forme de sincérité souveraine»: entre l’homme («Chez lui, l’intelligence et la miséricorde étaient sous l’habitus assez typique d’une sobriété assumée») et ses textes «qui vous tiennent la main, non pas d’abord pour vous guider, mais pour vous soutenir sans jamais vous inférioriser», exemple parmi tant d’autres de comment André Gounelle a pu marquer un parcours, en l’occurrence celui de Philippe Kabongo-Mbaya… mais aussi la fin de celui de Paul Ricœur.
Pasteur, théologien, pédagogue: le nombre de qualificatifs qui accompagnent l’hommage de l’illustre disparu n’arriverait pas à exprimer ce qui est ressenti, honoré, dans les réseaux sociaux, les médias divers, les échanges amicaux à l’annonce du décès de cet homme.
Même celles et ceux qui ne le connaissaient pas suffisamment pourraient imaginer ce qu’aurait pu être sa réaction devant cette avalanche d’amitié, de reconnaissance, d’éloge abondant. En l’occurrence rien ne ressemble pourtant à de l’affectation, à l’étalage des bons sentiments. Tant cet homme distant, visiblement froid, presque taiseux, d’allure intimidante, était profondément humain, sensible, chaleureux: un esprit ouvert et un cœur accueillant. Chez lui, l’intelligence et la miséricorde étaient sous l’habitus assez typique d’une sobriété assumée.
Quelques souvenirs personnels à distance, puisque je n’ai pas eu la chance de le fréquenter plus régulièrement; mais lui garde une gratitude personnelle pour certains moments de mon parcours intellectuel.
L’inattendu
À la suite d’une consultation internationale de la Conférence des Églises européennes, ma contribution comme d’autres a été publiée dans les actes de ce colloque (1). C’était en 1977. Il y avait je crois une dizaine d’étudiants africains à la Faculté de théologie de Montpelier. André Gounelle mit au programme de son cours un travail sur mon texte, qui n’avait pas d’ambition particulière, sinon de montrer timidement les limites d’une ethno-théologie chez quelques représentants de la Théologie africaine, qui pensaient la culture africaine comme une sorte de monade et de fait ostracisaient le débat, l’enfermant dans un culturalisme illusoire, mais surtout idéologique. Que ce texte ait eu cet écho à la Faculté de Montpellier où il n’y avait guère d’étudiants africains, cela fut une surprise pour moi.
Aux débuts des années 1980, j’ai enfin eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec le professeur Gounelle. C’était lors de la création de l’Association francophone Paul Tillich à Chantilly dans un vaste domaine des Pères Jésuites. Avec beaucoup de retenue et de sincérité, il me dit ce qui l’avait intéressé dans la critique de l’ethno-théologie, les réactions des étudiants, l’intérêt de croiser cette approche à la théologie de la culture (2) chez Paul Tillich, entre autres. Lors d’un autre colloque à Strasbourg, le professeur Gérard Siegwalt et André Gounelle me sollicitèrent pour une contribution sur la théologie africaine. À l’issue de cette rencontre, un lot d’articles fut publié dans la Revue d’histoire et de philosophie religieuse, tandis qu’un autre parut dans Études théologiques et religieuses de la Faculté de Montpellier. Ma contribution en faisait partie (3).
Dix ans après, deux autres occasions me furent données d’animer deux soirées avec André Gounelle. En 1991 à Nancy, au Centre Le Buisson ardent, autour du livre Après la mort qu’y a-t-il ? (4). Quelques participants revenaient sur l’impuissance des enseignements religieux à fournir des réponses claires sur l’au-delà. Ils insistaient sur l’angoisse face à la mort. Avec calme, André Gounelle rappelait le contenu de l’espérance chrétienne et sa signification pour les chrétiens. Dans la salle, le scepticisme plainait… Surmontant timidité et hésitation, j’ai évoqué un exemple qui plut à notre hôte: qui se préoccupe du cadeau qu’il peut recevoir à Noël ? Nous nous soucions au contraire de celui que nous allons nous-mêmes offrir à cette occasion. De la même manière, disais-je, Dieu se soucie de notre maintenant et de notre après. L’analogie fit mouche. André Gounelle la redéveloppa séance tenante.
Un deuxième moment, c’était à l’Aumônerie universitaire protestante de Strasbourg. André Gounelle y était invité pour introduire le livre de Marco Koskas Albert Schweitzer ou le démon du bien (5). Il suggéra aux organisateurs que je fusse une deuxième voix afin de manifester l’ancrage africain du célèbre missionnaire et Prix Nobel. Malgré mes réserves devant certains silences et des ambiguïtés du théologien alsacien, figure non négligeable du protestantisme de la raison (libéral en Europe, conformiste et paternaliste au Gabon), le professeur Gounelle nuança mes remarques, en les contextualisant; mais reconnut cette distorsion. Son attitude de liberté agrandit à mes yeux cette impression qu’il dégageait d’une forme de sincérité souveraine.
Intermède
Quand on pense à André Gounelle, ses livres viennent à l’esprit d’une manière singulière. Mais pas comme ceux de tel auteur ou tel écrivain. Ici, ce sont des livres enseignements. Des textes qui vous tiennent la main, non pas d’abord pour vous guider, mais pour vous soutenir sans jamais vous inférioriser. Des livres qui sont comme une petite lumière ajustée de la torche de smartphone, faite pour se poser sur ce qui est à voir.
Parmi quelques titres que j’ai eus entre les mains: La Bible selon Pascal; Les grands principes du protestantisme; Le protestantisme, ce qu’il est et ce qu’il n’est pas; Le Christ et Jésus. Trois christologies américaines: Tillich, Cobb, Altizer; Le dynamisme créateur de Dieu, Essai sur la Théologie du process; Le baptême. Le débat entre les Églises; La Cène, sacrement de la division; Parler du Christ; Parler de Dieu; enfin Théologie du protestantisme (6). De ces ouvrages, ce dernier titre fait incontestablement la différence, un livre-conclusion. Son ambition, réussie, la récapitulation de l’œuvre de Gounelle. Ce qui permet de déceler les enchainements d’idées et des débats aux croisements des thématiques théologiques modernes et classiques.
Outre l’intérêt qu’il représente pour moi-même, j’ai offert ce livre majeur à des amis et collègues en Afrique à cause de sa valeur de boussole. La théologie est comparable à une table de boucher. La chaire et la peau, les nerfs et les cartilages, les graisses, la moelle ou la cervelle: un traiteur qui n’a pas cure de ces distinctions ne saura offrir un produit attendu, malgré la qualité des outils ou les normes du métier. Quiconque a lu André Gounelle sait à quoi s’en tenir non seulement avec ce que l’on appelle intelligence de la foi, mais encore l’intelligence tout court: opérer des rapprochements ou des distinctions pertinents sur des donnés embrouillés ou des rapports complexes, parfois erratiques. Les qualités de pédagogue que tous lui reconnaissent relèvent de ce constat. Un besoin de clarification qui, parfois consent aux schématisations que d’aucuns bouderaient par crainte de simplismes ou de raccourcis.
Une dernière évocation
Quelques semaines avant son décès, j’avais rendu visite à Paul Ricœur, le philosophe. Il me fit part de son malaise avec la formule biblique, devenue le socle de la représentation que nous nous faisons du salut offert en Jésus-Christ. «Il est mort pour nous»: le grand penseur protestant cherchait à me faire comprendre non pas seulement l’étrangeté de cette doctrine, mais également une forme d’accablement que l’affirmation lui causait. J’ai essayé de lui dire ce qui me semblait important dans l’expression; je lui ai également rappelé les limites de tout discours humain, y compris celui des auteurs bibliques même les plus éminents.
Ricœur revenait à la charge, avant de me confier: «Tel enseignant à la Faculté de théologie en qui j’ai confiance, et pour lequel j’ai beaucoup d’amitié, m’a dit que cette doctrine est nécessaire, elle tient le fondement de notre foi». J’ai commencé à cerner ce «malaise» comme un tourment existentiel, une oppression intérieure lancinante d’un homme privé de quiétude au soir de sa vie. Je n’avais nullement l’impression qu’il radotait. Je trouvais injuste et vraiment insupportable qu’une certaine théologie sacrificielle conduise les gens à pareille souffrance intime !
«Il est mort pour nous…»: un endettement insolvable, une dette odieuse, en dépit de tout l’amour et toute la foi humaine comme abandon de soi dans le geste gracieux d’un Dieu aimant et secourable. Une idée m’est venue. J’ai alors parlé de Parler du Christ d’André Gounelle à Ricœur, en lui proposant de le lui ramener avant la soirée. Ce qu’il a immédiatement accepté. Je pensais à un passage de Gounelle sur la signification de la mort de Jésus: «Il est mort non pas pour nous, mais à cause de nous».
Le lendemain matin, le philosophe m’appela. En me disant des remerciements, sa voix était empreinte de paix. Il avait lu l’ensemble du chapitre consacré à la question. Des développements clairs, à distance de l’évidence sacrificielle, de tout ce «sang de délivrance» qui inonde cantiques et expressions liturgiques. L’après-midi, je suis allé voir le vieil homme après sa sieste. Regard illuminé, il m’a accueilli les yeux souriants traduisant un rien de complicité: «C’est un très bon livre»…
Sur le chemin de retour, j’ai appelé André Gounelle. Il m’a écouté, surpris. Avant de me dire «Merci» sans commentaire ni demande de précision. Il avait parfaitement compris comment sa position sur le sujet avait pu apaiser un baobab comme Ricœur, à 92 ans. Nous étions en avril ou début mai 2005.
C’était la dernière fois que j’ai parlé au professeur André Gounelle.
Qu’il repose en Christ.
Lire les textes d’André Gounelle sur le site André Gounelle.fr et sur Persée.
Illustration: André Gounelle lors d’un cours à l’IPT Montpellier en 2018 sur Whitehead et la théologie du process.
(1) Philippe Babundha Kabongo-Mbaya, La Théologie européenne mise en question par la communauté œcuménique mondiale, Conférence des Églises européennes, Cahier n° 8, 1976, pp.53-65.
(2) Paul Tillich, Théologie de la culture, Dieu est-il absent ?, Planète, Paris, 1968; Jean-Paul Gabus, Introduction à la théologie de la culture de Paul Tillich, PUF (Études d’histoire et de philosophie religieuses 63), 1969.
(3) Philippe B. Kabongo-Mbaya, Être nouveau chez Paul Tillich et humanité noire, ETR 56/4 (1981), pp.549-566.
(4) André Gounelle et François Vouga, Après la mort, qu’y a-t-il ? Les discours chrétiens sur l’au-delà, Cerf (Théologies), 1990.
(6) André Gounelle, La Bible selon Pascal, PUF (Cahiers d’histoire et de philosophie religieuses), 1970 (première version dans Revue d’histoire et de philosophie religieuses 49/2 , pp.113-134, et 49/3, pp.229-256 (1969); Les grands principes du protestantisme, Olivétan, 2011; Le protestantisme, ce qu’il est, ce qu’il n’est pas (avec Laurent Gagnebin), La Cause, 1984; Le Christ et Jésus. Trois christologies américaines: Tillich, Cobb, Altizer, Desclée, 1990; Le dynamisme créateur de Dieu, Essai sur la Théologie du process, Van Dieren (Références théologiques), 2000 (première version en hors-série d’ETR en 1981); Le baptême. Le débat entre les Églises, Les bergers et les mages, 1996; La Cène, sacrement de la division, Les bergers et les mages, 1996; Parler du Christ, Van Dieren, 2003, 2004; Parler de Dieu, Van Dieren, 2005 (Foyer de l’âme, 1997); Théologie du protestantisme, Van Dieren, 2021, 2025.